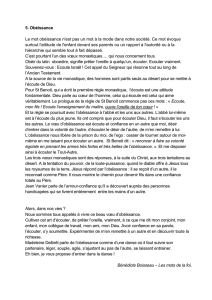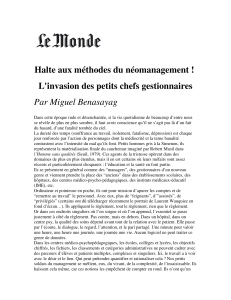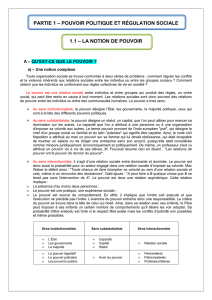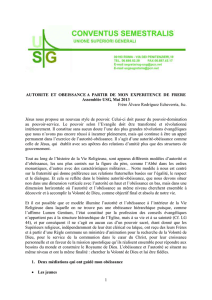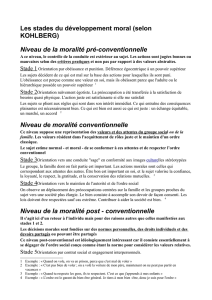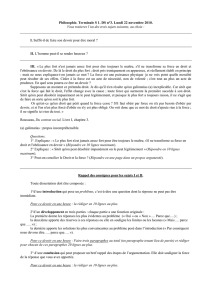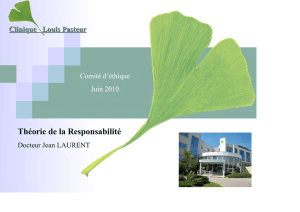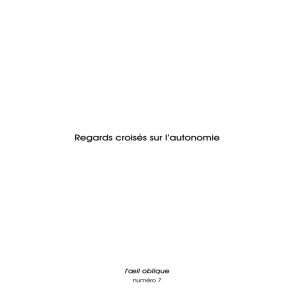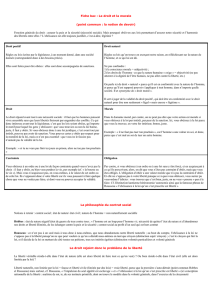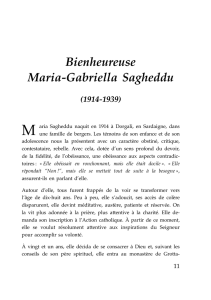Quelles sont les fonctions de l`obéissance dans l`éducation ?

www.philocite.eu
Pratique de la philosophie – Animation, formation, recherche, expertise critique
Quelles sont les fonctions de l’obéissance dans
l’éducation ?
Gaëlle Jeanmart
En me penchant sur ces deux corpus très différents de la
philosophie antique et des règles monastiques et plus précisément sur la
manière dont ils traitent chacun de la question du rôle de l’obéissance
dans la formation des individus, je voudrais décrire deux conceptions
différentes de la norme et deux rapports différents à la norme plutôt que
d’opposer une éducation traditionnelle ou disciplinaire à une éducation
nouvelle ou libérale qui refuserait a priori et par principe d’accorder à
l’obéissance un rôle déterminant dans l’éducation.
L’obéissance a un rôle à la fois indispensable et problématique
dans ces deux corpus. C’est un objet de question, mais la manière dont
on la problématise est différente d’une époque à l’autre. Je me propose
d’envisager ici la place respective de l’obéissance dans les systèmes
pédagogiques élaborés par les philosophe grec (et particulièrement
Aristote) et les législateurs du monachisme (et particulièrement Cassien1
et saint Benoît2).
1Moine italien ayant vécu aux IVe et Ve siècles qui est l’introducteur en
Occident du monachisme qui est originellement égyptien et syriaque.
2Après les Institutions cénobitiques de Cassien qui ouvrent l’expérience
orientale du cénobitisme à l’Occident, aucune règle n’a vraiment réussi à
s’imposer en dehors de l’aire d’influence diocésaine de son auteur. Il faut
attendre la règle de saint Benoît VIe siècle pour répondre à un profond besoin
d’unité dans l’organisation de la formation des moines. Elle marque une
étape décisive dans l’évolution de la législation monastique vers un système
scolaire institutionnalisé. Nul n’osera plus la remanier ou la fondre avec
d’autres. Elle sera recopiée et diffusée intégralement. Ainsi, si Cassien est le
passeur à l’Occident du cénobitisme oriental, Benoît est celui qui en
inventera la formule latine.
Gaëlle Jeanmart : « Quelles sont les fonctions de l’obéissance... » - www.philocite.eu – 2011 – p.1

La Grèce classique
Dans la Grèce classique, l’apprentissage a très tôt été conçu
comme un acte de subordination et d’assujettissement de celui qui
apprend au maître, entraînant une certaine passivité du sujet apprenti.
Cette passivité fait problème dans la mesure où l’obéissance dans
l’éducation, ce n’est pas d’abord le respect de la loi, dans un rapport
objectif aux règles de conduite sanctionnées par l’autorité publique qui
n’est pas conçue comme une relation de soumission ; l’obéissance dans
l’éducation, c’est d’abord la soumission d’un individu à un autre, dans un
rapport subjectif qui est un rapport asservissant. Et si ce rapport de
domination inter-personnel fait problème, c’est que l’objectif de
l’éducation, c’est l’émancipation d’un sujet. Le but de l’éducation, c’est la
liberté de l’homme qui n’est soumis à rien qu’à sa raison, c’est-à-dire qui
n’est soumis ni à ses passions, ni à un autre être dont il serait l’esclave.
La cristallisation du danger et de l’équilibre fragile de cette relation
d’enseignement se fait donc sur le constat d’une hétérogénéité entre
l’objectif visé, à savoir l’autodétermination rationnelle, le fait de n’obéir
à rien qu’à sa raison, et la situation d’apprentissage où l’élève est
considéré comme un être non encore raisonnable et devant s’assujettir à
un homme libre pour le devenir lui-même. Le problème est alors de
trouver une méthode de gouvernement et d’enseignement qui, en dépit
de la relation de subordination, éveille chez le jeune les capacités
d’autonomie qui lui permettront de se réaliser pleinement.
C’est l’asservissement temporaire de l’élève au maître qui lui
permet de soumettre ses désirs à sa raison. L’art d’enseigner du maître
consiste dès lors à transmuer la contrainte extérieure qu’il exerce sur
l’élève en une contrainte interne que la raison de cet élève exercera sur
son propre désir.
Ce qui justifie cette relation est aussi ce qui la limite : pour
accéder à la maîtrise de soi, il faut obéir au maître parce que la passion
doit obéir à la raison (et que l’enfant est toujours un être de passions,
tandis que le maître doit être un être rationnel) et comme la passion doit
obéir à la raison (dans cette limite là). La définition d’un art de
Gaëlle Jeanmart : « Quelles sont les fonctions de l’obéissance... » - www.philocite.eu – 2011 – p.2

gouverner s’accompagne tout naturellement de la régulation de l’usage
de l’autorité : l’acte requis par l’autorité doit se faire à l’avantage de
celui dont elle le requière et cet avantage peut être mesuré relativement
au chemin qu’il lui permet d’accomplir dans la réalisation de son essence
d’homme libre, doué d’un logos et destiné à exercer un empire sur lui-
même et sur les autres par l’exercice de sa raison.
Au delà de la compétence « matières », c’est-à-dire de la
possession d’un savoir ou d’un savoir-faire qu’il transmettrait, la
compétence particulière qui permet au maître de gouverner
adéquatement, c’est la maîtrise de soi. Celui qui abuse de son pouvoir
en imposant à autrui sa fantaisie, ses appétits et ses désirs, déborde de
l’exercice légitime du pouvoir, c’est-à-dire de son exercice raisonné et
maîtrisé, et exhibe d’abord son absence de maîtrise de lui-même et donc
sa servitude aux passions. Exercer son pouvoir correctement, c’est
l’exercer en même temps sur soi-même. Celui qui se soucie comme il
faut de lui-même se conduit nécessairement comme il faut dans son
rapport aux autres. Le souci de soi est toujours en même temps le souci
des autres et la maîtrise de soi est toujours en même temps une
aptitude à être le maître d’un autre : ils permettent de gérer l’espace de
pouvoir qui est présent dans toute relation, c’est-à-dire de le gérer dans
le sens de l’absence d’arbitrarité.
Le monde monastique
Si le problème pédagogique majeur pour les philosophes grecs
est l’hétérogénéité entre l’objectif visé dans l’éducation et la situation
d’apprentissage où l’élève doit s’assujettir à un homme libre pour le
devenir lui-même, pour les moines, la question est celle de la
conciliation possible de la finitude humaine et de la vie morale de
l’individu. Celle-ci n’est plus conçue comme étant le fruit de la vie
intellectuelle ; ce qui compte désormais, ce n’est pas la raison et
l’emprise qu’elle peut avoir sur les passions, c’est la volonté comme
source de tous les actes et la considération de ses limites. On trouve
dans la tradition chrétienne l’expression forte de cette idée dans l’épître
Gaëlle Jeanmart : « Quelles sont les fonctions de l’obéissance... » - www.philocite.eu – 2011 – p.3

aux Romains de Paul : « … vouloir le bien est à ma portée, mais non
l’accomplir. Ainsi, le bien que je veux je ne le fais pas, mais le mal que
je ne veux pas, je le pratique » [Ép. Rom.VII, 18-20]. Il faut donc
renoncer à vouloir par soi-même et cultiver une obéissance permanente.
Cette obéissance est déclinée en trois vertus distinctes –
l’humilité, la patience et la soumission –. L’humilité consiste à se
considérer de si basse condition que tous les autres quels qu’ils soient
peuvent donner des ordres. C’est la qualité de celui qui se sachant de
peu de valeur le reconnaît bien humblement : « nous sommes de faibles
vases tirés du limon de la terre (humus), des espèces de mottes de terre
dressées sur la terre pour un peu de temps et destinées à retomber de
nouveau dans leur sillon, humilions-nous donc comme la poussière de la
terre et disons ce que nous sommes » [Règle du Maître, VIII, 1-53].
Cette absence de valeur se retourne dans le signe inverse de l’excellence
humaine, puisque l’humilité est la vertu des vertus.
La patientia est l’abolition de toute volonté propre. Elle consiste
à ne jamais résister à un ordre donné, à ne pas différer d’un corps
inanimé ou d’une matière première utilisée par un artiste. Quelles que
soient les raisons que l’on a de faire ce qu’on faisait, quelle que soit
l’urgence de cette tâche, il faut l’abandonner immédiatement pour faire
ce que le maître ordonne : « C’est ainsi que, assis à l’intérieur de leurs
cellules et appliquant également leur zèle au travail et à la méditation,
aussitôt qu’ils entendent le bruit de celui qui frappe à la porte et donne
le signal les appelant à la prière ou à quelque travail, ils rivalisent
tellement de promptitude à quitter leurs cellules que celui qui exerce le
métier de scribe n’ose pas achever la lettre qu’il avait commencée mais
bondit au moment précis où le bruit de celui qui frappe à la porte
3La Règle du Maître est la manuscrit sur lequel saint Benoît se serait appuyé
pour écrire la sienne ; elle aurait été composée au début du VIe siècle, en
Italie du Nord ou en Provence. Son texte nous est parvenu sous la forme de
deux manuscrits qui datent du début du VIIe siècle, alors que le plus ancien
manuscrit de la règle de saint Benoît dont nous disposons date du début du
VIIIe siècle. Certains, pour sauver l’originalité de saint Benoît, lui ont attribué
la rédaction de la règle du Maître, la règle dite de saint Benoît étant alors
considérée comme une codification légèrement postérieure, probablement
rédigée à Rome dans l’entourage du Pape Grégoire le Grand. D’autres, dans
le même objectif, ont choisi plutôt de souligner à gros traits tous les progrès
réalisés par la deuxième règle dont ils lui gardent alors l’attribution.
Gaëlle Jeanmart : « Quelles sont les fonctions de l’obéissance... » - www.philocite.eu – 2011 – p.4

parvient à son oreille, et ne tolère pas même le retard qu’exigerait le fait
de terminer le jambage commencé » [Inst. cén., IV, 12]. La patience
définit le zèle dans l’obéissance, elle est la déclinaison du « plein gré »
qui distingue l’abandon exigé du moine de la simple obéissance exigée
du grec.
La troisième vertu, la subditio, est la vertu de soumission,
littéralement « le fait d’être mis en dessous ». C’est une notion très
importante parce qu’elle s’oppose à ce que pouvait être l’idée d’une
soumission à la loi dans la pensée morale, politique et philosophique des
Grecs. L’Antiquité connaissait évidemment l’obéissance : on devait obéir
à un code d’obligations et d’interdictions ; mais dans la subditio, il ne
s’agit plus d’une obéissance à un code précis : il faut laisser le principe
d’obéissance pénétrer tout le comportement. Il ne faut rien faire qui ne
soit commandé par quelqu’un d’autre. La formulation de ce principe par
St Basile est forte : « Tout acte qui se sait sans ordre ou permission d’un
supérieur est sacrilège ». Cassien, quant à lui, précise que « la règle de
l’obéissance est gardée avec une telle fidélité que les jeunes non
seulement n’osent pas quitter la cellule sans que leur préposé ne le
sache et n’y consente, mais ne présument même pas son autorisation
pour satisfaire à leurs besoins naturels » [Inst.cén., IV, 10]. Et Benoît
insiste : « Que le moine ne fasse rien qui ne se recommande de la règle
commune du monastère et des exemples des supérieurs » [RB, 5, 55] et
plus loin, il ajoute que subira le châtiment de la règle quiconque se
permettra de « faire n’importe quoi, même de peu d’importance, sans
l’autorisation de l’abbé » [RB, 67, 7].
Cette analyse de l’obéissance monastique permet de la
distinguer de l’obéissance dans la philosophie de l’éducation grecque
sous trois aspects concernant le temps ou la durée de l’obéissance,
concernant sa finalité et concernant la nature du lien entre norme et
raison.
1) La durée de la relation d’obéissance :
L’obéissance est conçue comme un rapport qui n’a plus rien de
provisoire. Il ne faut jamais se considérer comme ayant atteint une
situation de maîtrise définitive. Cette croyance est la preuve ou, plutôt,
Gaëlle Jeanmart : « Quelles sont les fonctions de l’obéissance... » - www.philocite.eu – 2011 – p.5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%