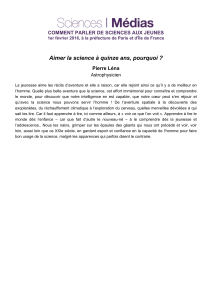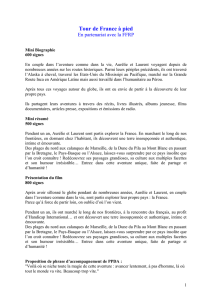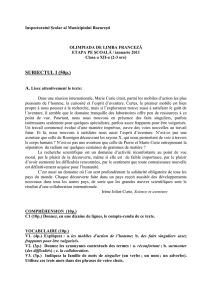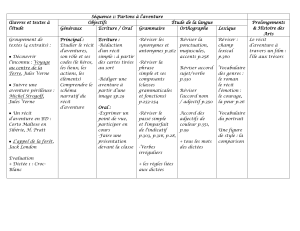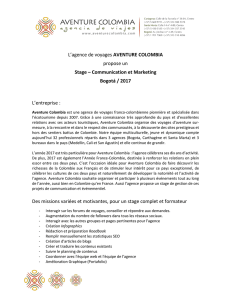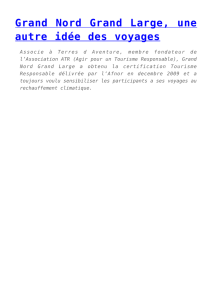Lien web - Parcours de vies dans la Royale

« L’AVENTURE » ET SES TERRE-NEUVAS
CAPITAINE DE FRÉGATE
B L A N C H A R D
“ L’AVENTURE”
ET SES TERRE-NEUVAS
efe
Editions FRANCE-EMPIRE
68, RUE J.-J.- Rousseau
PARIS

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE CENT
CINQUANTE EXEMPLAIRES SUR MARAIS
CRÈVECUR DONT DIX NUMÉROTÉS
DE 1 A 140.
CE TIRAGE CONSTITUE L’ÉDITION ORIGINALE
DE L’OUVRAGE

« L’AVENTURE » ET SES TERRE-NEUVAS
DEPART
Le 3 avril, l’Aventure appareille de Brest pour les bancs de Terre-Neuve. Les réparations ont
commencé plus tard que d’habitude et la date de départ a dû être reportée.
Il importe de tenir cette date. Par malchance, l’arsenal se met en grève, entraîné, à trois se-
maines de la fin des travaux, par un mouvement général dans le pays. Ce mouvement pourrait être un
désastre, mais la grève a pour le bâtiment une conséquence aussi heureuse qu’inattendue : dès que
l’agitation s’étend aux services publics, il est de tradition de rappeler les militaires en permission et de
les consigner dans leurs quartiers.
Tous les hommes qui passaient quelques jours dans leur famille avant le départ pour Terre-
Neuve ont donc rallié le bâtiment, une quinzaine de jours avant la date prévue.
Il ne sert à rien de prendre les choses au tragique.
Chacun se met à l’ouvrage, pour remonter, régler les appareils, et le bateau prend tournure.
Les caisses de tabac, d’eau de Cologne, d’accessoires divers, sont embarquées, arrimées en
temps voulu.
L’officier en second, cependant reste sombre. Il pleut, comme il sait pleuvoir à Brest, sans
discontinuer.
– Impossible de peindre par un temps pareil : la peinture coulerait partout.
– Tant pis, on fera les essais comme cela, sans passer de gris sur le minium.
Et c’est ainsi que les curieux qui ont le courage d’affronter les ondées sur le cours d’Ajot
voient sortir un bateau rouge qui va faire tourner ses machines dans l’Iroise.
Nous sommes rentrés tout contents. Les essais ont bien marché. Mais il pleut toujours !
On règle les compas en rade. Il pleut !
On embarque les munitions. Il pleut !
Et, en fin de compte, on peint. Il pleut !
On essaye de profiter d’un intervalle entre deux averses. Ce n’est pas joli, joli, mais, de loin,
cela peut faire illusion. On fignolera les détails plus tard.
Le 3 avril, à l’heure prévue, L’Aventure quitte son poste dans le Penfeld pour se lancer dans
l’Atlantique. Peu de spectateurs : quelques épouses de jeunes mariés le long de la rampe qui descend
au port. Les jeunes mariés n’ont pas encore osé expliquer à leur femme qu’aux postes d’appareillage
on a autre chose à faire que d’agiter des mouchoirs d’une main en tenant les jumelles de l’autre. Au
bout de quelques mois, les femmes ont compris et restent chez elle pour commencer à barrer les jours
sur le calendrier.
A bord, l’atmosphère est gaie. Chacun a conscience de la part qu’il a prise pour réaliser le
tour de force de partir au jour prévu et, intérieurement, en est tout fier.
Le Goulet : il fait assez beau.
L’Iroise : on tangue doucement.
Le large : on tangue un peu plus.
Le premier jour est occupé à « faire sa souille », à ranger le matériel, à s’adapter à ce bâti-
ment dans lequel on va vivre six mois et demi. Les anciens, ceux qui ont fait la campagne précédente,
prennent un petit air supérieur. A cause du temps habituel des bancs, mon prédécesseur les appelait les
« humeurs de brume ».
Le deuxième jour, on est installé et on commence à se sentir chez soi ; pas tous, car la houle
a grossi, le bâtiment « tosse » assez fort. Il a son grand plein de mazout et d’eau ; lourdement, il fend
la mer en tombant dans les creux, et le dévers de la plage avant l’arrête d’un coup de battoir sec dans
la lame. De la passerelle, j’examine la mer ; j’ai pris le commandement de L’aventure il y a à peine
un mois et je la regarde réagir à la houle. Je cherche à prévoir les coups. L’officier en second monte et
vient s’accouder près de moi.

DÉPART
– Ça va, en bas ?
– Ça va très bien ; évidemment, les jeunes sont malades …
– Evidemment.
– Cela se tassera d’ici un jour ou deux.
Le lendemain, le temps est le même.
– Ça va, en bas ?
– Moins de malades ; il s’habituent. Au carré, il y a le midship et le médecin.
Le médecin malade … c’est une nouvelle qui a le don de mettre le personnel en joie.
Pourtant, lorsque, le quatrième jour, on s’aperçoit que tout le monde est guéri, que le temps
s’arrange un peu, on ne rit plus. Il faut bien se rendre compte de l’évidence. Le médecin souffre terri-
blement du foie : il a établi lui-même son diagnostic ; piètre consolation, car il s’affaiblit et son état ne
s’améliore pas.
Ne pouvant le garder ainsi, je décide de faire route directement vers Saint-Jean de Terre-
Neuve pour le mettre entre les mains d’un confrère.
Le 9 avril, nous entrons dans la brume. Les « humeurs de brume » sont là et (on y voit à
peine à deux cents mètres) murmurent d’un petit air détaché que ce n’est pas de la vraie, qu’on verra
mieux, etc. …
Le 11, on n’y voit pas à cent mètres ; Les « humeurs de brume » nous concèdent que, cette
fois, c’est du sérieux. On s’en sent tout fier… comme s’il y avait de quoi flatter l’amour-propre !
Tout de même, L’Aventure, sans médecin, ne serait pas bonne à grand-chose. J’envoie donc
un télégramme au gouverneur des îles Saint-Pierre et Miquelon pour lui demander s’il peut nous prêter
un des deux médecins coloniaux de Saint-Pierre, en attendant que le nôtre soit guéri … ou remplacé.
Il me répond immédiatement qu’il accepte.
Saint-Jean de Terre-Neuve est à quelques milles. On voit la côte au radar. On distingue
même la passe si étroite. 1.000 mètres :
– En avant lentement.
400 mètres :
– Stoppez.
Sur l’avant, il y a des veilleurs qui annoncent :
– Brisants droit devant.
– En arrière demi.
Je les vois ; leur lueur blanche, dans la brume, les fait paraître tout près.
– En arrière toute.
Nous commençons à culer.
– Stoppez. En avant lente.
– Brisants droit devant.
– En arrière demi.
– Stoppez.
Maintenant, c’est le bord Sud.
C’est terriblement étroit. Nous venons un peu à droite.
– En avant lentement.
– Brisants à bâbord et à tribord.
Cette fois-ci, ce n’est pas droit devant. On peut y aller. D’ailleurs, voila le pilote qui arrive
enfin. Il y a aussi de la brume dans le port, ce qui est une malchance insigne, car, d’habitude,
quelle que soit l’épaisseur du « coton » dehors, il y fait clair.

« L’AVENTURE » ET SES TERRE-NEUVAS
On s’amarre tout de même. Dès l’arrivée, le consul monte à bord, puis un officier canadien
vient nous souhaiter la bienvenue et semble sincèrement navré quand je lui dis que nous allons repar-
tir. Le médecin est envoyé à l’hôpital.
Le commissaire profite de l’escale pour acheter quelques vivres frais, des fruits en particu-
lier. Dans l’après-midi, le médecin canadien vient à bord ; il n’est pas du tout rassurant sur l’état
du nôtre et nous dit que, de toute façon, nous ne pouvons pas espérer le réembarquer avant plusieurs
semaines. Le soir, nous partons pour Saint-Pierre où nous arriverons le lendemain au début de l’après-
midi. Et, dès que nous sommes sortis des passes, nous réclamons à Paris un autre médecin qui devra
rallier Saint-Jean par avion.
A Saint-Pierre, nous arrivons naturellement par brume. Le médecin–capitaine Bourlaud, des
troupes coloniales, très content de cette diversion à son existence insulaire, arrive à bord. Nous profi-
tons de l’occasion pour laisser à terre notre doris, qui doit être réparé ; il a été un peu malmené par la
mer et nous empruntons celui de l’Inscription maritime.
A la fin de l’après-midi, nous repartons.
J’écris sur mon bloc :
13 avril. – Arrivée sur les bancs. – Mauvais temps. – Vent N.-E. force 8. – Houle d’ouest 4
à 5 mètres forçant. A la cape – le bateau « tosse ».
Et voilà, c’est commencé ; cela va être notre vie pendant six mois.
Bourlaud, sur la passerelle est souriant ; il « étale » comme un vieux marin.
Le lendemain, le temps est un peu meilleur : c'est-à-dire qu’il y a de la brume dès le matin.
Nous voyons cependant quatre chalutiers dans l’après-midi.
Le lendemain, nous voyons six chalutiers, puis nous faisons route sur le Platier, au sud des
bancs. Le 16 avril, nous mouillons près du Lieutenant–René–Guillon =, de Saint-Malo, le seul voi-
lier français à Terre-Neuve.
Le médecin décide de garder à bord un malade, et le Guillon appareille pour changer de
mouillage.Une demi-heure après, il revient : un de ses hommes est tombé dans la cale. Il a une vilaine
plaie à la tête. Le docteur le garde à l’hôpital du bord.
Le 17, mauvais temps. Nous prenons cependant encore un blessé d’un chalutier.
Le 18, grosse houle. Nous pouvons pourtant porter à un chalutier un de ses hommes qui,
malade, avait manqué le départ de France, et que nous avions pris à Brest.
Le 19, route sur Saint-Pierre, où nous arrivons le 20.
Nous en repartirons le 23 et, en passant devant Saint-Jean, nous reprendrons notre nouveau
« toubib », le médecin de première classe Raveleau.
Nous avons commencé notre mission.
Quelle est-elle exactement ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
1
/
177
100%