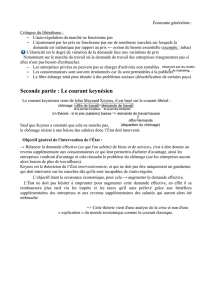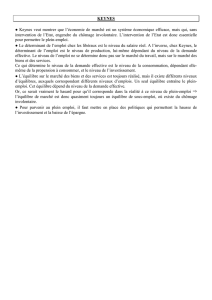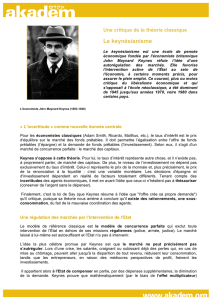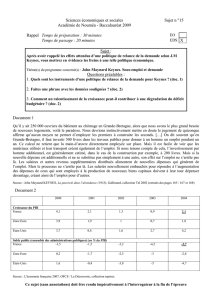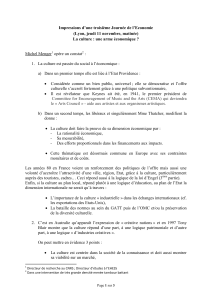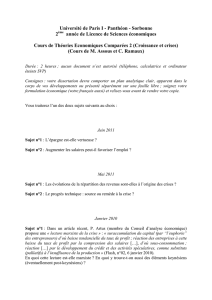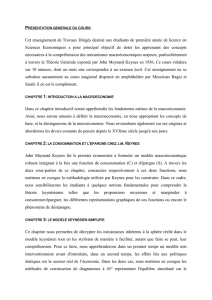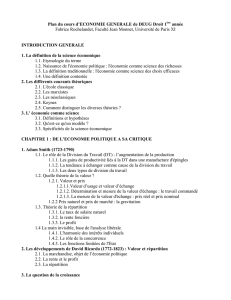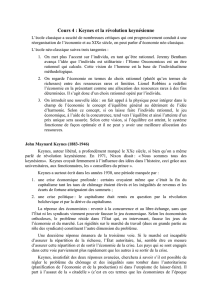Note critique L`énigmatique retour de Keynes Thierry Pouch

1
Paru dans la revue L’Homme et la Société
numéro 156 (2006)
Note critique
L’énigmatique retour de Keynes1
Thierry Pouch
ans leur empressement à asseoir leur domination sur la science économique et à
évacuer toute trace de keynésianisme tant dans les analyses théoriques que dans
les pratiques de politique économique, les théoriciens néo-classiques avaient
indiqué, à l’instar du Lauréat du Prix Banque de Suède en Sciences économiques en la
mémoire d’Alfred Nobel, R. E. Lucas, que la lecture de l’œuvre de Keynes et de la Théorie
générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie en particulier, était inutile, superflue,
risquant de détourner l’étudiant des vrais enjeux de la science économique. Cette offensive
menée contre Keynes et ses recommandations de politique économique a pourtant été, depuis
plus de vingt-cinq ans, largement discréditée. Le renoncement à toute forme
d’interventionnisme étatique dans les mécanismes économiques à des fins de régulation ne
s’est pas généralisée. Les pratiques keynésiennes de politique économique sont toujours en
vigueur et l’on peut de trois façons le démontrer. On sait en effet que la croissance de
l’économie américaine a reposé, sous l’impulsion de R. Reagan et de ses successeurs, sur une
politique économique expansionniste, expliquant le différentiel actuel de croissance avec la
zone euro. L’impulsion budgétaire au Japon constitue une preuve supplémentaire de la
persistance de l’esprit de Keynes dans l’usage des outils de politique macroéconomique.
Enfin, le non respect du critère de Maastricht par certaines économies de la zone euro, critère
selon lequel le déficit public ne doit pas dépasser 3% du Produit Intérieur Brut (PIB), apporte
la démonstration que le recours aux pratiques, directes ou indirectes, de soutien de l’activité
demeure vivace, et sans lequel le taux de croissance du PIB de la zone, déjà bien faible, serait
1 Les échanges de points de vue que j’aie eus avec R. Sobel (Université de Lille I et CLERSE), ont été d’un réel
apport pour établir cette note critique. Qu’il en soit chaleureusement remercié.
D

2
dans l’abîme, entraînant une explosion du chômage dans les sociétés industrialisées au-delà de
ce qu’elles connaissent depuis trente ans. Qu’en est-il de la théorie économique ?
Cette présence de Keynes et du keynésianisme, certes très en-deçà de ce que l’on a connu
durant la période, disons mythique, des « Trente glorieuses », où étaient associés croissance
élevée et plein emploi, contraste avec son effacement dans les cursus universitaires. De
dominante dans l’université au début de la décennie soixante, au point que même un
économiste comme Milton Friedman, pourtant farouchement hostile à Keynes, avait pu
déclarer, que désormais, « nous sommes tous keynésiens », la théorie de Keynes est devenue
dominée, au même tire d’ailleurs que bon nombre d’écoles se réclamant d’une démarche
hétérodoxe. Un enquête auprès des étudiants français montrerait que fort peu d’entre eux ont
lu, ou ont eu à lire, depuis leur entrée en première année de science économique, ne serait-ce
qu’un chapitre de la Théorie générale.
En fait, les controverses et réactions suscitées par la publication en 1936 de la Théorie
générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, réactions qui se sont organisées dès 1947
principalement autour de F. V. Hayek fondateur de la Société du Mont Pèlerin, n’auront
jamais cessé, pour finalement aboutir à une espèce d’éradication de la pensée de Keynes, ou
du moins à son discrédit. Et pourtant, Keynes demeure une figure emblématique de la pensée
économique contemporaine. L’éradication de cette pensée du champ de la science
économique contemporaine n’a été que partielle. Pour les générations antérieures, l’auteur du
Treatise on Money est indissociable de la profonde mutation qu’a connue le capitalisme à
partir des années trente. Son nom est associé à la croissance et au plein-emploi, et peut-être
abusivement, à une « révolution », au sens épistémologique du terme, la célèbre « révolution
keynésienne ».
Deux ouvrages récents reviennent sur l’homme et sur sa théorie économique. On pourrait
interpréter ces nouveaux regards sur Keynes comme des expressions d’une nostalgie
déroutante étant donné le degré d’ouverture des nations dans la globalisation économique.
Déroutante tout d’abord parce que la globalisation aurait rendu obsolète toute tentative de
mener isolément une politique économique d’inspiration keynésienne. En raison ensuite de
l’absence de clarté d’une théorie économique, des nombreuses contradictions qui la jalonnent,
rendant difficile et du coup fort peu convaincante la lecture de la Théorie générale, aux dires
des adversaires de Keynes.
Les deux ouvrages de Gilles Dostaler et de Franck Van de Velde, bien que se situant sur
des registres différents, se rejoignent sur un objectif : réhabiliter la théorie de Keynes dans un

3
contexte économique et politique qui selon eux s’y prête2. Selon G. Dostaler, les inégalités, la
destruction de l’environnement, la faiblesse de la croissance, le chômage, indicateurs des
effets d’une libéralisation outrancière des sociétés gérées par le tout marché, rendent une
actualité à l’auteur de La fin du laissez-faire. Actualité dont F. Van de Velde souligne
l’urgence au regard de l’évolution de la construction européenne, laquelle repousse depuis
plusieurs décennies toute perspective de création « d’un espace de gestion politique de la
demande globale, dans le cadre duquel les instruments monétaires, fiscaux, budgétaires et
autres d’une politique de plein-emploi retrouveraient leur pleine efficacité » (page 212).
Deux ouvrages complémentaires donc, tant le premier s’attache à mettre en relief
l’homme, tandis que le second entend réaffirmer le caractère révolutionnaire de la théorie de
Keynes, révolution prise au sens de Kuhn. Examinons les deux démarches en les soumettant à
une critique, car la réhabilitation de Keynes interpelle l’économiste, notamment lorsqu’il
s’agit de se prononcer sur l’émancipation des individus. Que peut-on attendre de Keynes
aujourd’hui ?
Deux livres à lire ou la fascination exercée par Keynes
Inviter à une lecture de ces deux ouvrages n’est pas de pure forme, réductible à un exercice
académique soulignant les mérites de travaux universitaires et qui trouverait place dans la
rubrique des notes de lecture d’une revue d’économie. Il s’agit de deux ouvrages qui livrent
des informations précieuses à la fois sur un personnage, sa vision du monde et sur son
approche de l’activité économique au travers d’une théorie. Et d’ailleurs, on ne peut que
recommander d’enclencher l’investigation sur Keynes par la lecture du travail de G. Dostaler.
G. Dostaler n’est certes pas le premier historien de la pensée économique à livrer une
biographie intellectuelle de l’économiste anglais J. M. Keynes. Il rappelle d’ailleurs quelques
figures de l’économie ayant consacré des efforts soutenus pour dresser un portrait complet de
Keynes, parmi lesquelles Skidelsky, producteur de trois volumineux tomes sur ce sujet. G.
Dostaler inscrit selon nous sa recherche dans une dimension ayant trait à l’histoire sociale
d’une doctrine économique, celle de Keynes. En cela, le livre ne pourrait prendre place dans
un pur registre d’histoire de a pensée économique, mais plutôt dans celui de l’histoire des
idées. Cette posture intellectuelle est suffisamment rare en économie, discipline ayant la
fâcheuse tendance à ne considérer son histoire que sous l’angle d’une succession linéaire de
2 G. Dostaler [2005], Keynes et ses combats, éditions Albin Michel, coll. « Bibliothèque Histoire », et F. Van de
Velde [2005], Monnaie, chômage et capitalisme, Presses Universitaires du Septentrion, coll. « économie
retrouvée ».

4
théories, oubliant que les auteurs et leurs doctrines sont indissociables d’un contexte
historique, social, politique, autant que scientifique. Et G. Dostaler a raison d’indiquer assez
rapidement que la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, si elle peut
certes être appréhendée comme un aboutissement des recherches antérieures de Keynes, ne
saurait être comprise sans une connaissance intime de l’individu Keynes, de sa vie privée, de
ses amitiés, de sa vision du monde, de ses attaches philosophiques, ainsi que des diverses
professions occupées. En ce sens, l’ouvrage de G. Dostaler devrait être entre les mains de tous
les étudiants en sciences économiques dans la mesure où ils y puiseraient des informations
utiles sur le processus de production du discours scientifique.
De même, et là encore l’auteur se distingue habilement de ses collègues historiens de la
pensée économique, toute investigation sur ce personnage illustre doit nécessairement faire un
détour par l’Angleterre de la fin du dix-neuvième siècle afin de débusquer les motivations
profondes, pas forcément apparentes lors de la lecture de la Théorie générale, ayant conduit
Keynes à écrire ce qu’il a écrit. C’est pourquoi G. Dostaler a inséré une brève mais utile
histoire politique de l’Angleterre de la fin du dix-neuvième siècle vis-à-vis de laquelle de
nombreux intellectuels, amis ou proches de Keynes, ont pris position. Mais là n’est
probablement pas l’essentiel. Ce qui, à la lecture du livre, apparaît décisif, c’est la formation
de la pensée de Keynes au contact du groupe de Bloomsbury, dont les conceptions et les
aspirations de ses membres ont pu orienter le regard que Keynes porta sur les affaires
humaines. De ce point de vue, les échanges permanents de Keynes avec le groupe de
Bloomsbury, les débats qu’il a eus avec des personnalités aussi importantes que Wittgenstein,
ou ses conversations avec Virginia Woolf, et ses collègues économistes, dévoilent un homme
sans doute plus proche de la philosophie et de l’art que de l’économie, position
congénitalement étrangère aux analyses des économistes purs. Et c’est bien ce profil
intellectuel de Keynes qui semble autant fasciner G. Dostaler, dont on connaît par ailleurs les
nombreux articles livrés depuis de longues années sur cet auteur. G. Dostaler fait en effet
partie de ces économistes qui ne se résolvent pas à admettre sans discussion que l’économie
est une science. Keynes a produit avant tout une Weltanschauung, reposant sur des
« fondements éthiques et épistémologiques conduisant à une remise en cause de la
scientificité d’une discipline économique considérée comme autonome » (page 451).
Mais G. Dostaler a également le grand mérite de tordre le cou à cette légende faisant de
Keynes le grand architecte du plein-emploi d’après-guerre. La vérité est autre. Elle réside
dans le fait que la Théorie générale de l’emploi de l’intérêt et de la monnaie n’a été que la
traduction théorique de pratiques de politique économique engagées dès les années trente aux

5
États-Unis, et en Europe ensuite, notamment avec le Plan Marshall. C’est donc bien la guerre
qui fut à l’origine du plein-emploi. Mais G. Dostaler rappelle que c’est dans cette attitude
contestataire vis-à-vis du monde que l’on peut trouver l’orientation prise par Keynes, et pas
seulement en économie. Les pages sur sa morale, sa lecture des questions sexuelles, son
rapport à l’art, à l’argent, ses angoisses relevant de la psychanalyse, sont à cet égard
savoureuses, et permettent de réaffirmer que l’économiste, sous ses modèles théoriques, n’en
est pas moins un homme.
Du coup, placé devant autant de riches informations, l’économiste se laissera prendre au
piège que semble lui tendre G. Dostaler, à savoir que l’économie, dans le tumulte du monde,
doit nécessairement passer au second plan des préoccupations des hommes.
L’ouvrage de F. Van de Velde s’inscrit, on l’a dit, dans un autre registre, celui de la théorie
de Keynes, qu’il oppose aux théories classique et néo-classique. Ouvrage qui rebutera le non
initié, malgré l’effort de pédagogie fourni par l’auteur, en raison d’une approche très
théorique qu’accompagne un recours à une formalisation mathématique pourtant abordable.
Mais justement, l’ouvrage de F. Van de Velde apparaît complémentaire à celui de G.
Dostaler, en ce sens que, si ce dernier offrait l’opportunité d’en savoir davantage sur le
personnage de Keynes, de resituer sa théorie économique dans une perception générale du
monde, celui de l’économiste de l’Université de Lille I constitue un examen fouillé de la
théorie économique de Keynes, qui pourrait prétendre au statut de « manuel d’économie
keynésienne », si cette appellation n’avait pas été si galvaudée. L’idée de ramener le travail de
Van de Velde à un « manuel d’économie keynésienne » aurait de quoi surprendre, car la fin
du livre indique en effet qu’un retour à l’économie de Keynes et aux principes de politique
économique qu’il avait suggérés d’appliquer dans le dernier chapitre de sa Théorie générale,
serait salutaire pour une Union européenne en panne de croissance, exposée à un chômage de
masse, et n’ayant que la privatisation des forces de l’économie comme horizon. C’est parce
que la théorie de Keynes, son apport à la science économique n’a pas été véritablement
intégré, dit F. Van de Velde, qu’un retour à son message s’impose. Car s’il y avait eu
véritablement intégration de ce message au corpus de la théorie économique contemporaine,
« le retour à Keynes pourrait être réservé aux historiens de la pensée économique « (page 14).
L’ouvrage est donc davantage qu’un manuel, puisqu’il suggère de revenir sur les
« fondamentaux » de la théorie de Keynes.
Ce qui fait l’originalité du travail de F. Van de Velde réside dans l’approche comparative
qu’il établit entre d’un côté « l’économie réelle de production » propre au système ricardien,
« l’ économie réelle d’échange » des néo-classiques, et « l’économie monétaire de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%