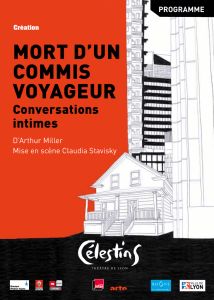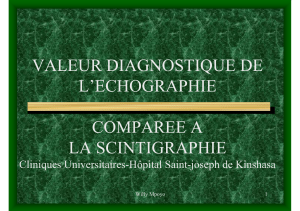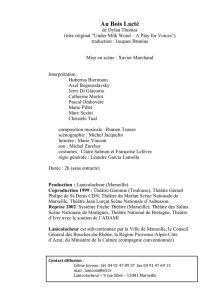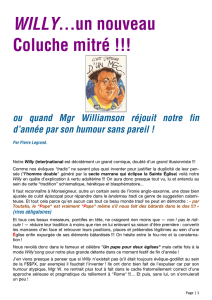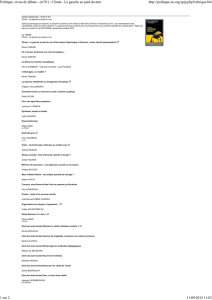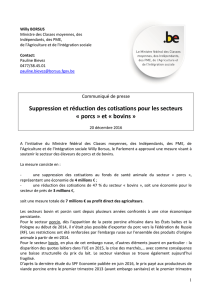MORT D`UN COMMIS VOYAGEUR

Du 5 au 31 octobre 2012
MORT D’UN
COMMIS
VOYAGEUR
Conversations intimes
D’Arthur Miller
Mise en scène Claudia Stavisky
CONTACT :
Marie-Françoise Palluy
04 72 77 48 35
Vous pouvez télécharger les dossiers pédagogiques et photos des spectacles sur notre site
www.celestins-lyon.org
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

2
MORT D’UN COMMIS VOYAGEUR
Conversations intimes
D’ARTHUR MILLER
MISE EN SCÈNE CLAUDIA STAVISKY
AVEC
François Marthouret –
Willy Loman
Hélène Alexandridis –
Linda Loman
Alexandre Zambeaux –
Biff Loman
Matthieu Sampeur –
Happy Loman
Mickaël Pinelli –
Bernard
Valérie Marinese –
La femme
et
Mademoiselle Forsythe
Jean-Claude Durand –
Charley
Sava Lolov –
Ben
et
Howard Wagner
Judith Rutkowski –
Jenny
et
Letta
Mathieu Gerin –
Stanley
Texte français : Claudia Stavisky
Scénographie : Alexandre de Dardel assisté de Fanny Laplane
Lumières : Franck Thévenon
Costumes : Agostino Cavalca
Musique originale : Jean-Marie Sénia
Son : Sylvestre mercier
Assistant à la mise en scène : Mathieu Gerin
Régisseur général : Robert Goulier
Production : Célestins, Théâtre de Lyon, avec le soutien du Département du Rhône.
Représentations dans le département du Rhône :
Chassieu, Le Karavan Théâtre
14, 15 et 16 novembre à 20h
Mornant, Espace culturel Jean Carmet
22 et 23 novembre à 20h

3
SOMMAIRE
MORT D’UN COMMIS VOYAGEUR
5
ARTHUR MILLER 6
INTRODUCTION À
MORT D’UN COMMIS VOYAGEUR
9
CLAUDIA STAVISKY 14
ENTRETIEN AVEC CLAUDIA STAVISKY 15
CIEL DE PARPAINGS - NOTE SUR LA SCÉNOGRAPHIE 19
PANORAMA DU THÉÂTRE AMÉRICAIN DE 1940 À 1970 21
LE FILM
DEATH OF A SALESMAN
23
MORCEAUX CHOISIS 25
CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS 30

4
© Christian Ganet

5
MORT D’UN COMMIS VOYAGEUR
Tout commence par un banal accident de voiture. Pour Willy Loman, commis
voyageur qui passe ses journées à sillonner les routes et vit dans l’illusion du self-
made man accompli, c’est le premier signe de la déroute de sa vie réelle. Celui qui,
afin d’assurer sa réussite et son bonheur familial, a tout misé sur son acharnement
au travail avec une foi absolue dans les valeurs d’une société basée sur l’argent et la
compétition, va peu à peu voir ses certitudes vaciller.
Par ailleurs, ses espérances de père sont déçues : Biff, le fils de toutes ses
espérances, vit de petits métiers dans l’Ouest et n’arrive pas à se fixer. De retour
après une longue absence, il vit lui aussi un sentiment d’échec, tout comme son frère
Happy, insatisfait malgré tous les prétendus succès professionnels et surtout
féminins dont il se vante. Linda, la femme de Willy, fait preuve d’un inconditionnel
soutien envers son mari, dont elle seule devine les pensées noires. C’est avec son
épouse tragiquement aimante que Willy peut se dévoiler dans toute sa faiblesse,
mais c’est aussi contre elle qu’il libère la hargne née de ses frustrations.
Après s’être vu retiré son fixe, il perd son emploi, et se retrouve dans l’impossibilité
de payer ses traites. De désillusions en désillusions, il se retrouve confronté à
l’évidence de son échec à vivre le fameux « rêve américain ».
Ce chef-d’œuvre d’Arthur Miller n’a jamais semblé aussi actuel. Tragédie d’un héros
ordinaire dépassé par un monde qu’il ne comprend plus, sacrifié par l’entreprise
pour laquelle il a travaillé toute sa vie et hanté par le déclassement social de sa
famille, la lecture de ce texte visionnaire nous renvoie à une réalité tristement
banale aujourd’hui.
C’est de cette modernité, bien plus que d’un monument théâtral de l’Amérique
d’après-guerre, que Claudia Stavisky s’empare pour creuser le sillon de son travail
de création : celui de la mise en scène du dérèglement. Au-delà de la critique du rêve
américain, c’est la tension entre l’abstraction du capitalisme et la réalité quotidienne
de ceux dont les destins basculent, entre les dysfonctionnements d’un idéal de
société et l’intimité d’êtres en proie aux doutes, qu’elle met en lumière. Sans
exonérer, ni diaboliser les protagonistes de cette faillite annoncée, l’enjeu consiste à
en restituer le visage humain et sensible.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%