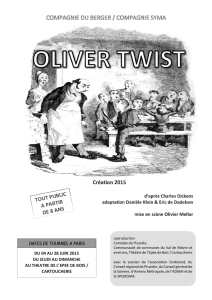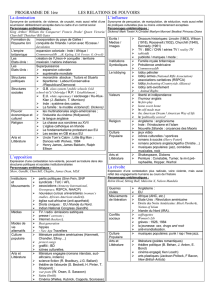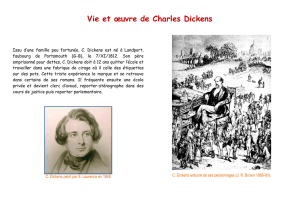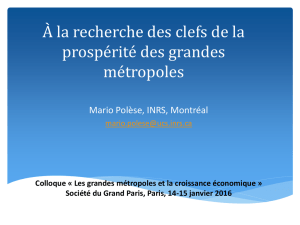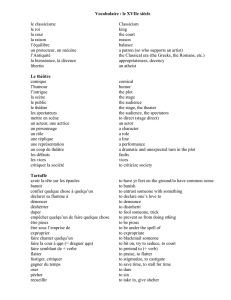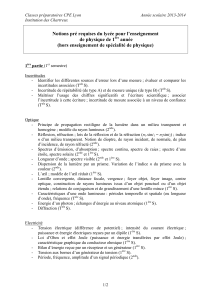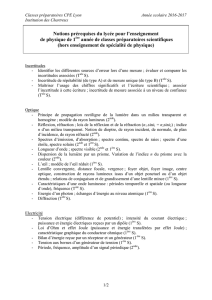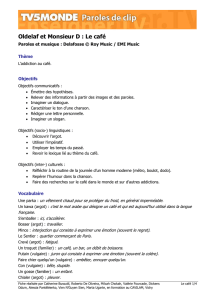31 lanone 2

Catherine Lanone, « De The Frozen Deep à A Tale of Two Cities : la transposition de
l’espace théâtral », Cercles 31 (2013) : 5-20.
DE#THE#FROZEN)DEEP)À#A)TALE)OF)TWO)CITIES#
!"#$%"&'()'*$*)&#+,#!-,'(".,#$/,"$%"!#
#
##
CATHERINE#LANONE#
!"#$%&'#()*+,&#'*-./0&10""%*203$%44%*
#
+012# 5* 6,4%* 07* 680* 9#(#%'3# +456712# 789:;<7# :0# =4>7124;1# 2975?05@:04<7# =7#
:-/42?;4<7# 7?# =7# :0# <AB;:@?4;1# C<01D0427E# $7::7# 72?# 71# 7CC7?# :-@17# =72#
50<05?A<42?4F@72#410??71=@72#=7#:0#$7<<7@<3#:0#9;224G4:4?A#=@#5;@9#=7#?HAI?<7#
2@<#:-A5H0C0@=E#+0147:#J;<=;1#5;>90<7#:7#502#=7#+01?;1#C057#K#:0#L@4::;?417#
0B75#:-789A<47157#=@# 50>9#=7#5;1571?<0?4;1#?7::7#F@7#:0#=A5<4?#(<4>;#!7B4E#
+012# :7# =7@84M>7# 5023# :7# ?<0@>0?42>7# <72?7# =7# :-;<=<7# =7# :-41=454G:7# 7?# =7#
:-41H@>041N# 09<M2# :72# O0L;12# K# G72?40@83# 4:# 1-P# 0# 1@:# ?A>;41# =7# 57# F@4# 27#
90227# =012# :0# 5H0>G<7# K# L0Q3# :-0L;147# ?75H1;:;L4F@7>71?# =A?7<>41A7# 72?#
7CC05A73#:0#B45?4>7#1;1#27@:7>71?#01A01?47#>042#>427#0@#24:7157E#!0#>427#71#
90L7# 17# 97@?# 27# C04<7# F@7# =012# :7# 502# =-@1# 2@<B4B01?3# 5;>>7# !7B43# F@4# 0#
<A5H099A#K#:0#:#'%*%"*';<"%E#"@#5;1?<04<73#=012#:7#9<7>47<#5023#+01?;1#97@?#
5H01?7<#@17#5H012;1#=AC401?#2;1#G;@<<70@3#L0<=7<#@17#2?0?@<7#HA<;RF@73#5-72?#
>S>7# :7# >;>71?# =7# :-78A5@?4;1# F@4# C;15?4;117# 5;>>7# ABA17>71?#
97<C;<>0?4C#L0<01?42201?#57??7#2?0?@<7E#,1#41B71?01?#:7#2975?05:7#=-@17#>;<?#
>;=7<142A73# F@4# B7@?# 2P>G;:427<# :0# 5;@9@<7# 0B75# :-"15471# %AL4>73# :0#
%AB;:@?4;1# =429;27# 0B75# :0# L@4::;?417# =-@1#412?<@>71?3# =012# @17# 57<?0417#
>72@<73#K#=;@G:7#?<015H01?3#9@42F@-4:#;CC<7#K#:0#B45?4>7#@1#729057#=7#5;1?<7T
41?7<97::0?4;1#?HAI?<0:#U#
$H7#L@4::;?417#O02#414?40::P#=724L17=#02#01#7F@0:#01=#9041:722#>7012#?;#
7875@?4;13#G@?#41#?H7#9@G:45#2F@0<7#4?#;C?71#G750>7#2;>7?H41L#>;<7V0#
2?0L7#9<;93#?H7#G056L<;@1=#?;#24:71?#=42271?#789<7227=#?H<;@LH#0#2;1L3#
W;67# ;<# 24:71?# 201L# C<;4=E# $H7# 2?0L41L# ;C# B4;:7157# 41# ?H7# X<715H#
<7B;:@?4;1# ?H@2# ;9717=# 0# 29057# 41# OH45H# ?H7# B45?4>2# 5;@:=# 97<C;<>E#
$H7#0@?H;<4?472#5;@:=#1;?#C02H4;1#?H7>27:B72#G7C;<7#0#9@G:45#O4?H;@?#
L4B41L#?H7#B45?4>2#2;>7#25;97#?;#=;#2;#02#O7::E#YJ)%+)&#U#Z[\]#
.-72?#57??7#=4>7124;1#?HAI?<0:7#2975?05@:04<73##"*,&(#;340*:0&(#'3#F@7#+456712#
97<D;4?#=-412?415?#7?#=;1?#4:#2-7>90<7#=012#5*6,4%*07*680*9#(#%'3#9;@<#71#C04<7#
:7#5^@<T>S>7#=@#<;>013#9;41?#=-;<L@7#=7#:-09<M2T5;@9#;@#9;41?#5@:>4101?#
_;4#:,=`# =-;a# :-;1# 97@?# =A<;@:7<# :0# 97<2975?4B7# =72# ?7>92# C@?@<2# 71#
L<0B42201?#:72#F@7:F@72#>0<5H72#F@4#>M171?#0@#1A01?E#(;@<#>47@8#97<57B;4<#
:7#5H7>417>71?#?HAI?<0:#=@#<;>013#1;@2#010:P27<;12#G<4MB7>71?#F@7:F@72#
7CC7?2# =7# ?HAI?<0:4?A3# 9;@<# <7B714<# 9:@2# :;1L@7>71?# =012# @1# 275;1=# ?7>92#
Cercles 31 (2013)

Catherine Lanone / 6
2@<# :-0B01?T?78?73# :0# 94M57# =7# ?HAI?<7# 6>%* ?&0@%"* A%%B#_=@<01?# :0F@7::73# 2@<#
25M173#+456712#5;1D@?#:7#9<;W7?#=@#<;>01`3#0B01?#=-789:;<7<#:0#>014M<7#=;1?#
:0#H01?427#=@#50114G0:42>7#41294<7#:72#>A?09H;<72#=7#5*6,4%*07*680*9#(#%'E##
)
Un)roman)théâtral)
"11P# '0=<41# 2;@:4L17# K# F@7:# 9;41?3# =012# 5* 6,4%* 07* 680* 9#(#%'C* :0#
b#<7227>G:0157# =72# =7@8# HA<;2# 72?# 2;@<57# =7# >A9<4272# 7?# =7# 5;@92# =7#
?HAI?<7#c# Y'"+%*&#U# de]3# 57# F@4# <ABM:7# :0# b#?HAI?<0:4?A# =-41?71?4;1# 7?# =7#
5;1579?4;1#c# YdZ]# 9@42F@73# ?01=42# F@7# :7# 50=<7# H42?;<4F@7# 78057<G7# :0#
9;?71?40:4?A# ?HAI?<0:7# =@# W7@# 2@<# :0# <7227>G:0157E# 5* 6,4%* 07* 680* 9#(#%'*
>@:?49:47# :72# >;>71?2# ;a# :7# =429;24?4C# W@=45404<7# 72?# =AB;PA# 71# 2975?05:7E#
!;<2#=@#9<7>47<#9<;5M23#71#"1L:7?7<<73#:72#<7L0<=2#2;1?#<4BA2#2@<#:-055@2A#U#
f,0L7<# C0572# 2?<0417=# <;@1=# 94::0<2# 01=# 5;<17<23# ?;# L7?# 0# 24LH?# ;C# H4>#N#
2975?0?;<2#41#G056#<;O2#2?;;=#@93#1;?#?;#>422#0#H04<#;C#H4>-#Y5*6,4%*07*680*
9#(#%'#U# gh]#N# 0B75# :-7>9H027# 9<;9<7# K# +4567123# :0# 9H<027# 27# 9;@<2@4?# 7?#
2-;@B<7#2@<#:-780LA<0?4;13#:-729057#20?@<A#=7#L712#=7G;@?3#2@<#:0#9;41?7#=72#
947=23#2-099@P01?#2@<#?;@?#7?#2@<#<471#9;@<#27#H4227<#0@T=722@2#=72#A90@:72#
=72#0@?<72#7?#:-097<57B;4<E#'7@:#:-055@2A#<72?7#=4L173#0??71?4C#7?#?<01F@4::73#f1;<#
022@>7=# 01P# ?H70?<450:# 04<# 41# 4?-# Yge]E# $HAI?<0:73# 71# <7B015H73# :0# 9:04=;4<47#
:-72?#K#2;@H04?3#F@-4:#2-0L4227#=7#:-0B;50?#LA1A<0:#_F@4#=A5:0>7#:-055@20?4;1#0@#
<P?H>7#=-@1#0109H;<4F@7#f?H0?-#?;14?<@01?3#5;15:@01?#HP97<G;:4F@7>71?#2@<#
:-4>0L7#=7#:0#?S?7#2@<#:-;<74::7<#=7#5H0F@7#"1L:0423#F@4#17#27<0#71#2A5@<4?A#F@7#
:;<2F@-;1# 0@<0# 5;@9A# 57::7# =@# 9<42;1147<`3# ;@# =7# :-0B;50?# =7# :0# =AC7127E#
+456712# =<0>0?427# :-7CC7?# =-A1;1540?4;1# 71# 27# =42971201?# =7# ?4<7?2# ;@# =7#
L@4::7>7?23#9:;1L701?#:7#:75?7@<#=012#:7#W7@#=7#F@72?4;12T<A9;1272#24>@:01?#
:-;<0:4?A3# =;1101?# K# 4>0L417<# :72# 7CC7?2# =7# >015H7# =7# '?<PB7<E# !0# 20:B7# =7#
F@72?4;12# =7B471?# @1# ?4<# 1;@<<43# :72# <A9;1272# =7# i0<20=# 27# <A=@4271?# K# =7#
>04L<72# =A1AL0?4;123# 20@C# :;<2F@-4:# 0CC4<>7# F@-4:# 0# 97@?TS?<7# G471# <7D@# @1#
5;@9#=7#947=#W0=423#>042#F@-4:#0#=AB0:A#:-7250:47<#=7#2;1#9<;9<7#L<AE#+456712#
099:4F@7# 0B01?# :0# :7??<7# :0# =AC414?4;1# =@# <4<7# 27:;1# i7<L2;13# :7# >A5014F@7#
9:0F@A#2@<#:7#B4B01?3#9;@<#C04<7#=7#57#>;>71?#@1#=@;#5;>4F@7E#
"#(0<423#5-72?#?;@?7#:0#B4::7#F@4#72?#5;1?0>41A7#90<#:7#9<;5M2#N#?;@?#1-72?#F@7#
=A1;1540?4;1# 9;?71?47::7# 7?# :7# 2975?05:7# =7# :0# B4;:7157# 27# :4?# 0@# =A?;@<# =72#
<@723#C0<01=;:7#41F@4A?01?7#=7#:0#.0<>0L1;:7#;@#24>9:7#50<10B0:#4<<0?4;117:#
7?#4<<A9<7224G:73#:;<2F@7#:72#=7@8#H;>>72#F@4#?;@<171?#:0#947<<7#K#04L@427<3#
1;@B7::7# <;@7# =7# :0# C;<?@173# 2;1?# 241L@:4M<7>71?# 0CC@G:A2# =7# C0@2272#
>;@2?05H72# 7?# 5;@B7<?2# =7# 201L# 5;>>7# =72# C0@B72# YZ[e]E# ,?# :72# 9<;5M2# 27#
W;@71?# 7?# 27# <7W;@71?# 2012# =425;1?41@7<3# =;@G:72# 41B7<2A2# =@# 9<;5M2#
:;1=;14713# 27:;1# @1# 25A10<4;# ?HAI?<0:# 9<AB424G:7# 7?# >;1;5;<=7E# (0@:#

Catherine Lanone / 7
X<47=:01=# 0??4<7# :-0??71?4;1# 2@<# :0# <75<@=7257157# =7# :-71L;@7>71?# 9;@<# :7#
?HAI?<7#=@<01?#:0#<AB;:@?4;13#>042#0@224#2@<#:0#?HAI?<0:4?A#=7#:0# 9;:4?4F@73#K#
5;>>7157<#90<#:0#.;1B71?4;1#7?#:7#.;>4?A#=7#'0:@?#(@G:453#7?#2@<#:-A?<01L7#
G<;@4::0L7#=7#57#=429;24?4C#2;@>42#K#:0#9<7224;1#=7#:0#C;@:73#F@4#B471?#<;>9<7#
:7# j7#>@<# =7# :0# >427# 71# 25M17# ?HAI?<0:7# _57# >@<# F@4# 2A90<7# :72# 05?7@<2# =@#
9@G:453#5-72?TKT=4<7#:7#L;@B7<17>71?#;@#:7#?<4G@10:#=7#:0#C;@:7`#9;@<#>;1?7<#
2@<# 25M17# 7?# 4>9;27<# 20# B;:;1?AeE# .-72?# 57# 9;@B;4<# =@# 9@G:45# F@-789:;<7#
+4567123# K# ?<0B7<2# 57??7# C;@:7# H;@:7@273# 509<4547@273# 415;12?01?73# ?7::7# F@7#
:-4150<171?# 1;?0>>71?# :72# C7>>72# 4B<72# =7# B71L701573# :72# $<45;?7@272# 7?#
k0=0>7#+7C0<L7E##
!7#9<7>47<#2975?05:7#?471?#=@#>A:;=<0>7#N#:7#G;1#=;5?7@<#=AC71=#2;1#L71=<73#
7?#:7#9@G:453#=-0G;<=#H;2?4:73#099:0@=4?#C<A1A?4F@7>71?# 7?#27#9<A5494?7#9;@<#
=;117<#:-055;:0=7#0@#9<42;1147<3#0B75#@17#C7<B7@<#HP2?A<4F@7E#k042#:7#9<;5M2#
27# <7W;@73# 2@<# @1# >;=7# ?;@?# 0@224# ?HAI?<0:# 7?# HP2?A<4F@73# >042#
9;?71?47::7>71?# ?<0L4F@7#N# 5-72?# F@7# $HA<M27# +7C0<L7# 0# G<42A# :7# F@0?<4M>7#
>@<# ?HAI?<0:3# 7::7# 17# C04?# 9:@2# 90<?47# =@# 9@G:45# >042# >;1?7# 71# 25M17# 9;@<#
5:0>7<# 2;1# 055@20?4;1E# $HA<M27# +7C0<L7# 72?# @17# 05?<457# 41C414>71?# 9:@2#
<7=;@?0G:7#F@7#i0<20=#17#:-A?04?#71#"1L:7?7<<73#90<57#F@7#2;1#?A>;4L10L7#72?#
=;@G:7#90<#10?@<73#K#:0#C;42#B<04#7?#C0@83#HP9;5<4?7#7?#2415M<7#_:7#=;5@>71?#72?#
G471#=7#:0#>041#=7#k017??73#>042#4:#17#5;<<729;1=#9:@2#K#2;1#B^@`E#,1#;@?<73#
5;>>7# k0<5# "1?;417# =012# :7# D34%'* 9)',&* =7# 'H0672970<73#$HA<M27#+7C0<L7#
204?# >0149@:7<# :72# 055722;4<723# 1;1# :7# ?72?0>71?# =7# .A20<# >042# 57:@4#
=-":7801=<7#k017??73#7?#2-4:#1-72?#902#?05HA#=7#201L3#5;>>7#:7#>01?70@#=7#
.A20<3# :-715<7# 0# A?A# <7>9:05A7# 90<# =7# :0# 2@47# 7?# =@# 201L3# 5;>>7# @1# 905?7#
C0@2?471#=;1?#;1#17#97@?#W0>042#27#=A=4<7E#!72#9H<0272#1;>410:72#:094=04<72#
C;1?#=@#W@L7>71?3#=AWK3#@1#5;@97<7?3#0@#>4:47@#=72#5<42#=7#:0#C;@:7#U#fi056#?;#
?H7#.;1547<L7<473#01=#+70?H#O4?H41#?O71?PTC;@<#H;@<2#l-#Y\ed]#
!7# =7<147<# ?7>92# =@# 2975?05:73# 5-72?# :0# C;@:7# >022A7# H@01?# :7# 90220L7# =72#
5;1=0>1A23# 27# 9<72201?# 9;@<# 02242?7<# K# :7@<# 78A5@?4;1#N# :72# 2975?0?<4572# 27#
C;1?#(0<F@72#90<;=4F@723#1;1#902#5;@901?#:7#C4:#=72#B472#>042#>0<F@01?#=-@1#
9;41?#=7#?<45;?#5H0F@7#>;<?3#=<0>0?42A7#?78?@7::7>71?#90<#:-;1;>0?;9A7#7?#:7#
e# fi@?# OH0?# 7805?:P# H0=# ?H7# 97;9:7# =;17m# n723# ?H7# <0=450:# 9;9@:057# ;C# (0<42# H0=#
C;<57=# ?H7# &0?4;10:# .;1B71?4;1# ?;# 0557=7# ?;# 4?2# O4::3# G@?# ?;# OH0?# 71=m# /0=# ?H7P#
2?;<>7=#?H7#2?0L7# >7<7:P# ?;#<79:057#0#C7O#;C#?H7#05?;<2#01=#?H71# <7?@<1#>776:P#?;#
?H74<# 270?2# ?;# O0?5H# ?H7# <72?# ;C# ?H7# 9:0Pm# )<# H0=# ?H7P# G<705H7=# ?H7# C;@<?H# O0::# ;C#
41B4;:0G4:4?P#O4?H#?H7#41?71?4;1#;C#0:?7<41L#?H7#9:0P#;C#<79<7271?0?4;1#4?27:Cm#(<75427:P#
;1# ?H727# F@72?4;123# ?H7# ?7>9;<0<P# 0::40157# G7?O771# ?H7# o05;G41# =79@?472# 01=# ?H7#
<0=450:#9;9@:057#;C#(0<42#O;@:=#C;@1=7<E-#YX%*,+!"&+#U#Zpq]##
#
#

Catherine Lanone / 8
?4<7?# _f.<02HlV-# Y\[p]`E# !0# ?<0LA=473# 57971=01?3# 27# 5;1W@L@7# 0B75# :7#
>A:;=<0>73#71#=A=;@G:01?#:7#97<2;110L7#CA>41413#5;>>7#9;@<#<A9;1=<7#0@#
W7@# =7# =;@G:72# .0<?;1r+0<10PE# s17# C4L@<01?7# B471?# 27# 9:057<# 0@8# 5t?A2# =7#
.0<?;1#9;@<#<75;110u?<7#:-7<<7@<#=-4=71?4C450?4;1#7?#27#C04<7#_5;>>7#i0<20=#
0@#90220L7#=7#:0#5H0<<7??7`3#:0#2975?0?<457#=7#:0#5;>A=47#HA<;RF@73#=@#?;@<#=7#
90227T90227E#.0<?;1#17#W;@7#=;15#902#:0#25M17#71#B0413#9@42F@-4:#0#@1#9@G:45#
_57<?72# <72?<741?`# =-414?4A23# 90<>4# :0# C;@:7# =A5H0u1A7# F@4# :7# 9<71=# 9;@<#
+0<10Pr,B<7>;1=7E#!0#97?4?7#5;@27??7#;CC<7#04124#K#.0<?;1#@17#0@?<7#C;<>7#
=7# <;>0157# ?0<=4B73# =@# 5;@2@# >041# _;@# 5;@2@# =7# C4:# G:015`# F@4# 24L17# :0#
<A=7>9?4;1E# !7# >A?47<# =7# 57# 97<2;110L7# =-41LA1@7# <0997::7# :0# >A?09H;<7#
022;54A7#K#!@5P3#:7#C4:#=-;<#=@#G;1H7@<#N#:7#=A1;@7>71?#:47#.0<?;1#K#:0#C;42#K#
:0#5;@27??7#7?#K#!@5P3#:-@17#5;1C4<>01?#:7#:471#0B75#:-0@?<73#90<#?<01290<7157E#
.;>>7# :7# 2;@:4L17# "11P# '0=<413# +456712# 0@<04?# 04>A# W;@7<# :7# <t:7# =7#
.0<?;13#7?#971204?#F@-4:#0@<04?#C04?#F@7:F@7#5H;27#=7#G471#=7#20#B473#7?#2@<?;@?#
=7# 272# =7<147<2# 412?01?2# 5;>>7# 4:# :-A5<4B4?# =012# @17# :7??<7# =7# 1;B7>G<7#
epge#Y'"+%*&#U#de]E#.0<#0@#>;>71?#=7#>;1?7<#2@<#:-A5H0C0@=3#:7#9<;?0L;142?7#
=A5H@# 57227# =7# W;@7<# :72# =;@G:@<72# 9;@<# 27# =;117<# :7# G70@# <t:7E# X0>7@8#
=425;@<2#71#BA<4?A#F@7#57??7#G<MB7#71B;:A7#C410:7#U#f*?#42#0#C0<3#C0<#G7??7<#?H41L#
?H0?#*#=;3#?H01#*#H0B7#7B7<#=;17#N#4?#42#0#C0<3#C0<#G7??7<#<72?#?H0?#*#L;#?;#?H01#*#
H0B7# 7B7<# 61;O1-# Y5* 6,4%* 07* 680* 9#(#%'#U# \ge]E# !72# 5;>90<0?4C2# ?42271?# @17#
2;<?7#=7#9;41?#=7#5094?;1#F@4#B471?#2?0G4:427<#:7#G0:0157>71?#=7#:-;@B7<?@<7E##
)1#27#2;@B471?#=7#:-415494?3#=@#?<45;?0L7#=7#9<;9;24?4;12#2P>A?<4F@72#1;@01?3#
@1#9;41?#71#0B01?3#@1#9;41?#71#0<<4M<73#:7#>74::7@<#7?#:7#94<73#:-454#7?#:-04::7@<2#U#
f*?#O02#?H7#G72?#;C#?4>723#4?#O02#?H7#O;<2?#;C#?4>72#Yv]#4?#O02#?H7#2702;1#;C#
!4LH?3#4?#O02#?H7#2702;1#;C#+0<617223#4?#O02#?H7#29<41L#;C#H;973#4?#O02#?H7#
O41?7<# ;C# =72904<-# Yq]v# (<S?# K# S?<7# =A5:0>A3# :7# ?78?7# 5;1B404?3# 27:;1# "11P#
'0=<413# ?01?# 0@# b#2975?05:7# =7# :-H42?;4<7#c# F@-0@# b#2975?05:7# =7# :-A5<4?@<7#c3#
2;<?7# =7# b#90<0=7# =@# G;14>71?7@<#c# Y'"+%*&#U# dj]# F@7# +456712# 2;@H04?04?#
L0<=7<#?7::7#F@7::7#=012#20#B7<24;1#0=09?A7#9;@<#@17#:75?@<7#9@G:4F@7#_F@-71#
C41#=7#5;>9?73#4:#17#C4?#W0>042`E#
"#572#G4C@<50?4;12#2P2?A>0?4F@72#<A9;1=71?#=;15#:72#5;>90<0?4C2#2?0G:72#7?#
C40G:72# =@# 90<5;@<2# 205<4C4547:3# 9<;>7227# =7# <79;2# A?7<17:# 09<M2# :72#
?@<G@:71572#<AB;:@?4;1104<72E#+7#>S>7#F@7#:-415494?3#572#:4L172#2;1?#A5<4?72#
9;@<#S?<7#=4?72#0@?01?#F@7#:@72E#!72#B4<L@:72#_fC0<3#C0<#G7??7<-`#41?<;=@4271?#@1#
2;@CC:73# @17# 97?4?7# <7294<0?4;1# F@4# <P?H>7# :0# 9H<0273# 5;>>7# 9;@<# 0::7<# =7#
:-0B01?E#)<3#:7#90<0=;873#5-72?#F@7#b#'4=17P#.0<?;1#9<;CM<7#@1#=425;@<2#B0'(*
:0&(%:*90<#:-71?<7>427#=7#2;1#G4;L<09H7#c#Yd[]3#9@42F@-;1#17#=;117#902#=7#
C7@4::7#0@8#5;1=0>1A2#K#>;<?#9;@<#P#1;?7<#:7@<#=7<14M<72#9712A72#_B;4<#0@224#
=012# 57# B;:@>7# :72# 0<?45:72# =7# &0?H0:47# o0w56# 7?# k0<5# (;<A7`E# !0# B;48# =7#
.0<?;13#9:05A7#71?<7#L@4::7>7?2#W04::4?#=7#:0#G;@5H7#=@# C4:2#=7# !@547#U# f*#277#

Catherine Lanone / 9
?H0?#5H4:=#Yv]#OH;#G;<7#>P#10>73#0#>01#O41141L#H42#O0P#@9#41#?H0?#90?H#;C#
:4C7#OH45H#O02#;157#>417-#Y5*6,4%*07*680*9#(#%'#U#\ge]E##
!7#C4:2#<7W;@7#041243#71#>47@83#:7#<t:7#=@#9M<7#=7#2@G2?4?@?4;1#=;1?#4:#9;<?7#:7#
1;>3#2-A:7B01?#9;@<#=7B714<#W@L73#?;@?#71#=;1101?#K#2;1# ?;@<#:7#W;@<#K# @1#
71C01?#=@#>S>7#1;>#_f*#277#H4>3#C;<7>;2?#;C#W@2?#W@=L72#01=#H;1;@<7=#>713#
G<41L41L#0#G;P#;C#>P#10>7-#Y\ge]`#N#7?#5-72?#=012#@1#(0<42#<75;1C4L@<A3#:0BA#
=7# ?;@?7# ?<057# =7# 201L3# 09042A3# F@7# 27# <A901=# 57??7# 90<;:7# F@4# G:015H4?#
.0<?;13#W0=42#5H050:3#G<7G42#L0:7@27#7?#G@B7@<#41BA?A<AE##
*:#2-72F@4227#=;15#454#@17#>427#71#0GP>73#0B75#57#'4=17P#3#C4:2#B450<401?3#F@4#
<7=4?#K#2;1#C4:2#'4=17P#:72#90<;:72#41;@R72#0@#2712#9<;9<7#=7#'4=17P#.0<?;13#
9M<7# 90<# 2@G2?4?@?4;13# 90<;:72# 41;@R72# 90<57# F@7# 1;1# 9<;1;15A72# 7?# 1;1#
71?71=@72E#,1#2;>>73#57#F@4#27#W;@7#90<#57#?;@<#=7#90227T90227#;@#2;<?4:ML7#
10<<0?4C3#5-72?#@17#C;<>7#=7#W7@#=7#<t:72#F@4#>4>7#:7#=429;24?4C#=@#?HAI?<73#;a#
5-72?#G471#:7#=;@G:73#:7#2;2473#:7#C4:2#;@#:-05?7@<3#F@4#97<>7?#=7#<722@254?7<3#=7#
<A4150<17<#:0#90<;:73#=7#?;@W;@<2#<;@B<4<#:72#L@4::7>7?23#=012#@1#729057#1;1#
=AC4L@<A# >042# ?;@W;@<2# <75;1C4L@<A# _fO4?H# 1;?# 0# ?<057# ;C# ?H42# =0P-2#
=42C4L@<7>71?-#Y\gZ]`3#<72A>4;?42A#90<#:0#90<;:73#?HAI?<7#=-ABA17>71?2#9022A23#
F@43#?;@W;@<23#97@B71?#C04<7#<7?;@<#2@<#:0#25M17#=7#:0#90<;:7#_E%'3&F,:`E#
.7??7# 25M17# C410:7# _24>9:4C4A7# 9@42F@7# .0<?;1# 9<;1;157# G471# :72# C0>7@272#
90<;:72#9<;>7??01?#:7#<79;2`#C4?#0@#?;@<101?#=@#24M5:7#:72#G70@8#W;@<2#=7#o;H1#
k0<?41T/0<B7P#=012#:-0=09?0?4;1#?HAI?<0:7#:0#9:@2#5A:MG<73#f$H7#)1:P#x0P-E#
)1#27#2;@B471?#=7#:-0CC45H73#:-05?7@<#?<M2#=<;4?3#:7#947=#2@<#:-A5H0C0@=3#;@#=72#
50<?72#9;2?0:72#F@4#7::72#0@224#9<4B4:AL40471?#71?<7#0@?<72#57#?7>92#C;<?#;a#:0#
=7<14M<7# >0<5H7# C04?# =7# :0# L@4::;?417# :7# =;@G:7# =7# :0# 5<;48# =@# 50:B04<73#
2015?4C401?# :-0257124;13# 0@# >S>7# ?4?<7# F@7# :72# ?;@<2# =7# &;?<7# +0>7# F@4# 27#
=A?05H71?# 17??7>71?# 0@# :;41E# (;@<# o;22# k0<2H3# 57# ?<;97# =@# 205<4C4573#
<79<7101?#@17#9;27#K#:0#'041?T'AG02?4713#W;@04?#2@<#:-H;>;A<;?42>7#Yk"%'/#U#
e\d]E#!72#0=09?0?4;12#541A>0?;L<09H4F@72#C;1?#0@224#:0#90<?#G7::7#K#:-@:?4>7#
9H<027#N# 7::7# 72?# 9712A73# 71# B;48# 0773# 90<# +4<6# i;L0<=7# =7G;@?# C057# K# :0#
L@4::;?4173# =012# :-0=09?0?4;1# =7# %0:9H# $H;>02#N# :7# C4:># 2-05HMB7# 2@<# :7#
5;@97<7?# F@4# ?;>G7E# +012# :0# B7<24;1# =7# ed\[# =7# o056# .;1O0P3# :0# 50>A<0#
90227# =7# .;:>01# =7G;@?# 0@# 5;@97<7?# F@4# 1-72?# 902# 715;<7# ?;>GA3# 9@42#
2-A:MB7#B7<2#:7#547:#7?#@17#B@7#0A<47117#=7#:0#'7417#7?#=7#(0<423#?01=42#F@-;1#
71?71=#:0#B;48#=7#.;:>01#9<;1;1D01?#:72#C0>7@272#90<;:723#=7#2;<?7#F@-7::72#
97@B71?#S?<7#9712A72#W@2?7#0B01?3#;@#09<M2#:0#>;<?3#=012#@17#2;<?7#=-71B;:#=7#
:-I>7E#
k042#9:@?t?#F@7#=7#1;@2#0??0<=7<#2@<#:0#9;2?A<4?A#?HAI?<0:7#=7#5*6,4%*07*680*
9#(#%'3#>47@8#B0@?#<7>;1?7<# @1#412?01?#B7<2#6>%* ?&0@%"* A%%BC* :0#>0?<457#=@#
<;>01E# .0<# 24# 57??7# =7<14M<7# 25M173# =012# :72# :4>G72# =-@17# A1;1540?4;1#
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%