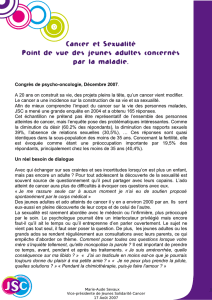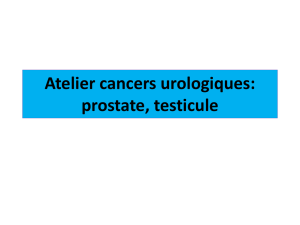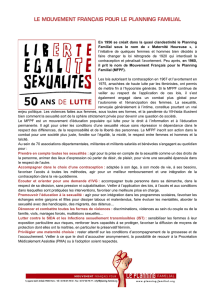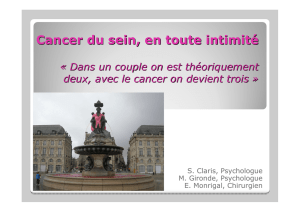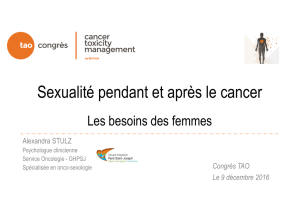L`invention des normes de genre et de sexualité dans les

1
L’invention des normes de genre et de sexualité dans les
mouvements révolutionnaires
(1789-1968)
Journée d’étude IHRF (Paris I Panthéon-Sorbonne). Avec le soutien du Centre d’études Genre (Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis). Organisée par Clyde Plumauzille (monitrice à Paris I) et Caroline Fayolle (monitrice à Paris 8). Prévue
pour octobre 2009.
Horizon et temporalités
Cette journée d’étude se propose d’analyser comment les mouvements révolutionnaires
déstabilisent et repensent les normes sexuelles et sexuées de leur société, à la fois dans leurs
discours et dans leurs pratiques militantes. Elle présuppose que la subversion et l’invention des
normes de genre et de sexualités, produites par ces mouvements, éclairent non seulement les
conceptions du politique de ces derniers, mais aussi les non-dits de l’ordre social remis en
question.
Pour souligner à la fois le caractère discontinu de l’histoire de ces mouvements et les
mécanismes de résonances et de réminiscences qui les font dialoguer, il nous a paru intéressant
de comparer des mouvements révolutionnaires issus de différentes époques (de 1789 à 1968) et
de différents lieux (France, Russie, Espagne, États-Unis…). Choisie comme point de départ, la
Révolution française entraîna des débats, notamment sur le divorce, visant redéfinir les normes
de genre et sexualité pour construire les bases d’une société régénérée. De même, la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen, en devenant une référence légitimante, ouvre pour les temps à venir
un espace d’émergence aux discours critiques visant à dénaturaliser la répartition hiérarchique des
rôles sexués. Si la Révolution française trouve des échos dans les mouvements révolutionnaires
du XIX
e
et du XX
e
siècles, jusqu’aux pensées utopiques et égalitaires de mai 1968, c’est au travers
de cet héritage double et parfois contradictoire : à la fois la volonté de remettre en cause les
hiérarchies établies et l’aspiration normative à reconstruire ce que sera l’homme nouveau et la
femme nouvelle.
Subvertir et réinventer la norme
Ainsi, il nous faut saisir au cœur de ce processus la fabrique normative à l’œuvre dans la
matrice révolutionnaire. Il convient d’étudier celle-ci comme un espace d’expériences où

2
l’invention de nouvelles normes vient redéfinir l’univers des possibles. Par normes, on entend
toutes prescriptions d’agir dans un sens déterminé et sanctionnées dans le cadre d’un « ordre de
contrainte efficace »
1
. En ce sens, elles constituent une modalité essentielle d’application du
pouvoir comme du contre-pouvoir. D’un point de vue socioculturel, le concept de norme désigne
tout un ensemble diffus de valeurs qui contraignent implicitement le comportement des individus
en société, définissant un fonctionnement « normal » de celui-ci
2
. Mais ces dernières peuvent
également être un instrument de subversion de l’ordre établi dès lors qu’un groupe d’individus
agit sur ce système ou bien lui résiste. L’étude des entreprises de normalisation qui se jouent au
sein des mouvements révolutionnaires permet de saisir les règles socioculturelles qui participent
de la définition et de la gestion des individus tant par le pouvoir que par eux mêmes. C’est dans le
cadre de cette interrogation sur les pratiques normatives qu’interviennent les deux biais
conceptuels de genre et de sexualité afin d’appréhender la place du sexe en révolution.
Le genre et la sexualité, des outils d’analyse historique
La polysémie du terme « genre » en français explique l’incompréhension dont il fait
souvent l’objet
3
. Pour se référer à l’article fondateur de Joan Scott, « le genre : une catégorie utile
d’analyse historique », traduit en français en 1988, le genre est défini comme « un élément
constitutif des relations sociales fondées sur les différences perçues entre les sexes » et comme «
un mode fondamental de signifier les rapports de pouvoir
4
. » Autrement dit, faire l’histoire du genre
équivaut à analyser la construction sociale et culturelle de la différence et de la hiérarchie entre les sexes. Il est
nécessaire de ne pas glisser du genre aux genres. Le risque est en effet de passer « de l’examen du
genre – comme rapport de pouvoir et principe de division – aux « genres », un déjà-là dont il
s’agirait d’observer et décrire la dualité
5
. » L’écriture de l’histoire du genre se distingue donc de
l’histoire des femmes, dans le sens où elle s’intéresse non pas seulement aux femmes comme
actrices ou sujets d’histoire, mais aussi à la construction de la catégorie « femme » et des identités sexuées.
Elle n’est pas non plus l’histoire de la relation entre les sexes, mais celles des rapports de pouvoir qui
s’exercent dans cette relation.
1
Kelsen, Hans , Théorie pure du droit, Paris, LGDJ, 1999, p.25.
2
Foucault, Michel, Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 368.
3
Planté, Christine, « la confusion des genres », dans Sexe et genre, De la hiérarchie entre les sexes, Seuil, Paris, 1991, p. 51.
4
Scott, Joan, « Genre : Une catégorie utile d’analyse historique », dans Riot-Sarcey Michèle, Varikas Eleni, et Planté,
Christine, (dir.) Le Genre de l’histoire, Cahiers du GRIF/Ed. Tierce, N°37-38, 1988, p. 141.
5
Varikas, Eleni, Penser le sexe et le genre, Paris, Presse Universitaire de France, 2006.

3
Tout comme le genre, la sexualité est un concept essentiel pour saisir les hiérarchies
interindividuelles et leurs fonctions politiques. Définie par le fait d’ « avoir » ou de « faire » du
sexe
6
, la sexualité n’est pas appréhendée comme une réalité absolue et « naturelle » mais au
contraire comme une construction historique, relative à un contexte, à des savoirs et à des
pratiques. Selon Michel Foucault, depuis le XVIII
e
siècle, le sexe constitue un objet d’analyse
rationnelle générant une véritable « explosion discursive ». L’émergence de ce « dispositif de
sexualité » établit des liens de causalité entre désir et identité personnelle
7
, faisant de la sexualité
un élément clé de la subjectivité moderne. Les pratiques corporelles et leurs représentations
scientifiques et fantasmatiques permettent donc d’étudier les définitions des rapports à soi et des
rapports interindividuels au sein de la société. En cela, la sexualité est un des modes par lequel la
société fait l’expérience d’elle-même, d’où le biais intéressant qu’elle offre pour saisir les
dimensions identitaires de l’invention politique et sociale que propose les mouvements
révolutionnaires.
Pour comprendre en quoi les mouvements révolutionnaires, en repensant les normes de
genre et de sexualité, place l’individu privé au cœur du politique, interviendront des chercheuses
et des chercheurs issus de différentes disciplines (majoritairement des historien.nes, mais aussi des
philosophes et des sociologues).
Plusieurs interrogations ouvriront le débat :
Quel éclairage les outils d’analyse historique du genre et de la sexualité portent-ils sur les
mouvements révolutionnaires?
En quelle mesure les questions du genre et des sexualités divisent et/ou structurent les
mouvements révolutionnaires ?
Lorsqu’il s’agit de mouvements minoritaires, en quoi l’invention de nouvelles conceptions
et pratiques du rapport entre les sexes s’inscrit-elle dans une critique politique de l’ordre existant ?
Est-ce que la remise en cause des hiérarchies entre les femmes et les hommes par certains
mouvements révolutionnaires s’accompagne-t-elle d’un réel effacement des rapports de
dominations entre les sexes dans leur fonctionnement ?
6
Dorlin, Elsa, Sexe, Genre et Sexualités. Introduction à la théorie féministe, Paris, PUF, 2008, p. 20.
7
Foucault, Michel, Histoire de la sexualité, t. I : La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 163-164.
1
/
3
100%
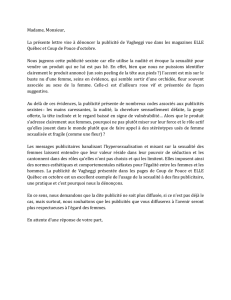
![UCL - Sociologie du genre et de la sexualité [ LSOC2005 ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/006743406_1-365227278f29923faf6aec9878fbe823-300x300.png)