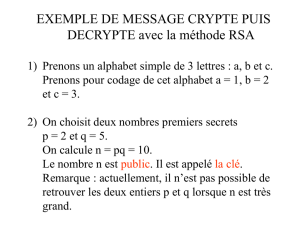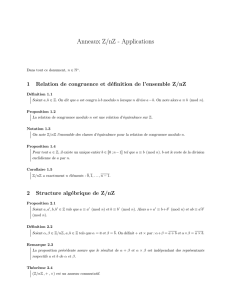Nicolas Bouffard Automne 2016 - Page web de Nicolas Bouffard

Mathématiques discrètes
Nicolas Bouffard
Automne 2016
Derni`ere mise `a jour:
10 d´ecembre 2016 `a 15:00

2

Table des mati`eres
1 La logique math´ematiques 5
1.1 Le calcul des propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 ´
Equivalence des propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Le calcul des pr´edicats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4 Les r`egles d’inf´erence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.5 Les d´emonstrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2 La th´eorie des ensembles 19
2.1 Introduction................................................. 19
2.2 Sous-ensemble et ´egalit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3 Op´erations sur les ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4 D´emonstrations en th´eorie des ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.5 Lesparadoxes................................................ 25
3 Fonctions et relations 27
3.1 Les relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2 Les relations d’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3 Les relations d’´equivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.4 Lesfonctions ................................................ 32
3.5 La composition des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.6 Les fonctions injectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.7 Les fonctions surjectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.8 Les fonctions bijectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.9 L’inverse d’une fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4 L’arithm´etique 39
4.1 La divisibilit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2 La division euclidienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.3 Le plus grand commun diviseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.4 Le plus petit commun multiple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.5 Les nombres premiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.6 La crible d’´
Eratosth`ene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5 Les nombres modulos 51
5.1 Introduction aux nombres modulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.2 Derniers chiffres d’un expression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.3 Les crit`eres de divisibilit´es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.4 Les th´eor`emes de Fermat, Euler et Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.5 L’´equation ax =benmodulo....................................... 59
5.6 La cryptographie RSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3

6 Quelques outils essentiels 67
6.1 La notation sigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.2 Les sommes arithm´etiques et g´eom´etriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.3 L’induction ................................................. 70
6.4 Le th´eor`eme du binˆome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.5 Les nids de pigeons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7 La combinatoire 79
7.1 Introduction et m´ethodes ´el´ementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7.2 Principe du produit, de la somme et d’inclusion-d’exclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
7.3 Combinaison, arrangement et permutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.4 Permutation d’objet indistingable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.5 Les relations de r´ecurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.6 Les fonctions g´en´eratrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
8 La th´eorie des graphes 91
8.1 Les graphes et les arbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.2 Les graphes biparties et le couplage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
8.3 Les graphes eul´eriens / hamiltoniens et la connexit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
8.4 Les graphes planaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8.5 Le probl`eme du plus court trajet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
8.6 Les probl`emes de coloriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Bibliographie 105
Index 107
4

Chapitre 1
La logique math´ematiques
1.1 Le calcul des propositions
La logique est la science du raisonnement, un sujet `a cheval entre les math´ematiques et la philosophie. Il
s’agit d’un language qui est `a la base de toutes les math´ematiques et sert de fondement aux math´ematiques.
Ses applications sont tr`es nombreuses, entre autre dans des domaines tels que l’informatique et l’´electronique.
Elle est omnipr´esente dans tous les domaines des math´ematiques.
Dans cette section, nous allons commencer par d´efinir le concept de proposition logique, et puis nous
allons voir les diff´erentes op´erations permettant de composer entre eux les propositions (les connecteurs
logiques).
Definition 1.1.1. Une proposition logique est un ´enonc´e qui est soit vrai ou faux, mais pas les deux en
mˆeme temps.
Il existe de tr`es nombreux exemples de proposition logique, que ce soit en math´ematiques ou dans d’autre
discipline. En voici quelques exemples.
Exemple 1.1.1. Les ´enonc´es suivants sont des propositions logiques :
1. La pomme est rouge
2. Toronto est la capitale du Canada
3. 2 +4=6
4. Tous les entiers sont pair
Remarquez que les propositions 1 et 3 sont vraies, alors que les propositions 2 et 4 sont fausses.
Une proposition logique peut prendre la forme d’une simple phrase ou d’un ´enonc´e math´ematique. Ceci
ne change rien au fait qu’il s’agit de proposition logique. Remarquez cependant qu’un ´enonc´e de la forme :
2+x=5
ne peut pas ˆetre qualifi´e de proposition logique, car il n’est pas possible de d´etermin´e s’il est vrai ou faux
sans connaitre la valeur de x. Nous allons un peu plus loin appeler un tel ´enonc´e un pr´edicat. Par contre, si
on affirme que x=3, alors l’´enonc´e 2 +x=5 devient alors une proposition logique (qui dans ce cas est vraie).
Nous allons maintenant regarder les diff´erentes op´erations sur les propositions logiques, c’est ce que nous
appellons des connecteurs logiques. C’est ce qui va nous permettre de donner une d´efinition formelle `a des
termes tel que “et”, “ou”, et “implique”. Un connecteur logique sert `a modifier la valeur d’une proposition
logique ou d’en combiner plusieurs ensembles. Nous allons d´efinir ces connecteurs `a l’aide de tables de v´erit´e.
Une table de v´erit´e est un tableau indiquant les diff´erentes valeurs, un peu comme une table de valeur lorsque
l’on ´etudie les fonctions. Par contre, comme une propositions logiques ne peut prendre que les valeurs vraie
ou fausse, toute les possibilit´es sont repr´esenter dans une table de valeurs.
Le premier connecteur logique est la n´egation et contrairement aux autres connecteurs logiques qui
suivrons, la n´egation ne prend qu’une proposition logique comme entr´e. La n´egation repr´esente la notion de
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
1
/
108
100%