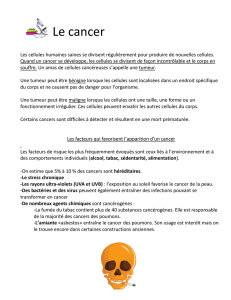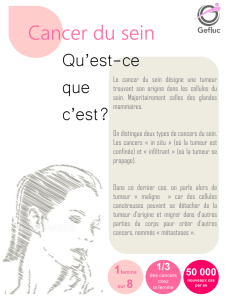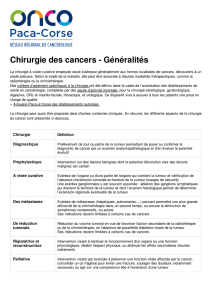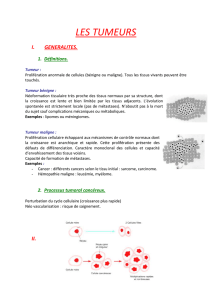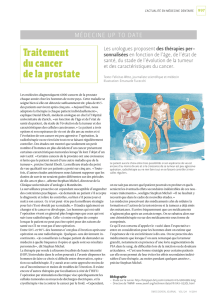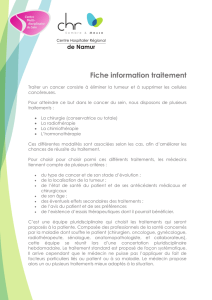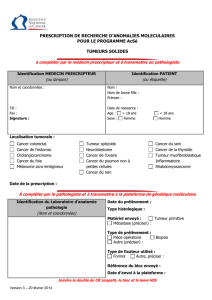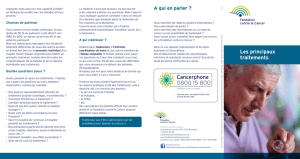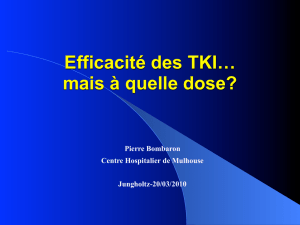Items 145, 141 : Tumeurs de la cavité buccale

!"
Date de création du document 2008-2009
- © Université Médicale Virtuelle Francophone -

Table des matières
1 Généralités sur les cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS)..............................1
2 L’aspect clinique classique........................................................................................................ 2
3 Le diagnostic précoce...................................................................................................................3
4 La prévention................................................................................................................................4
5 Formes topographiques...............................................................................................................5
6 Le bilan préthérapeutique...........................................................................................................6
7 Les moyens thérapeutiques......................................................................................................... 7
8 Résultats........................................................................................................................................8
9 Surveillance...................................................................................................................................9
OBJECTIFS
#$
●%& !"
!% !'
●!%!%(&
!!)!)
#(&***!&%
%)! '
- © Université Médicale Virtuelle Francophone -

I GÉNÉRALITÉS SUR LES CANCERS DES VOIES AÉRODIGESTIVES
SUPÉRIEURES (VADS)
Les cancers des !% !
+!" ,--- (.
!/! ! ---!/'plus fréquents en France que dans les
autres pays du monde'"/!"&
"012%!
/3(45-
!* "'
#.!10 % environ de l’ensemble des cancers
!%!%0&!%!1+$1#
0!'
La prépondérance masculine6-70!"
&3-".08*
%'0810 .%
quatrième position en termes de fréquence/"09
'
6-7 intoxication alcoolotabagique'
( )#: (cf. glossaire)
!! "!"!
;(4% 0&
!" !&;&
0 (cf. glossaire) '
L’atteinte cancéreuse des VADS<multiple*=synchrone
<métachrone!!'
.0"41( !
00;!&1(/ "8
!1(/ >-7'?1
1.!
! !%1!%1(/
(. 41"0!"0&410%'.4
&(/ &&!
'
- © Université Médicale Virtuelle Francophone -

Les principaux sitesla cavité buccale>7l’oropharynx>7le
larynx>7l’hypopharynx 7le cavum,7les cavités nasales et paranasales37'
Anatomopathologie
?.90 % des cas, des carcinomes épidermoïdes'
? !!
%! (cf. glossaire) '
? **!!;0;%
undifferentiated carcinoma of nasopharyngeal type@A**!*
0;%;'
?*;0B1C; ;%"
%/%!;0 (cf. glossaire) '
Particularités anatomiques des VADS
siège tumoral 0;%&
!&0!&4%! *
!.!%0&
'
?drainage lymphatique du cou*%!!;0&'
?1 0%%
'1&!!!0
%!!0! bilatéralité'?&
!!!0 "!'?
"% !0"!'
La lésion muqueuse
? !"(!411!%***
*;&!0/ "
0!"!*(!('#1!41"
&"%!!(!'
?!**!'
Une ulcération%&%!" *
1%10*!'#* "
"!%! !*! !!
( &*'
? /"%1*"!*
- © Université Médicale Virtuelle Francophone -

1% 2%*!(1!'
!saigne facilementbase indurée!!
'dépasselimites visibles de la tumeur&
%!1*D'
<valeur quasi pathognomonique (cf. glossaire) de cancer'
Figure 1 : Ulcération
?1!* "!&formes
fissuraires* %>'?1induration*
!!1%&D&
"!!!*!'
Figure 2 : Forme fissuraire
A"%%3!!& *"
("!0!%&"1!&
&14!'
Figure 3 : Tumeur bourgeonnante
- © Université Médicale Virtuelle Francophone -
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%