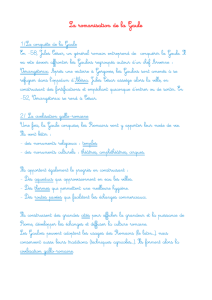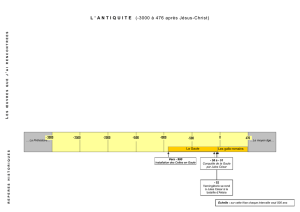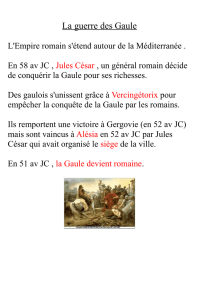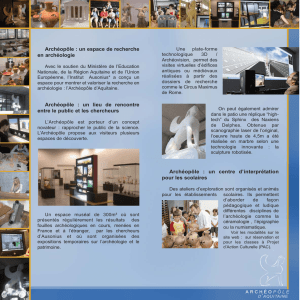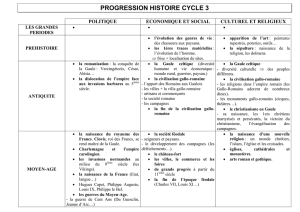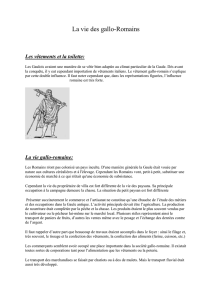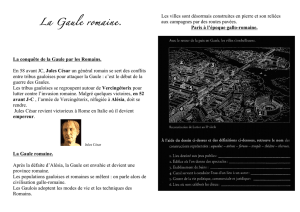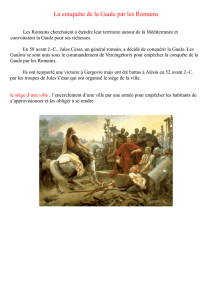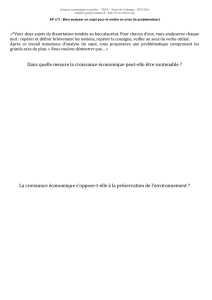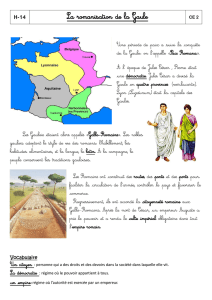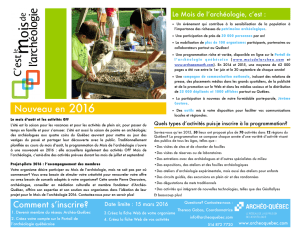L`économie agraire de la Gaule : aperçus

Université de Franche-Comté
École doctorale Langages, espaces, temps, sociétés
Doctorat
Archéologie
Pierre Ouzoulias
L’économie agraire de la Gaule :
aperçus historiographiques et perspectives archéologiques
Texte
èse dirigée par M. le Professeur François Favory
et soutenue le 1er février 2006
Jury
M. Ch. Goudineau, Professeur au Collège de France, président
M. J. Andreau, Directeur d’études à l’EHESS, rapporteur
M. J.-M. Carrié, Directeur d’études à l’EHESS
M. Ph. Leveau, Professeur émérite de l’université de Provence, rapporteur
M. D. Paunier, Professeur émérite des universités de Lausanne et de Genève

Mais le goût de l’Histoire leur était venu, le besoin de la vérité pour elle-même.
Peut-être est-elle plus facile à découvrir dans des époques anciennes ? Les auteurs, étant loin
des choses, doivent en parler sans passion. Et ils commencèrent le bon Rollin.
« Quel tas de balivernes ! » s’écria Bouvard, dès le premier chapitre.
« Attends un peu », dit Pécuchet, en fouillant dans le bas de leur biliothèque, où s’entassaient
les livres du dernier propriétaire, un vieux juriconsulte, maniaque et bel esprit ; et ayant déplacé
beaucoup de romans et de pièces de théâtre, avec un Montesquieu et des traductions d’Horace, il
atteignit ce qu’il cherchait : l’ouvrage de Beaufort sur l’Histoire romaine.
Tite-Live attribue la fondation de Rome à Romulus. Salluste en fait honneur aux Troyens
d’Énée. Coriolan mourut en exil selon Fabius Pictor, par les stratagèmes d’Attius Tullus si l’on en
croit Denys ; Sénèque affirme qu’Horatius Coclès s’en retourna victorieux, et Dion qu’il fut
blessé à la jambe. Et La Mothe Le Vayer émet des doutes pareils, relativement aux autres peuples.
On n’est pas d’accord sur l’antiquité des Chaldéens, le siècle d’Homère, l’existence de
Zoroastre, les deux derniers empires d’Assyrie. Quinte-Curce a fait des contes. Plutarque dément
Hérodote. Nous aurions de César une autre idée, si le Vercingétorix avait écrit ses commentaires.
L’Histoire ancienne est obscure par le défaut de documents. Ils abondent dans la moderne ; et
Bouvard et Pécuchet revinrent à la France, entamèrent Sismondi.
Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, chapitre IV
C’était une ferme de bonne apparence. On voyait dans les écuries, par le dessus des portes
ouvert, de gros chevaux de labour qui mangeaient tranquillement dans des râteliers neufs. Le long
des bâtiments s’étendait un large fumier, de la buée s’en élevait, et, parmi les poules et les
dindons, picoraient dessus cinq ou six paons, luxe des basses-cours cauchoises. La bergerie était
longue, la grange était haute, à murs lisses comme la main. Il y avait sous le hangar deux grandes
charrettes et quatre charrues, avec leurs fouets, leurs colliers, leurs équipages complets, dont les
toisons de laine bleue se salissaient à la poussière fine qui tombait des greniers. La cour allait en
montant, plantée d’arbres symétriquement espacés, et le bruit gai d’un troupeau d’oies retentissait
près de la mare.
Gustave Flaubert, Madame Bovary, première partie, chapitre II

INTRODUCTION
E TRAVAIL tire son origine d’une constatation désabusée. Dans la préface d’un livre
conçu, en 1991, comme un manifeste, Claude et Georges Bertrand observaient que,
malgré ses prétentions, l’archéologie agraire n’existait pas. Sans objectif clairement défini,
dépourvue d’une méthode spécifique, elle n’était le plus souvent qu’un « conglomérat de
recherches » sans projet d’ensemble 1. Quinze ans plus tard, malgré de nombreuses recherches
novatrices, il n’est pas outrancier de considérer que ce bilan conserve globalement une certaine
acuité dans le domaine de l’archéologie rurale gallo-romaine. Certes, comme le leur
demandaient Claude et Georges Bertrand, les archéologues ont intégré à leur pratique les
objets, les résultats et parfois les méthodes des sciences naturalistes et de la géographie de
l’espace. Mais cet amalgame n’est pas toujours accompagné d’une réflexion sur le statut et la
fonction fondamentale de la discipline, notamment dans ses rapports avec un discours
historique qui puise sa matière essentiellement dans les sources écrites.
C
Refusant d’assumer toutes les responsabilités que lui imposerait sa nécessaire émancipation,
l’archéologie peine à tracer une voie originale, en dehors de la primauté de l’écrit. Partant,
hormis quelques travaux récents, les recherches archéologiques consacrées aux campagnes de la
Gaule semblent souvent portées par des conceptions historiques qu’elles n’ont pas vérifiées
dans l’instance de la documentation qu’elles produisent et dont la validité est parfois contestée
par les historiens eux-mêmes. Cette allégeance à des dogmes déclinants est d’autant plus
troublante que les historiens sont les premiers à reconnaître aux sources archéologiques une
valeur intrinsèque qui permettrait d’appréhender selon de nouvelles perspectives heuristiques
des questions historiographiques anciennes.
Des postulats, comme ceux de la prépondérance du grand domaine, de l’autarcie de la villa,
de l’économie naturelle de la petite ferme paysanne, du développement irrépressible du faire-
valoir indirect et de l’archaïsme structurel de l’agriculture antique, poursuivent donc dans de
nombreux travaux d’archéologie gallo-romaine une existence tranquille et autonome. Ancrés
dans une tradition historiographique parfois très ancienne, ces schémas s’imposent comme
autant d’arguments d’autorité et avec encore plus de force qu’ils sont l’aboutissement de
constructions théoriques très élaborées qui ne se laissent pas appréhender et démonter
facilement.
Sans discuter de la validité des nombreuses approches qui entreprennent de favoriser
l’émergence d’une discipline renouvelée dans ses méthodes et ses objets, il est apparu utile de
réfléchir, dans ce mémoire, à la prégnance et à la pertinence de plusieurs des concepts autour
desquels le corps de doctrine de l’archéologie rurale gallo-romaine s’est progressivement
constitué. La méthode historiographique a semblé la plus adaptée pour poursuivre cette
ambition. De façon tout à fait académique, le travail a donc consisté à repérer dans la
production historique moderne les idées fortes, les révisions majeures et les tournants
épistémologiques décisifs grâce auxquels se sont construits les discours successifs sur les
1Bertrand, Bertrand, 1991, p. 16.

Introduction 4
campagnes gallo-romaines. S’élargissant graduellement, la recherche s’est naturellement portée
sur les contextes d’élaboration de ces idées. Quiconque a essayé de retirer du sol la racine d’une
ronce sait que cette tâche est ardue. Des rhizomes et un enchevêtrement de réseaux souterrains
que l’on ne soupçonnait pas se découvrent soudain et obligent souvent à poursuivre l’opération
dans les parcelles voisines. De la même façon, l’exercice de généalogie entrepris à l’occasion de
ce mémoire a conduit rapidement dans des territoires disciplinaires limitrophes et il a fallu
convenir que l’histoire agraire de la Gaule était difficilement dissociable de celle de l’Italie et de
Rome et qu’elle ne pouvait être correctement analysée sans une connaissance préalable des
débats sur la nature de l’économie antique.
Le champ d’investigation devenait alors trop vaste et puisqu’il faut bien assigner des limites
à toute entreprise humaine, il fut décidé de conduire ce travail historiographique en
privilégiant quelques thèmes dont l’étude pouvait à la fois éclairer les débats anciens sur les
campagnes de la Gaule et permettre de comprendre certaines des propriétés des recherches
actuelles. Examinant les travaux historiques de la seconde moitié du XVIIIes., il est ainsi
apparu que le regard porté par les fondateurs de la science économique sur l’Antiquité avait
très tôt imposé des objets et des cadres de réflexions qui conservaient, encore aujourd’hui, une
certaine actualité. Depuis lors, les échanges entre les deux disciplines ne se sont jamais
complètement interrompus et il est peu original de constater que quelques-unes des grandes
évolutions de la pensée économique ont plusieurs fois déterminé l’apparition de courants
historiographiques majeurs.
Tout en ayant pleinement conscience que les ambitions modestes de ce mémoire ne
permettaient pas de conduire une analyse poussée des interactions qui unissent ou opposent les
points de vue des économistes et des historiens sur l’Antiquité, il a semblé utile de s’attacher à
décrire l’émergence de plusieurs de ces outils conceptuels, de déterminer l’ampleur de leur
appropriation ou de leur rejet par les spécialistes de Rome et de la Gaule et finalement de
reconnaître leur assimilation, plus ou moins consciente, par les archéologues qui s’intéressent
aux campagnes gallo-romaines. Afin de comprendre les connexions et la cohérence de ces idées
avec les théories économiques qui les ont portées, ce projet imposait de présenter rapidement
ces systèmes de pensée. Ce mémoire mêle donc, de manière peut-être un peu hétéroclite, des
descriptions archéologiques très pointues et des commentaires des travaux d’A. Smith, de J.-
B. Say, de J. Simonde de Sismondi ou des membres influents de l’école historique allemande
d’économie. Ces paragraphes, scolaires et nécessairement incomplets, ne se placent pas sur le
même plan que les exégèses qui leur ont été consacrées. Ils n’ont pas d’autre dessein que de
tenter de restituer des filiations oubliées aujourd’hui, en espérant que cette recherche de
paternité incite les archéologues à prendre conscience de l’obsolescence, de la fragilité ou au
contraire de la pertinence de références qu’ils utilisent sans toujours connaître l’origine. Selon
ces mêmes principes, un chapitre devait être entièrement dédié à l’analyse marxiste de l’histoire
et de l’économie antiques, aux travaux de M. Weber, de K. Polanyi et de M. I. Finley. La
matière en a été rassemblée, mais faute de temps elle n’a pu être complètement ordonnée et
présentée dans ce mémoire. Si le jury trouve quelque intérêt au travail qui lui est soumis, ce
nouveau chapitre pourrait être ajouté à une version corrigée du texte présent.
Cependant, l’histoire agraire de l’Antiquité ne se confond pas complètement avec celle des
écoles économiques qui ont pu s’y intéresser. Elle s’est aussi construite autour de débats et de
conflits historiographiques majeurs qui continuent encore d’influencer son parcours récent.
Ainsi, l’étude des campagnes gauloises est fortement dominée par les discussions sur les causes,
les modalités et les conséquences des deux conquêtes : celle de Rome et des peuples
germaniques. Ces interrogations immémoriales ont pris un tour très particulier dans le
contexte spécifique de l’histoire des États européens aux XIXeet XXes. Des thèmes comme

Introduction 5
l’incorporation de la Gaule à l’Empire, la « romanisation » de ces territoires, les formes de cette
acculturation et les relations du nouvel ensemble avec la puissance conquérante sont entrées en
résonance avec les préoccupations philosophiques et politiques de toute une génération
d’historiens sur le rôle et la fonction de l’État et de la nation, du droit et des institutions, de
l’individu et de la société. De cela il fallait rendre compte, non seulement parce que ces
réflexions sont dominées par les imposantes statures de N. Fustel de Coulanges,
. Mommsen et C. Jullian, mais aussi parce que ces débats et les constructions
historiographiques qu’ils ont suscitées prédisposent toujours, de façon latente, de nombreuses
recherches actuelles.
Enfin, les recherches documentaires réalisées pour ce mémoire ont fait apparaître le profit
que l’on pouvait tirer d’une petite histoire de l’émergence de la discipline archéologique et plus
particulièrement de sa composante gallo-romaine et rurale. Des bribes de cette réflexion
épistémologique sur le statut de l’archéologie et ses rapports avec les autres disciplines sont
présentées de manière dispersée tout au long de ce mémoire. Malgré quelques escapades dans
les productions de la Belgique et des pays de langue allemande, cette analyse est trop
ethnocentriste pour être complètement efficace. Elle mériterait donc d’être approfondie et
surtout élargie à d’autres pays européens.
Organisée autour de ces trois thèmes principaux, l’historiographie proposée dans ce
mémoire n’ambitionne donc pas d’être exhaustive. Elle ne constitue qu’un parcours subjectif et
partiel dans une production qui n’a pu être appréhendée globalement. Selon la belle formule
de J.-M. Carrié, elle tente simplement de reconstituer un « roman des origines » et d’identifier
« ses fantasmes et ses fixations » 2en espérant que cet exercice ait quelques vertus heuristiques.
Afin de faciliter la compréhension de ces généalogies, des schémas de synthèse des relations
entre les auteurs et les idées présentées dans ce mémoire ont été ajoutés, dans les annexes, à un
inventaire des œuvres étudiées.
Soucieux de ne pas laisser le lecteur face à une tabula rasa, à partir des enseignements tirés
de ces analyses historiographiques, il a semblé utile de clore ce mémoire par une réflexion plus
personnelle sur l’économie agraire gallo-romaine. Comme elle ne pouvait s’appuyer sur un
corpus complet et solidement établi, elle a pris la forme d’un essai théorique illustré de
quelques exemples suggestifs. L’usage déterminera si les outils forgés à cette occasion sont utiles
pour mieux appréhender le réel. Quelle que soit cette réussite, ce dernier chapitre présente au
moins l’intérêt de dessiner les contours de recherches qu’il serait judicieux d’entreprendre pour
renouveler certaines des connaissances acquises sur les campagnes gallo-romaines.
Alors que l’aventure intellectuelle commencée il y a près de trois ans touche maintenant à sa
fin, je souhaite exprimer toute ma gratitude à M. le Professeur François Favory qui a accepté
de diriger ce travail, en a facilité grandement la réalisation à l’université de Franche-Comté et a
éloigné à plusieurs reprises de ma nef fragile les écueils administratifs qui s’étaient dressés sur
sa route. Ainsi, je n’oublie pas que son intervention efficace a obligé le ministère de la culture à
honorer sa signature et a permis mon détachement auprès du CNRS. Ma reconnaissance va
aussi aux membres de la section no32 du comité national de la recherche scientifique qui
m’ont fait confiance et ont favorisé ce détachement ainsi qu’aux collègues de la maison de
l’archéologie et de l’ethnologie René Ginouvès de Nanterre qui m’ont si gentiment accueilli.
Cet hommage s’adresse tout particulièrement à Mme Fanette Laubenheimer, à Fernand Avila
et à l’équipe de la bibliothèque de la MAE.
2Carrié, 1983, p. 244.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
1
/
250
100%