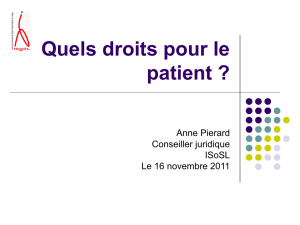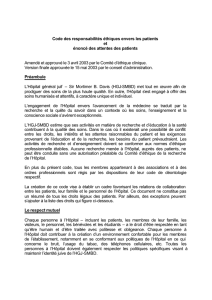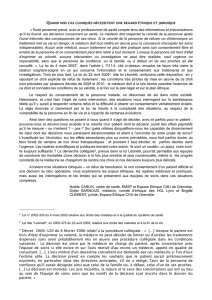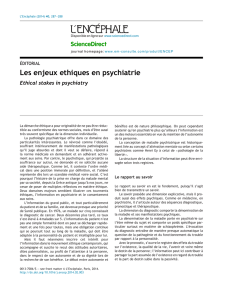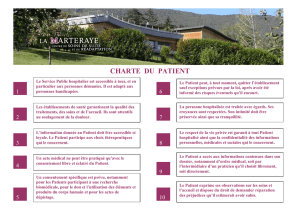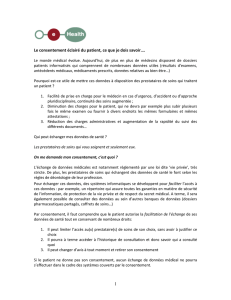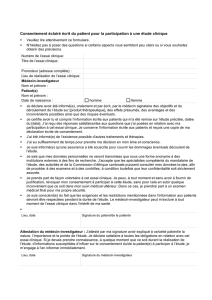Le paradoxe du respect du consentement dans les soins sous

Journal Identification = IPE Article Identification = 0806 Date: August 31, 2011 Time: 11:57 am
L’Information psychiatrique 2011 ; 87: 459–65
PSYCHIATRIE PUBLIQUE, ENTRE NORME ET LIBERTÉ
Le paradoxe du respect du consentement
dans les soins sous contrainte : entre norme
juridique et éthique psychiatrique
Georges Berthon
RÉSUMÉ
La fiction juridique du consentement conc¸u comme l’aboutissement d’une décision rationnelle venant d’en haut doit être
confrontée et non opposée à la réalité médicale d’un consentement progressivement élaboré, enraciné dans l’inconscient.
Dans le cas des soins sous contrainte, l’éthique psychiatrique, indissociable de l’intention thérapeutique, ouvre la possibilité
de dépasser le paradoxe du respect du principe du consentement par le respect de la dignité de son élaboration.
Mots clés : hospitalisation sous contrainte, consentement aux soins, droit du malade, éthique, hospitalisation à la demande
d’un tiers, loi de 1990
ABSTRACT
The paradox of compliance with consent in stress care: between the legal standard and psychiatric ethics. The legal
fiction of consent conceived as the result of a rational decision made by the higher-ups must be confronted and not opposed
to the reality of medical consent, which has gradually evolved and is rooted in the unconscious. In the case of care under
stress, psychiatric ethics, inseparable from therapeutic intent, opens the possibility to overcome the paradox of the principle
of consent by respect for the dignity of its development.
Key words: forced hospitalisation, consent to treatment, ethics, hospitalisation at the request of a third party, law of 1990
RESUMEN
La paradoja del respeto al consentimiento en la obligación de cuidados: entre norma jurídica y ética psiquiátrica. La
ficcción jurídica del consentimiento considerado como punto final de una decisión racional desde lo alto ha de confrontar y
no oponerse a la realidad médica de un consentimiento paulatinamente elaborado, arraigado en lo inconsciente. En el caso
de la obligación de cuidados, la ética psiquiátrica, imposible de disociar de la intención terapeútica, abre la posibilidad de
superar la paradoja del respeto al principio del consentimiento mediante el respeto a la dignidad de su elaboración.
Palabras claves : obligación de hospitalización, consentimiento a los cuidados, derecho del enfermo, ética, hospitalización
a petición de un tercero, ley de 1990
Psychiatre, chef de service, centre hospitalier Jacques-Lacarin, BP 2757,
03207 Vichy Cedex, France
<georges.berthon@ch-vichy.fr>
Tirés à part : G. Berthon
doi:10.1684/ipe.2011.0806
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 87, N◦6 - JUIN-JUILLET 2011 459
Pour citer cet article : Berthon G. Le paradoxe du respect du consentement dans les soins sous contrainte : entre norme juridique et éthique psychiatrique. L’Information
psychiatrique 2011 ; 87 : 459-65 doi:10.1684/ipe.2011.0806
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 0806 Date: August 31, 2011 Time: 11:57 am
G. Berthon
Le principe général du respect
du consentement
La loi Kouchner1[20] a mis le principe du respect du
consentement éclairé au cœur des relations de soin pour res-
pecter l’autonomie des patients. Le respect de l’autonomie
est une valeur venue historiquement du monde anglo-
américain et traditionnellement opposée à la bienfaisance
dont l’excès s’appelle le paternalisme. Si la loi Kouchner
retient l’attention, c’est non seulement car elle réunit des
usages consacrés par des textes de portées et d’importances
diverses en une même loi, mais c’est aussi parce qu’elle
traduit l’influence de la pensée anglo-américaine avant tout
soucieuse de renforcer la liberté individuelle des personnes.
La France a quant-à elle souhaité accorder également une
importance accrue à l’autonomie2[21], et au consentement
informé qui est le garant effectif de son respect, pour amé-
liorer la relation entre un soignant et un soigné, c’est-à-dire
pour rétablir une sorte d’égalité entre eux. On reconnaît là
au passage un raisonnement typiquement juridique par la
recherche de règles tendant à compenser « l’asymétrie » de
fait entre un malade, d’une part, et, d’autre part, quelqu’un
en bonne santé et qui dispose du savoir. Le fait de placer
l’exigence du consentement informé aux soins au centre
de la relation médecin-malade a soulevé bien sûr le pro-
blème des situations où le patient n’est pas en mesure
de disposer de l’exercice de son consentement. Toutefois,
s’agissant d’un principe de portée générale, le législateur a
préféré énoncer un texte applicable à tous les types de soins
plutôt que de prendre en compte la spécificité des soins psy-
chiatriques. Il a en effet été retenu qu’il était encore plus
important de ne pas prendre le risque d’une stigmatisation
des patients psychiatriques qu’une telle prise en compte de
leur spécificité aurait pu créer. Mais, le choix louable de
ne pas traiter à part les patients psychiatriques pour ne pas
faire d’eux des citoyens de seconde zone pose néanmoins la
question du statut des patients hospitalisés sans leur consen-
tement. Si la loi considère le respect du consentement aux
soins comme la marque essentielle du respect des personnes
en matière de soins, alors, sur quoi peut bien se fonder le
respect à leur égard, voire de quel respect peuvent-ils rele-
1Cette loi « relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé », dans son titre 2, intitulé « Démocratie sanitaire », comporte
plusieurs chapitres consacrés à ce qui constitue désormais l’assise juri-
dique de la relation soignant/soigné, avec en particulier la légalisation de
la communication directe du dossier médical au patient qui le demande.
Il a été retenu que la psychiatrie ne constitue pas un cas à part, même si
des modalités d’accompagnement à la communication directe du dossier
sont spécialement prévues pour protéger les patients en hospitalisations
sous contrainte d’éventuels préjudices lors la lecture de leur dossier (art.
1111-7 du Code de la santé publique).
2Aux États-Unis, l’autonomie est subjectivement fondée et renvoie au
concept de « privacy » plutôt qu’à une autonomie objective basée sur une
rationalité partageable. À l’inverse, en France, la notion d’autonomie est
envisagée sous son aspect rationnel.
ver ? En renonc¸ant à cette prise en compte de la spécificité du
soin en psychiatrie pour ne pas risquer d’attirer une attention
soupc¸onneuse à l’égard du malade mental, on retrouve fina-
lement quand même la question de savoir comment adapter
un principe général de respect de l’autre, de tous les autres,
pour le malade mental qui risque de ne pas se voir accorder
une dignité égale à celle des autres.
Droit et éthique
En ce cas, quelle est la nature du respect, ou ce qu’il en
reste, à l’égard de ce malade qui ne peut pas s’exprimer et
décider de soins pour une pathologie dont il ne reconnaît
souvent pas l’existence ? La tentation est grande de retenir
de ces contradictions que c’est la loi qui fait fausse route par
rapport à une réalité qu’ignorent manifestement la grande
majorité des députés et sénateurs dont quelques-uns avaient
pourtant bien perc¸u qu’il y avait là un problème avec la psy-
chiatrie, mais sans pouvoir aller au-delà de cette intuition
qu’il ne faut pas en démocratie faire de texte à part pour
une catégorie d’hommes, au risque d’en faire des hommes
à part. Chacun sait bien aussi l’importance de la loi en psy-
chiatrie, c’est-à-dire d’un point de vue psychopathologique
et il est donc exclu d’envisager une relation de soins, igno-
rante, voire en opposition, avec un principe général de la loi.
Il n’est pas acceptable non plus de concevoir les hospitalisés
sous contrainte comme soumis à une dérogation à la norme
juridique valable pour tous les autres. Cela reviendrait en
effet à considérer ces patients comme des exceptions en
matière de respect et le recours fréquent à la contrainte
physique dans ces cas renforce cette impression. Comment
concilier alors la norme du respect du consentement avec la
nécessité indiscutable de prendre en charge ces patients ?
À la suite du Code de Nuremberg de 1947, le rapport Bel-
mont [5] ajoute à la valeur traditionnelle de bienfaisance à
l’égard du patient, cela remonte à Hippocrate, l’attention
plus récente portée au respect de son autonomie. Le rap-
port Belmont, qui date de 1976, est un texte intéressant
car ce rapport parlementaire, véritable référence éthique et
médico-légale de la recherche clinique aux États-Unis est
mondialement considéré comme une référence en matière
de pratiques médicales. Il a l’avantage de manifester en lui-
même les traces de sa culture d’origine américaine, ce qui
du point de vue de la compréhension actuelle des relations
qu’entretiennent mutuellement les notions de respect du
patient, de son autonomie et de la liberté est tout à fait capi-
tal. Au sujet du respect des personnes, on peut lire dans ce
rapport:«Lerespect de la personne regroupe au moins deux
convictions éthiques : premièrement, les personnes doivent
être traitées comme des agents autonomes, deuxièmement,
les personnes avec une autonomie diminuée ont droit à une
protection. Le principe du respect de la personne se divise
donc en deux exigences morales distinctes : l’exigence de
reconnaître l’autonomie et l’exigence de protéger ceux qui
460 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 87, N◦6 - JUIN-JUILLET 2011
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 0806 Date: August 31, 2011 Time: 11:57 am
Le paradoxe du respect du consentement dans les soins sous contrainte : entre norme juridique et éthique
psychiatrique
ont une autonomie diminuée3[5]. » Finalement, on voit
ici que c’est l’idée de protection, c’est-à-dire relevant de la
bienfaisance, qui vient compenser le déficit d’autonomie.
Plutôt que de voir dans la réflexion éthique une fac¸on de
penser les soins en marge du droit, (cela est plus courant
qu’on ne le pense en matière de soins sous contrainte), il
nous apparaît plus intéressant de promouvoir une réflexion
spécifiquement soignante sur la thématique du respect du
consentement, sans pour autant contester au droit sa légiti-
mité d’édicter les règles du jeu démocratique dont le respect
du consentement aux soins fait partie. Souvent dans les
milieux médicaux, il est de bon ton de se plaindre de la
judiciarisation de la pratique médicale. La norme juridique
est notamment accusée de porter atteinte à l’indépendance
médicale et également de restreindre la prise de risques
pourtant souvent nécessaire en médecine et indissociable
de toute pratique soignante. Même si la peur du procès
modifie effectivement [8] les pratiques médicales, il n’est
pas légitime d’opposer ainsi deux modèles de pensée, il
faut peut-être dire deux cultures, car leur rôle n’est pas le
même dans une société. On sait aussi que le monde médical
a une sérieuse tendance pour revendiquer une indépen-
dance professionnelle qui masque parfois un réel souhait
d’affranchissement du droit lui-même4. Cela renvoie à la
question de savoir où est la frontière entre la soumission à
la loi et la résistance à cette dernière lorsqu’elle est injuste.
Mais, la résistance peut aussi ne pas être légitime, notam-
ment lorsqu’elle n’est en fait qu’un rejet péremptoire sans
argument. Au lieu de penser que le droit envahit toute la
société, le monde médical ne doit-il pas s’interroger sur son
manque de pensée à propos de ses propres pratiques ? Le
choix du législateur de la loi de 2002 de faire une loi géné-
raliste pour ne pas stigmatiser les malades psychiatriques
relève en quelque sorte de l’éthique politique. Le choix
d’une telle conception du consentement qui vient « d’en
haut » en postulant « un citoyen gérant sa maladie depuis
la tour de contrôle plus ou moins vigilante de son libre
arbitre » [4] est aussi en cohérence avec le droit qui énonce
que la liberté acquise par la raison doit être ce vers quoi
l’homme doit se tourner pour toujours plus s’hominiser.
Cela signifie en fait que l’homme libre, autodéterminé par
la raison, est une fiction. La conception juridique a entre
autre une mission civilisatrice d’énoncer le « devoir être »
et axe sa démarche intellectuelle sur la raison. Il n’en est
pas de même de la médecine, qui a pour mission de soigner,
3La perte de l’autonomie est détaillée plus loin de la fac¸onsuivante:«Tou-
tefois, les êtres humains ne sont pas tous capables d’autodétermination.
L’aptitude à l’autodétermination augmente au cours de la vie d’une per-
sonne, mais certaines perdent cette capacité partiellement ou totalement
en raison de maladies, de problèmes mentaux ou de circonstances qui
restreignent sérieusement leur liberté. Le respect des personnes manquant
de maturité ou incapables exige leur protection au cours de leur maturité
ou lorsque leurs capacités sont amoindries. »
4L’appellation « Droit médical » en est une des figures, sachant que ce
droit là proprement dit n’existe pas pour de nombreux juristes.
ne croit pas à ce qui doit être, mais seulement à ce qu’elle
constate.
Une réflexion de soignant
sur le consentement
Là où les représentants de la Nation manifestent leur sens
éthique, en ne soulignant pas sur la place publique la spé-
cificité de la catégorie sociale des malades psychiatriques,
pour nous psychiatres, il n’en va pas de même sur le plan
éthique dans l’espace protégé du soin et où nous sommes
animés de l’intention thérapeutique. Il est en effet de notre
devoir de souligner cette fois les spécificités des patients
que nous soignons, pour mieux les faire respecter par une
lecture clinique de leur situation. Nous avons la possibi-
lité, notamment dans l’espace protégé de l’hôpital public,
de promouvoir auprès des patients une pratique médicale
préparatoire et anticipatrice de ce à quoi la citoyenneté les
appelle. L’intention thérapeutique est bien le vecteur d’un
tel accompagnement vers l’autonomie du patient, c’est-à-
dire vers un statut d’égale citoyenneté et de respect. Le
défi de souligner la spécificité de cet accompagnement pro-
moteur de dignité pour les patients est bien constitutif de
l’éthique psychiatrique, laquelle est consubstantielle pour
nous de l’intention thérapeutique5. En tant que médecins,
nous savons qu’il nous incombe de penser nos pratiques et
notamment, d’avoir une réflexion sur les outils dont nous
nous servons. Or, certains de ces outils ne viennent pas de
la médecine mais du monde juridique, comme le consente-
ment, même si la médecine avait depuis longtemps l’usage
de ce terme pour désigner de fac¸on plus vague la confiance
du patient accordée à son médecin. L’idée qu’il existe un
conflit entre la pratique médicale et la norme juridique, ne
constitue pas en soi, à notre avis, un obstacle pour pen-
ser à plusieurs, soignants et non soignants, la question du
consentement de ceux et celles qui du fait de la maladie ne
sont plus en mesure de s’exprimer valablement au sens d’un
consentement valide au regard de la loi. La culture classique
psychiatrique nous enseigne la place de l’ambivalence,
des conflits intrapsychiques et de l’inconscient, pour ne
parler que des aspects non pathologiques du psychisme,
dans la compréhension que nous pouvons saisir d’une vie
humaine effectivement rebelle à toute intelligibilité pure-
ment rationnelle et consciente. Déjà, la médecine somatique
sait combien elle peut témoigner par exemple de ces
patients cancéreux qui s’autogouvernent de fac¸on tout à fait
paradoxale, conciliant par exemple, la connaissance d’un
pronostic fatal à court terme avec l’aptitude pour faire des
projets de vacances. C’est donc à cet homme transformé,
5L’intention thérapeutique est ce par quoi la relation prend un sens éthique
spécifique qui la distingue de l’éthique propre à d’autres relations interper-
sonnelles. L’éthique du soin est en ce sens distincte de celle de la recherche,
même si elles partagent des notions éthiques communes.
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 87, N◦6 - JUIN-JUILLET 2011 461
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 0806 Date: August 31, 2011 Time: 11:57 am
G. Berthon
dans ce type particulier d’état de conduite de lui-même, que
l’homme de loi lui demande d’être attentif pour recevoir
des informations sur sa santé afin de l’éclairer sur ce qu’il
a. Sauf que ce qui est éclairé n’est pas sa raison d’homme en
bonne santé, mais ce qui assure son autogouvernement du
moment, lequel fait moins de place à la raison consciente
qu’à d’autres instances. Par ailleurs, la médecine sait aussi
qu’elle ne sait pas grand-chose de la liberté mais seule-
ment que le malade en a moins l’usage. Le médecin sait
en effet que, abasourdi par l’annonce du cancer ou par la
catastrophe du délire schizophrénique, le patient n’est plus
aussi libre qu’avant cet état et qu’il fait moins, ou plus du
tout, appel à sa raison pour « tenir », c’est-à-dire pour se
maintenir en équilibre et se raccrocher à la vie. Canguil-
hem évoque au sujet de la maladie qu’elle est une forme
de norme que la vie produit à ce moment, pour bien signi-
fier en quoi le vivant tente de maintenir un équilibre que
la seule raison consciente n’est pas à même d’expliciter :
« L’anormal n’est pas tel par absence de normalité. Il n’y
a point de vie sans normes de vie et l’état morbide est tou-
jours une certaine fac¸on de vivre [7]. » On sait qu’il existe
plusieurs fac¸ons d’aborder la question du consentement en
psychiatrie. Par exemple, certains l’abordent sous l’angle
de la difficile pratique de la recherche dans notre discipline
[1, 9, 17], d’autres sous la forme du consentement au savoir,
qui prend une forme particulière en psychiatrie, notamment
en psychothérapie [14, 16]. Toutefois, ces exemples nous
montrent tous que nous sommes encore ici dans une concep-
tion du consentement qui se situe en prolongement de la
médecine somatique, c’est-à-dire pour des patients à qui
on s’adresse pour savoir ce qu’ils veulent. Ces approches
soulignent finalement un peu plus combien il reste une caté-
gorie qui fait exception, celle des personnes à qui on ne
s’adresse pas de cette fac¸on car ils sont réputés ne rien
vouloir valablement.
Le consentement des hospitalisés
sans consentement
Nous pensons qu’il est pourtant possible d’aborder le
soin sans consentement tout en donnant une place, c’est-
à-dire ici en accordant de l’importance, à ce qui précède
l’émergence du consentement, ce qui à notre sens de psy-
chiatre en fait déjà partie. Si on examine la séquence de
soins particulière qui est celle qui précède le moment de
la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, on
voit que ce moment de la relation médecin-malade, qui peut
durer quelques jours ou quelques semaines, voire plusieurs
mois, est partageable dans sa description avec des partenai-
res du monde juridique. Nous n’aborderons pas le problème
difficile de la crédibilité du psychiatre demandeur d’une
cessation de la contrainte face à l’autorité préfectorale en
matière d’HO, car il y là manifestement des éléments exté-
rieurs à la relation de soin, ce qui, tout en étant d’actualité,
mériterait un développement spécifique qui n’a pas sa place
ici. Abordons seulement le cas de la levée d’HDT, qui
s’élabore selon l’observation clinique de ce qui aux yeux
du praticien constitue la marche du patient vers ce que
nous appelons une réappropriation de la maladie par un
patient progressivement conscient de la réalité. Effective-
ment, on pourrait résumer cela comme étant une marche
ou un retour vers la raison, vers l’aptitude à consentir. En
tant que psychiatres, nous sommes fondés à témoigner que
la relation de soin est bien ce par quoi un médecin et un
patient vont progressivement faire alliance de fac¸on de plus
en plus argumentée, et l’information fait partie de ce proces-
sus, au point qu’à un moment le médecin va estimer que le
patient peut à nouveau être considéré comme apte à décider
de lui-même de la poursuite des soins. Afin de concen-
trer notre réflexion sur le consentement du patient, nous
n’aborderons pas le thème difficile de l’évaluation médi-
cale de l’aptitude à consentir que nous avons abordé dans
un autre travail [6]. L’observation de l’évolution clinique
du patient est une situation privilégiée pour mieux connaî-
tre la nature du consentement envisagée sous l’angle de sa
genèse, c’est-à-dire l’élaboration progressive de ce que le
juriste appellera plus tard le consentement libre. N’avons-
nous pas, nous psychiatres, à témoigner de ce processus et
à proposer une lecture clinique d’intelligibilité accessible
à l’autre interlocuteur qu’est le juriste ? Cette perspec-
tive dynamique du consentement n’est pas l’apanage du
soin psychiatrique sous contrainte car on peut aussi voir
cela très fréquemment dans notre pratique au fil de soins
psychothérapiques au long cours. La remarque est bien
entendu valable aussi hors du champ psychiatrique avec
par exemple l’observation du patient cancéreux, un temps
anéanti par le bouleversement de toute sa personne et qui
va peu à peu « recouvrer sa raison ». Mais, la pratique
de la levée de la mesure d’HDT va plus loin en ce sens
qu’elle met spécialement le médecin et le patient dans une
dynamique, non seulement d’accompagnement thérapeu-
tique élaboré sur la durée, mais qu’elle pose directement
la question du statut du consentement comme étant rece-
vable ou pas. L’idée même d’un consentement émis à un
instant précis, cher aux juristes, est ici complétée en amont
par l’observation sur la durée de l’homme malade qui part
« d’en bas », dans sa marche, maladroite et incertaine, en
direction de cet état idéalisé de l’homme libre et apte à
exercer son consentement. L’observation clinique de ce qui
fait l’autogouvernement d’un patient en HDT, nous montre
à quel point il est d’abord coûteux pour ce patient de sur-
vivre avant même qu’il ne se pose la question de savoir ce
qu’il doit faire, se soigner, s’écouter, ou encore écouter l’un
plutôt que l’autre. La médecine est en mesure de décrire
une part de ces processus vitaux mis en œuvre, qui vont
du stress sur le plan biologique aux schémas d’adaptations
psychologiques les plus complexes. « C’est d’abord parce
que les hommes se sentent malades qu’il y a une méde-
cine, [laquelle est] une activité qui s’enracine dans l’effort
462 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 87, N◦6 - JUIN-JUILLET 2011
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 0806 Date: August 31, 2011 Time: 11:57 am
Le paradoxe du respect du consentement dans les soins sous contrainte : entre norme juridique et éthique
psychiatrique
spontané du vivant pour dominer son milieu et l’organiser
selon ses valeurs de vivant [...]. Voilà pourquoi, sans être
elle-même une science, la médecine utilise les résultats de
toutes les sciences au service des normes de la vie [7]. »
Toutes ces observations démontrent à quel point la consci-
ence raisonnée n’est pas au premier plan pour des processus
biologiques évidemment inconscients et pour des processus
psychologiques dont la dimension non argumentée cons-
ciemment se constate tout autant et l’on sait que « dans
ses derniers ouvrages, Freud allait insister sur les aspects
biologiques du moi, en lui attribuant des caractéristiques
innées et en faisant de l’instinct de conservation une de
ses fonctions essentielles » [10]. Dans le cadre de la rela-
tion de soins, l’approche scientifique des processus mis en
œuvre par les patients a permis à la psychiatrie de produire
des modèles de compréhension de la réorganisation de la
subjectivité. Le travail que les patients accomplissent ainsi
pour redevenir eux-mêmes fait bien partie de ce à quoi nous
assistons avec respect au cours de cette relation médecin-
malade. Attribuer de la grandeur à cet effort du patient
et y compris dans le conflit avec son thérapeute, c’est lui
accorder une dignité, c’est-à-dire notamment, reconnaître
la dignité de l’élaboration d’un consentement à venir. Dans
l’espace confidentiel et protecteur du monde hospitalier,
c’est déjà reconnaître au consentement toute sa valeur dès
les premiers instants fragiles de son émergence. C’est aussi
préparer le patient à son retour à la vie ambulatoire, c’est-
à-dire sur la scène publique, là où le juriste l’accueille pour
le recevoir comme citoyen apte à consentir. Cela signifie
l’importance de l’éthique du soin psychique en tant que
processus relationnel, à la fois comme acte thérapeutique et
intention de réinsertion. Vouloir soigner et vouloir le retour
d’un consentement libre sont ici confondus en un même
processus d’information mutuelle visant l’autonomie. Cela
n’est possible que par la reconnaissance et le respect des
processus vitaux et psychopathologiques mis en œuvre au
cours de cette séquence. La culture psychiatrique euro-
péenne, par l’importance qu’elle accorde à la subjectivité,
considère en effet que ces processus ont directement à voir
avec ce qui constitue la subjectivité d’une personne. De
ce fait, l’ensemble de ces processus doit jouir de la dignité
accordée à l’humain en général. Cela signifie une continuité
de la culture psychiatrique avec l’humanisme et donc aussi
avec le droit qui s’en réclame encore. [9] Cela signifie une
continuité de l’approche déterministe de la science, avec la
culture. On a ici toute la problématique médicale de la ren-
contre de l’homme confronté à l’association de l’expérience
vécue, de sa raison et de son animalité. Henry Ey, dans la
préface à la deuxième édition des Études psychiatriques,
s’exprime ainsi avec des accents évoquant la conception
de la maladie de Georges Canguilhem:«Endépit des cri-
tiques contradictoires et qui de ce fait s’annulent, je continue
à faire une psychiatrie qui intègre comme dans la nature
des choses, la personne humaine, son “être au monde”, son
intentionnalité dans l’accident qu’est toujours une maladie.
C’est-à-dire que je considère la “maladie mentale” pour ce
qu’elle est : un “équilibre” dans le déséquilibre – un modèle
d’existence, vivant le déficit et l’impuissance – une fac¸on
de s’accommoder à la catastrophe, mais sans oublier que,
tout de même que le rêve dépend du sommeil, cet équi-
libre, cette réaction, cette forme d’existence dépendent du
déséquilibre, du déficit et de la désorganisation vitale. Et
cette “catastrophe vitale” c’est non pas seulement une situa-
tion “malheureuse” passée ou présente, mais la maladie
qui altère la “mise en situation” et ne permet plus à l’être
d’y réagir autrement qu’avec des moyens inférieurs et à
des niveaux inférieurs [11]. » Toutefois, le déterminisme si
souvent évoqué par les savoirs de toutes sortes ne doit pas
pour autant démobiliser l’être humain engagé dans un effort
d’hominisation, ce qui a fait dire à Hannah Arendt:«Ilest
vrai que la psychologie, la sociologie modernes, sans par-
ler de la bureaucratie moderne, nous ont bien habitués à
évacuer la responsabilité de l’acteur pour ses actes en les
expliquant par tel ou tel déterminisme. Que ces explications
apparemment plus profondes des actions humaines soient
justes ou pas, voilà qui est discutable. Mais, ce qui est hors
de discussion est qu’aucune procédure judiciaire ne serait
possible sur ces bases et qu’à l’aune de telles théories, la jus-
tice n’est pas du tout une institution moderne, elle est même
tout à fait démodée. Quand Hitler disait qu’un jour viendrait
en Allemagne où la profession de juriste serait considérée
comme “honteuse”, il exprimait seulement, avec une cohé-
rence extrême, son rêve d’une bureaucratie parfaite [2]. »
La médecine et le droit peuvent et doivent ainsi s’accorder
sur le respect de l’humain, chacun dans son domaine. Nous
pensons qu’il est essentiel que la psychiatrie et chaque
psychiatre conservent une liberté d’interprétation concer-
nant l’organisation psychologique d’un patient. Mais, on
sait aussi que cette interprétation peut être contestée par
les tenants d’une autre école en termes de référence théo-
riques quant à sa représentation du psychisme humain et
donc à ce qu’est l’homme. Cela a une implication d’ordre
éthique. En effet, le recours à une théorie médicale psy-
chiatrique quelle qu’elle soit, si elle inclut une conception
globale de l’homme, aura pour conséquence de permettre
de penser les questions éthiques selon le même registre que
les questions cliniques, puisqu’en définitive, la question de
la liberté du patient en est une thématique centrale. Mais,
qu’en est-il si ce n’est pas le cas ? C’est ce que Jean-Jacques
Kress exprime en ces termes:«Toutd’abord, qu’est-ce
qui spécifie une question éthique pour la psychiatrie ? [...]
Une question éthique est toujours liée à celle du sujet, elle
concerne la reconnaissance de la place que les épistémo-
logies lui accordent, puis la prise en considération de son
autonomie, de sa liberté, de son statut individuel par rapport
aux actes que le savoir exerce sur lui, elle concerne aussi
dans le cadre de la relation avec le psychiatre la prise en
compte de son histoire. Ensuite, il y a lieu de se demander
avec quels concepts et quels systèmes de représentations
ces questions peuvent être posées et élaborées. S’agit-il des
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 87, N◦6 - JUIN-JUILLET 2011 463
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%