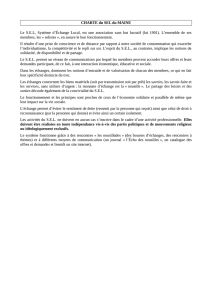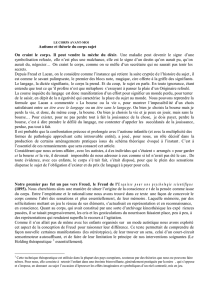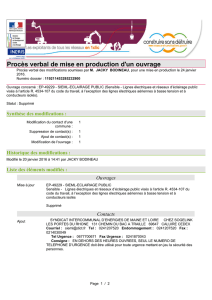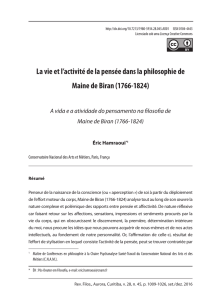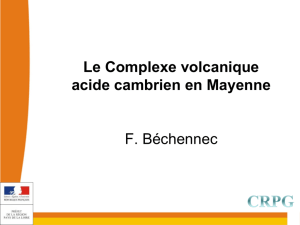L`effort

Édition du site « PhiloSophie »
Bernard Duburque
L’EFFORT
Mémoire de Maîtrise en Philosophie réalisé sous la di-
rection de Monsieur le Professeur Nicolas Grimaldi.
(septembre 1990)
UNIVERSITE PARIS IV
U. E. R. de Philosophie

Table des matières
Introduction..............................................................................4
Première section : descriptif de l’effort ....................................9
I. Portique ...................................................................................10
II. Table des efforts..................................................................... 15
Table des efforts ........................................................................ 16
A — L’effort selon la durée. ................................................... 16
B — L’effort selon sa nature. ..................................................17
C. L’effort selon les êtres. ......................................................23
D. Selon la finalité. ................................................................25
III. L’effort biranien....................................................................32
IV. L’effort intellectuel................................................................45
V. Effort et durée ........................................................................ 51
Deuxième section : Dynamique de l’effort. ............................62
I. Problématique de la dynamique de l’effort ............................63
II. L’effort selon Saint thomas d’Aquin......................................66
III. L’effort exténué.....................................................................70
1. L’effort sans effort (Spinoza).................................................70
2. L’effort « inquiet » (Leibniz).................................................78
3. L’effort illusoire ? (Malebranche) .........................................86
IV. L’effort selon Saint Augustin................................................93
V. L’effort Stoïcien......................................................................99
VI. Effort et liberté....................................................................105
Conclusion ............................................................................ 118
Bibliographie.........................................................................120
I — Œuvres de Maine de Biran................................................ 120
II — Œuvres sur Maine de Biran............................................. 120
III — Œuvres diverses. .............................................................121

Introduction
Il est permis de s’interroger sur le bien-fondé d’un mé-
moire de philosophie qui prend l’effort pour objet. L’effort ne
serait-il pas avant tout un phénomène physiologique qui doit
s’étudier en laboratoire ? Et s’il est juste que le philosophe y ré-
fléchisse, l’effort ressort-il à la psychologie ? A la morale ? Voire
à l’ontologie ?
Non pas que l’effort serait un terme incongru dans la lan-
gue philosophique. Il a été employé par suffisamment d’auteurs,
et parmi les plus grands, ainsi que nous le verrons.
Mais l’usage d’un terme par les philosophes ne suffit certes
pas à le consacrer comme objet d’interrogation philosophique.
Que les anciens aient souvent pris le goût et ses perversions
comme exemples sur lesquels appuyer leurs théories de la
connaissance, n’implique pas que le goût en tant que tel soit
digne d’une investigation philosophique.
D’autant que nous savons combien grand est l’écart entre le
philosophe de l’antiquité et le philosophe moderne. Tous deux
certes sont « amis de la sagesse », mais les premiers étaient au-
tant « savants » que « philosophes ». Au philosophe du ving-
tième siècle il est contesté qu’il quitte le domaine spéculatif.
Tout ce qui peut donner lieu à expérimentation, à observation, à
mesure, lui est ôté, et attribué à la science.
Ainsi, l’effort en tant que tel pourrait apparaître comme un
phénomène humain étranger au champ philosophique. La vo-
lonté, la liberté, voilà qui trouve sa place dans la réflexion du
philosophe. Mais l’effort ? N’est-il pas comme le sous-produit de
ces facultés ?
— 4 —

C’est sans aucun doute à Maine de Biran que doit revenir le
mérite d’avoir, le premier, insisté sur la valeur de l’effort en tant
que soubassement de notre personne, de notre « moi ».
« Il y a bien longtemps que je m’occupe d’études sur
l’homme, ou plutôt de ma propre étude ; et à la fin d’une vie dé-
jà avancée, je pourrais dire avec vérité qu’aucun homme ne s’est
vu ou ne s’est regardé passer comme moi, alors même que j’ai
eu le plus de ces affaires qui entraînent ordinairement les
hommes hors d’eux-mêmes. Dès l’enfance, je me souviens très
bien que je m’étonnais de me sentir exister et j’étais porté,
comme par instinct, à me regarder en dedans pour savoir com-
ment je pourrais vivre et être moi »1.
La quête de son identité fut le moteur de la philosophie bi-
ranienne. Cela transparaît à chacune des pages de son journal,
qui fut cependant bien plus qu’un simple carnet de mémoires,
puisque contenant, épars, la substance de beaucoup de ses
écrits philosophiques.
On y découvre un être émotif, hypersensible — parfois
peut-être à la limite de l’hypochondrie — qu’un rien impres-
sionne, désarçonne : événements, réflexions, jusqu’aux varia-
tions climatiques.
C’est pour échapper à cette hyperémotivité que s’est faite la
méditation biranienne sur la volonté et l’effort, Maine de Biran
essayant de cerner une part de lui-même qui fût à l’abri des
multiples et incessantes influences du monde extérieur (et de
son propre organisme) pour s’y installer plus solidement.
1 Maine de Biran, Nouveaux essais d’Anthropologie, Vrin, 1989, p.
8.
— 5 —
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
1
/
124
100%