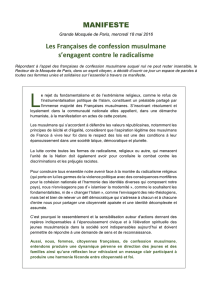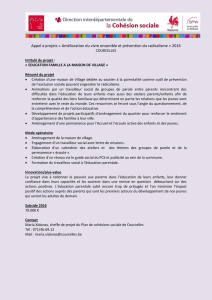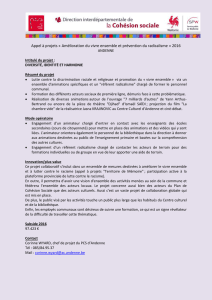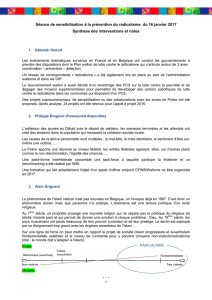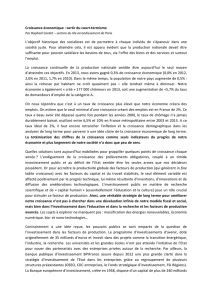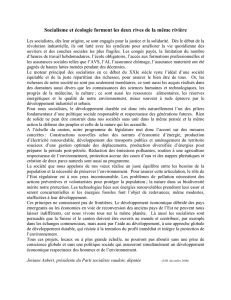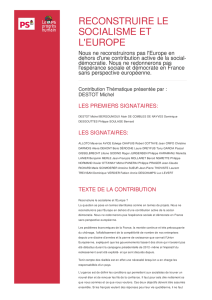Radicaux et socialistes au 20 siècle

Radicaux et socialistes au 20e siècle
Journée d’étude de l’IEP de Paris
Controverses et dialogues philosophiques
30 septembre 2005
T. Leterre
Le destin des idées philosophiques en politique est une étrange chose car il se prête tant aux
dénis les plus méprisants qu’aux reconnaissances les plus fracassantes. Le rôle de la
philosophie dans l’histoire politique peut s’envisager en effet de trois manières différentes en
effet. Il y a d’abord la récusation pure et simple qui veut balayer dialogues et controverses
philosophiques d’un geste de la main, comme un habillage un peu lâche et irréaliste de la
politique réel. Au philosophe les prestigieuses illusions de la pensée, au politique, le souci
exact de réalités souvent triviales. Vieille formulation d’un problème qui remonte à Platon. A
l’exact opposé se situe l’idée d’une saturation de la politique par l’esprit : c’est le cas avec les
grandes philosophies de l’histoire, celle de Hegel par exemple. Un autre registre, plus récent,
d’inspiration plus méthodologique considère que l’approche philosophique constitue un mode
de compréhension de la politique, ou de certains de ses aspects. C’est le principe de
renouvellement de l’histoire conceptuelle du politique avec Pierre Rosanvallon ou encore
Lucien Jaume.
Pourtant, l’histoire de la gauche, et notamment de la gauche française, permet de dégager un
autre type de position : l’idée philosophique comme ressource politique. Pour la gauche en
effet, la réflexion ressortit jusqu’à un certain point d’une évaluation des ressources politiques,
c’est-à-dire d’une évaluation des moyens d’action disponibles — et c’est ce que dit Ferdinand
Buisson lorsqu’il dit que la doctrine radicale est une doctrine d’action. Inévitablement, les
clivages de famille, et notamment la séparation des radicaux et des socialistes, a dû se traduire
par des divorces intellectuels nets : les ressources politiques mobilisées étaient divergentes.
(…)
Cette importance de la pensée à gauche n’est pas, du moins dans la période qui sépare la
fondation du parti radical en 1901 et celle de la SFIO en 1905 et le Cartel des gauches,
simplement un phénomène idéologique. Elle est aussi un facteur de sociologie politique non
négligeable. Certes, la réflexion philosophique joue un rôle important à gauche, au point
qu’on voit ce jeune médecin nommé Clémenceau qui traduit l’Auguste Comte de Mill, ou que
l’animation de l’espace public revêt une importance explicite au point que les statuts de 1901
du parti radical désignent comme membre du parti les journalistes des organes de presse
défendant les idées radicales : c’est là qu’un philosophe sous le pseudonyme d’Alain va se
faire un nom. Elle se marque encore par le fait qu’observateurs et acteurs ne peuvent manquer
d’être frappés par la montée en puissance d’un personnel politique de gauche issu de
l’université. « Nous autres d’université » peut ainsi écrire Herriot en préfaçant les Pages
choisies de Ferdinand Buisson en 1933 , un an après la mort de ce dernier. Cette importance

des élites intellectuelles à gauche avait d’ailleurs pu faire dire à Albert Thibaudet que le Cartel
des gauches, c’était l’école normale supérieure qui succédait à la faculté de droit de Paris.
Herriot, Bouglé pour les radicaux, Jaurès, Blum, pour les socialistes, étaient en effet
normaliens, et le grand ancêtre Buisson était agrégé de philosophie.
Le point peut paraître plus surprenant pour les radicaux que pour les socialistes : pourtant ils
font partie d’une sphère intellectuelle de haut niveau, marquée par l’importance de
l’intelligentsia philosophique. On se représente trop souvent le radicalisme comme une
gauche de gouvernement, pragmatique, attaché à un programme progressivement devenu
obsolète (et clairement dépassé au lendemain de la première guerre mondiale) et obstinément
attaché à une vieille conception de la République dans une France qui change — cette vieille
conception qui faisait rire Alain lorsque, agent électoral de Louis Ricard, il entendait son
candidat en entonner les mérites à toute voix. Au mieux une idéologie progressivement
emportée par les faits, au pire, de vagues principes républicains bon teint qui prêtent à sourire
et que le vent d’une histoire tragique a soufflé comme une chandelle qui n’éclaira qu’un bout
de la longue nuit que fut le 20e siècle. La réalité est tout autre. Le radicalisme a longtemps (et
je dirai encore aujourd’hui) su attirer par la qualité de sa réflexion et sa contribution à la
réflexion « philosophique » sur la politique au sens large n’est pas négligeable.
C’est d’ailleurs pour cette raison que le rôle prépondérant du radicalisme dans le Cartel peut
être intimement lié aux yeux de Thibaudet à un moment d’intellectualisation de la politique.
(…)
L’essoufflement doctrinal des radicaux
Malgré tout, le Cartel marque une disjonction entre univers intellectuel et gauche radicale,
au moment où semble se marquer le triomphe même de ce radicalisme intellectuel. Une
anecdote l’indique. Gallimard, en 1924, flaire un bon coup de publicité en faisant distribuer au
conseil des ministres du Cartel les Eléments d’une doctrine radicale qu’Alain vient de
publier. Le geste est mal reçu et l’un des participants s’exclame « s’il y avait une doctrine
radicale, nous le saurions. » Le point est sensible, car le Cartel n’incarne pas encore le
radicalisme essoufflé d’un Daladier ou d’un Herriot de la dernière période. Après la chambre
bleue horizon, dans un contexte où la France doit liquider l’embarrassante équipée de la Ruhr,
emblème à gauche d’une politique d’agression bornée, et qui symbolise le mépris irréfléchi de
principes qu’on appellerait aujourd’hui « multilatéraux » des relations internationales, et au
moment même où il semble incarner cette « République des professeurs » dont parle
Thibaudet, le radicalisme s’absente de sa doctrine. Le fait n’est pas seulement du côté de la
pratique politique, si l’on y réfléchit. Après tout, Alain interrompt sa petite brochure Les
libres Propos, où il publie depuis trois ans ses articles hostiles à la politique « bleue horizon »,
en prétextant que maintenant que la gauche est au pouvoir, la réflexion critique est moins
urgente. Je puis certes faire la part des circonstances, dans cette décision : l’épuisement de ces
admirables éditeurs qu’ont été Jeanne et Michel Alexandre, la volonté d’Alain de renouer
avec la philosophie en quittant pour un temps son rôle d’intellectuel turbulent. Mais le
mouvement est peut-être plus profond. Avant la guerre, Alain avait déjà déclaré, dans un très
beau texte du reste, qui réfléchit sur la différence qui va hanter si fortement Raymond Aron,
entre l’intellectuel et le politique, que s’il était engagé dans l’action politique, il déclarerait ses
principes et s’y tiendrait, mais que son rôle dans un journal était justement de pratiquer la
réflexion critique. Autrement dit, l’action politique abolit dans une certaine mesure la
réflexion critique : il est difficile de concilier radicalité et gouvernement ; la remarque, qui
pourrait passer pour du bon gros sens, prend une toute autre dimension quand on considère

que l’impasse est en quelque sorte inscrite dans le mode de conception que le radicalisme a de
son action politique. Alain ne constate pas que le pouvoir bloque la pensée ; il en fait la
théorie. Mais cette théorie, en quelque sorte s’auto-dissout, risquant de légitimer la critique
postérieure d’un alinisme seulement négatif. Il y a là sans doute un contresens (plus
spectaculairement commis par Jacques Julliard qui parle d’une vieille tradition de
« rouspétance »), car on confond avec une attitude politique, ce qui est une difficulté
théorique dont il n’est pas forcément exagéré de dire que le radicalisme ne se remet pas.
Ce n’est donc pas seulement l’assagissement de la participation régulière au pouvoir qui
calme le radicalisme pendant les années 20 en lui administrant une bonne dose de réalisme et
de pragmatisme. Cet aspect sans doute éloigne du radicalisme de jeunes intellectuels
radicalisés comme Georges Canguilhem en 1933, quand il reproche à Alain, dont il est à
l’époque très proche, de confondre les principes du radicalisme, très à gauche dans la
compréhension que ce groupe pacifiste peut en avoir, avec le radicalisme ventripotent d’un
Herriot. Mais il y a autre chose que cette modération d’un parti de pouvoir. C’est à l’intérieur
de sa conception doctrinale, assez fortement charpentée, du moins plus qu’on a pu le dire, que
la rupture peut se monter. Et la confrontation avec le socialisme va lui révéler cette faille.
(…)
La science
Il y a en effet dans le socialisme, et non seulement lorsqu’il est d’inspiration marxiste, mais
bien évidemment de manière spectaculaire et revendiquée chez les marxistes, la prétention à
penser la doctrine politique dans les termes d’une science. (…)
Cette référence à la science est sans doute partagée par la gauche radicale : Herriot ne dit-il
pas en 1924 que le régime est « rationaliste » ? Et Bouglé ne vante-t-il pas dans sa préface aux
Pages choisies de Buisson le fait que « de toute conquête de la science, il ne peut que se
réjouir » ? Ce fond commun de la gauche est pourtant interprété d’une toute autre manière
chez les radicaux. Comme l’écrit Buisson, « le radicalisme est donc bien résolu à suivre les
leçons de vie et les dictée de l’expérience. L’esprit radical a ce trait de ressemblance avec
l’esprit scientifique qu’il vit de relatif et non d’absolu. » Autrement dit, le radicalisme plaide
pour l’adaptation aux conditions du réel, et Alain — qui avait été exaspéré par l’attitude
politicienne de Buisson qui un jour lui avait dit « Au nom de quoi parlez-vous ? » —
développe une conception très proche de l’action politique, qu’il compare (la métaphore du
gouvernement en tenue du gouvernail l’aidant) à la navigation. C’est le principe de ce
qu’Aron appelle, en se référant directement à Alain la « politique d’entendement », qui voit le
port, mais sait aussi les vents contraires, et doit louvoyer avec les réalités. Certes, pour ces
deux penseurs convaincus, la direction est bien tracée et Buisson dit qu’il faut aller jusqu’au
bout de la logique, qui est celle de la justice. En ce sens, en dépit de certaines similitudes
(comme la proximité de Buisson et de Ferry par exemple) les radicaux peuvent maintenir la
distinction avec ce que furent les opportunistes : il ne s’agit pas pour eux d’attendre
l’occasion, mais bien de jouer des occasions, même contraires. Les socialistes, eux, veulent
créer l’occasion, et tout d’abord, par la révolution.
D’où deux figures de pensée politique divergentes, moins anecdotiques qu’il n’y paraît.
Pour le radical, la perspective est claire, mais les moyens de parvenir à l’état que ce tableau
qu’il se représente lucidement — pour Alain ou pour Buisson, pour Bouglé ou pour
Bourgeois, voir pour Herriot — sont toujours changeants. Le socialiste, lui, veut organiser les
moyens, et tout particulièrement l’abolition de la propriété privée, et sait « scientifiquement »

qu’une société juste en découlera. Cela vaut quelques phrases dédaigneuses de Bouglé sur ces
socialistes « qui, se contentant de répéter des formules propres à ameuter les masses
prolétariennes, semblent croire que du jour où celles-ci auraient conquis le pouvoir, soit par le
verdict des urnes électorales, soit de haute lutte, tout serait gagné, les fours seraient chauds et
le pain cuit pour le socialisme. »
Alain est pour une fois plus amène. A ses yeux, cette utopie généreuse éloigne le socialisme
d’un jugement réellement rationnel : c’est par le cœur, dit-il (ajoutant qu’il tient l’idée d’une
confidence que lui fit Pressensé) qu’on tient au socialisme. A d’autres moments, il s’insurge
contre le caractère rigidement doctrinal et sectaire des socialistes. Dans tous les cas, on doit
séparer d’un côté une philosophie de la science critique des moyens, de l’autre une pensée de
la science affirmative des fins. Tels sont les deux grands registres qui finissent par opposer —
et qui opposent toujours — l’esprit radical et l’engagement socialiste.
(…)
Qu’est-ce qui peut alors expliquer la pérennité des clivages entre les deux gauches,
aujourd’hui encore ? Un rapport au temps de la politique, qui vient directement de la
conscience que la gauche est tributaire d’une science politique liée à sa philosophie de la
politique. Buisson le caractérise lorsqu’il parle d’une « lutte franche contre toutes les forces
du passé qui prétendent remettre la nation sous tutelle » (102) formant cet « idéal
d’aujourd’hui » mais aussi cette « réalité de demain » (103). Le radicalisme prépare l’avenir
en se défiant des forces obscures de la tradition ou de la superstition, ou de l’ignorance, qui
pèsent sur le jugement individuel et qui viennent du passé. C’est toute la nécessité de
l’éducation de l’individu où Alain peut reconnaître l’esprit radical, dans un individualisme
non seulement respecté (cela les socialistes y arrivent avec Jaurès) mais dans un
individualisme qui est en fait la mesure de toute chose politique. Certes, Alain représente la
tendance la plus anarchisante, la plus radicalisée pour tout dire,du radicalisme. Mais
l’attachement à une gauche de la liberté demeure une caractéristique assez répandue du
radicalisme, tandis que le temps du socialisme demeure celui de la libération : ce n’est pas la
lutte contre le passé qui prépare l’avenir, c’est la lutte pour l’avenir qui nous aide à nous
débarrasser du passé. Ces deux conceptions se rejoignent, politiquement dans certaines
mesures à adopter, et concrètement dans l’alliance électorale sans trop de drame, et
intellectuellement dans l’idée que la politique est un conflit autant qu’un consensus, qui
demeure l’héritage révolutionnaire de la gauche. Mais elles divergent essentiellement quand
on quitte l’immédiat pour s’intéresser aux ressorts de l’action. Et dans leurs dérives, on pourra
de nos jours critiquer le passéisme d’un radicalisme moribond, ou l’appétit sans fin de
réforme des socialistes.
1
/
4
100%