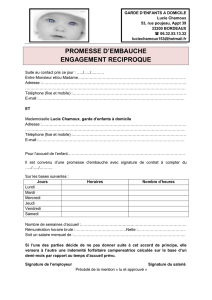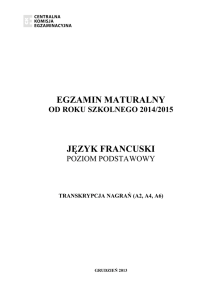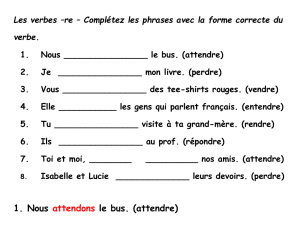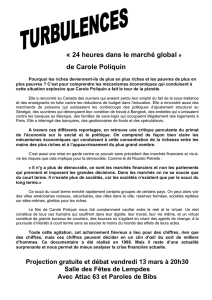Grondines_Veronique_2013_memoire

Université de Montréal
Les nouvelles représentations dramaturgiques de la femme au Québec (2000-2010) :
Fanny Britt, Evelyne de la Chenelière et Jennifer Tremblay,
un féminisme diversifié
par
Véronique Grondines
Département des littératures de langue française
Faculté des arts et des sciences
Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention
du grade de M.A. en littératures de langue française
31 août 2013
© Véronique Grondines, 2013

Université de Montréal
Faculté des arts et des sciences
Ce mémoire intitulé :
Les nouvelles représentations dramaturgiques de la femme au Québec (2000-2010) :
Fanny Britt, Evelyne de la Chenelière et Jennifer Tremblay,
un féminisme diversifié
présenté par :
Véronique Grondines
a été évalué par un jury composé des personnes suivantes:
Jean-Marc Larrue
président-rapporteur
Jeanne Bovet
directrice de recherche
Catherine Mavrikakis
membre du jury

i
Résumé
Peut-on qualifier la dramaturgie féminine contemporaine québécoise de féministe ? Ce
mémoire répond par l’affirmative. Il montre que la dramaturgie féminine québécoise actuelle
participe d’une nouvelle prise de parole féministe, plus complexe et plus diversifiée que celle
des années 1970-1980, et qui tend notamment à conjuguer discours social et poétique de
l’intime. Chaque jour de Fanny Britt (2011), L’Imposture d’Evelyne de la Chenelière (2009)
et La Liste de Jennifer Tremblay (2008) proposent en effet des éléments novateurs quant à la
représentation dramaturgique de la femme, tournant autour de trois imaginaires significatifs :
l’imaginaire médiatique, l’imaginaire maternel et l’imaginaire du rapport hommes-femmes. En
comparant les pièces entre elles ainsi qu’à quelques pièces charnières des décennies
antérieures, il sera démontré que Chaque jour, L’Imposture et La Liste proposent de nouvelles
représentations de la femme dans le paysage théâtral et social québécois. Enfin, ce mémoire
vise à déterminer si la prise de parole féministe de ces pièces correspond au féminisme de la
troisième vague.
Mots-clés : théâtre, féminisme, théâtre québécois contemporain, dramaturgie féminine,
représentation, intime.

ii
Abstract
Can contemporary Quebec feminine drama be considered feminist? This master’s
dissertation answers in the affirmative. It demonstrates that the new women’s theatre is still
feminist, but more complex and more diversified than in the 1970s and 80s, as it tends to
blend the intimate and the social. The plays of Fanny Britt (Chaque jour, 2011), Evelyne de la
Chenelière (L’Imposture, 2009), and Jennifer Tremblay (La Liste, 2008), offer innovative
elements in their dramatic portrayal of women, as they focus on three themes: the media,
motherhood and men-women relations. By comparing the plays with one another, as well as
with important plays from past decades, it will be shown that Chaque jour, L’Imposture and
La Liste renew the representation of women in Quebec theatre and society. Finally, this
dissertation will address the links between this contemporary feminist theatre and the third
wave feminist discourse.
Key words : theatre, feminism, contemporary Quebec theatre, women’s theatre,
representation, intimacy.

iii
Table des matières
Résumé………………………………………………………………………………………….i
Abstract………………………………………………………………………………………..ii
Remerciements………………………………………………………………………………..iv
Introduction …………………………………………………………………………………...1
Chapitre 1 – Le poids de l’imaginaire médiatique…………………………………………12
Chaque jour de Fanny Britt : l’omniprésence de la télévision………………………...13
La Liste de Jennifer Tremblay : le cinéma comme source d’identification…………...25
L’Imposture d’Evelyne de la Chenelière : les médias et la création féminine………...30
Entre captivité et libération……………………………………………………………38
Chapitre 2 - L’imaginaire maternel : de la maternité à la matrophobie ………………...42
Chaque jour de Fanny Britt : la mère infantilisante…………………………………...44
L’Imposture d’Evelyne de la Chenelière : la maternité monstrueuse…………………56
La Liste de Jennifer Tremblay : entre misère et réconfort…………………………….67
Le mal de mère………………………………………………………………………...77
Chapitre 3 - L’imaginaire du rapport hommes-femmes : une harmonie fantasmée……80
Chaque jour de Fanny Britt : la dépendance à l’homme……………………………...81
L’Imposture d’Evelyne de la Chenelière : le refus des hommes ……………………...92
La Liste de Jennifer Tremblay : le poids d’une définition traditionnelle des genres.....99
De l’insatisfaction au fantasme………………………………………………………106
Conclusion ………………………………………………………………………………….110
Bibliographie……………………………………………………………………………….116
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
1
/
130
100%