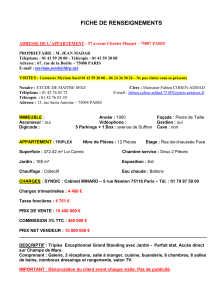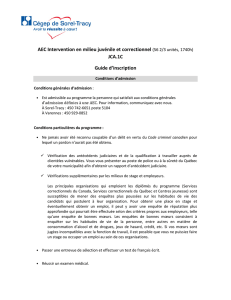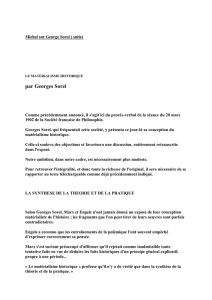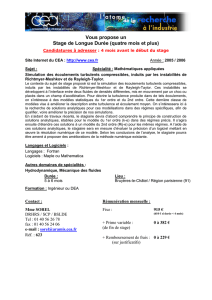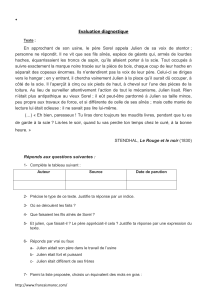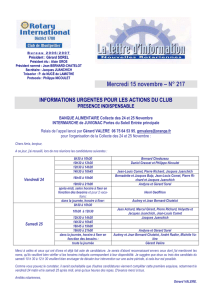Blouin_Philippe_2011_memoire

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
L’ÉTHIQUE DANS LA PHILOSOPHIE POLITIQUE DE
GEORGES SOREL
PAR
PHILIPPE BLOUIN
PHILOSOPHIE
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
MÉMOIRE PRÉSENTÉ À LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
EN VUE DE L’OBTENTION DU GRADE DE MAÎTRISE (M.A.)
EN PHILOSOPHIE
AOÛT, 2011
©, Philippe Blouin, 2011

ii
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Faculté des études supérieures
Ce mémoire intitulé :
L’ÉTHIQUE DANS LA PHILOSOPHIE POLITIQUE DE
GEORGES SOREL
Présenté par :
PHILIPPE BLOUIN
A été évalué par un jury composé des personnes suivantes :
Claude Piché
président-rapporteur
Bettina Bergo
directrice de recherche
Christian Nadeau
membre du jury

iii
RÉSUMÉ
La philosophie politique contemporaine est chargée d’une histoire qu’il reste encore à
déblayer, tant la « guerre civile européenne » du siècle dernier a forcé son autodafé. Dans
ce mémoire, nous prenons Georges Sorel, figure de proue du syndicalisme révolutionnaire
des années 1900, comme figure archétypique de ce qui demeure en reste de cette histoire.
Archétype non seulement de la manière dont des théoriciens de premier plan peuvent
tomber, par la force de l’histoire, dans l’oubli le plus absolu, mais aussi archétype de ces
forces mêmes, alors que Sorel est considéré par l’histoire intellectuelle comme le penseur
ayant dressé le pont entre l’extrême-gauche et l’extrême-droite. Ce mémoire ne s’affaire
pas directement à lui attribuer la « paternité du fascisme » ni à l’en disculper. Il s’agit bien
plutôt de procéder à une déconstruction de ses principales idées à partir d’un angle
essentiellement philosophique, procédé connaissant peu d’antécédents. Plus précisément,
notre travail consiste à en dégager une définition de l’éthique, alors que le geste théorique
principal de Sorel apparaît bien être une réduction du politique à l’éthique. Pour ce faire,
nous mobilisons la philosophie contemporaine, notamment Gilles Deleuze et Giorgio
Agamben, en raison de la forte affinité théorique qu’ils ont avec Sorel, particulièrement
dans la définition de l’éthique.
Mots-clés : Georges Sorel, philosophie politique, éthique, Gilles Deleuze, Giorgio
Agamben, syndicalisme, fascisme, Henri Bergson, anarchie, mythe.

iv
ABSTRACT
Contemporary political philosophy is fraught with a history still to be discharged, as much
as last century’s “European civil war” forced its concealing. In this masters thesis, we seize
Georges Sorel, figurehead of the 1900s revolutionary syndicalism, as an archetypical figure
of what is “in remaining” of this history. Archetype not only of the way in which popular
theorists can be easily forgotten by the force of history, but also archetype of these forces
themselves, as Sorel is considered by intellectual history as the thinker having set up the
bridge between extreme left and extreme right. This master does not directly intend to
attribute to Sorel the “paternity of fascism”, or to exonerate him. It rather develops a
deconstruction of its principal ideas from an essentially philosophical standpoint, method
virtually unprecedented. More precisely, our work consists to extricate Sorel’s definition of
ethics, whereas his major theoretical gesture appears like a reduction of politics to ethics.
To do so, we mobilize contemporary philosophy, especially Gilles Deleuze and Giorgio
Agamben, because of their strong theoretical affinities with Sorel, particularly in their
definition of ethics.
Keywords : Georges Sorel, political philosophy, ethics, Gilles Deleuze, Giorgio Agamben,
syndicalism, fascism, Henri Bergson, anarchy, myth.

v
TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ…………………………………………………………………………….……………………..…..……iii
ABSTRACT……………………………………………………..………………….………………………….…….iv
REMERCIEMENTS………………………………………………………..………………………….…….……vi
INTRODUCTION……………………………………………………………….………………………………….1
CHAPITRE I
CATALYSEURS D’UN RÉVISIONNISME……………………………………………….………………13
I. L’essence du socialisme…………………………………………………….………………….14
II. L’écueil de la Terreur…………………………………………………………………..……….19
III. Le rejet de la démagogie……………………………………………………………..….…….24
IV. Une nouvelle autonomie ouvrière………………………………………..……………..…30
CHAPITRE II
LA TROISIÈME VOIE DU SOCIALISME…………………………………………..….……………….36
I. L’écueil de l’utopisme……………………………………………………………………….….37
II. Le rejet du fatalisme……………………………………………………….………………..….43
III. Un nouveau matérialisme historique………………………………………………….….50
IV. Le marxisme de Marx…………………………………………………………………………..55
CHAPITRE III
MYTHE ET VIOLENCE……………………………………………………………………..…………………64
I. Aspects du mythe…………………………………………………………………………..…….64
II. Le mythe de la grève générale……………………………..…………………………..……70
III. Statut de la violence……………………………………………………………..……….….….74
IV. Une violence sans brutalité ? ………………………………………………………..………81
CONCLUSION : SUR LA DIFFÉRENCE ENTRE ÉTHIQUE ET MORALE……………..…86
BIBLIOGRAPHIE………………………………………………………………………………………………93
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
1
/
105
100%