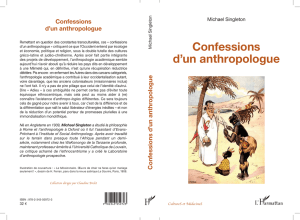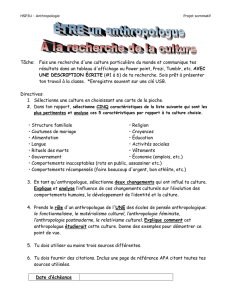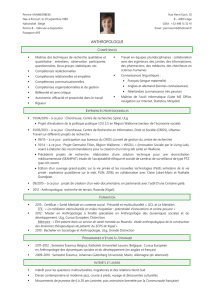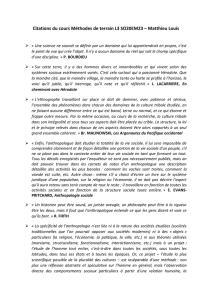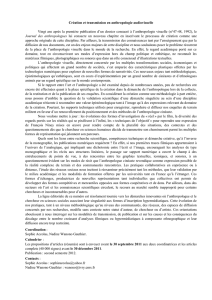Confessions d`un anthropologue

Michael Singleton
Michael Singleton
Confessions
d’un anthropologue
Confessions
d’un anthropologue
Confessions d’un anthropologue
ISBN : 978-2-343-05972-3
32 e
Remettant en question des constantes transculturelles, ces « confessions
d’un anthropologue » critiquent ce que l’Occident entend par écologie
et économie, politique et religion, sous la double tutelle des cultures
gréco-latine et judéo-chrétienne. Après avoir fait partie intégrante
des projets de développement, l’anthropologie académique semble
aujourd’hui n’avoir abouti qu’à réduire les pays dits en développement
à une Mêmeté qui, en définitive, n’est qu’une récupération réductrice
délétère. Pis encore : en enfermant les Autres dans des carcans catégoriels,
l’anthropologie académique a contribué à leur occidentalisation autant,
voire davantage, que les anciens colonisateurs (missionnaires inclus)
ne l’ont fait. Il n’y a pas de pire pillage que celui de l’identité d’autrui.
Dire « Adieu » à ces ambiguïtés ne permet certes pas d’éviter toute
équivoque ethnocentrique, mais cela peut au moins aider à (re)
connaître l’existence d’anthropo-logies différentes. Ce sera toujours
cela de gagné pour notre avenir à tous, car c’est de la différence et de
la différentiation que naît le salut libérateur d’énergies inédites – et non
de la réduction d’un potentiel porteur de promesses plurielles à une
immondialisation monolithique.
Né en Angleterre en 1939, Michael Singleton a étudié la philosophie
à Rome et l’anthropologie à Oxford où il fut l’assistant d’Evans-
Pritchard à l’Institute of Social Anthropology. Après avoir travaillé
sur le terrain dans presque toute l’Afrique pendant un demi-
siècle, notamment chez les WaKonongo de la Tanzanie profonde,
maintenant professeur émérite à l’Université Catholique de Louvain,
ce critique acharné de l’ethnocentrisme y a créé le Laboratoire
d’anthropologie prospective.
Illustration de couverture : « Le Missionnaire. Œuvre de chair ne feras qu’en mariage
seulement ! », dessin de H. Ferran, paru dans la revue satirique Le Sourire, Paris, 1908.
CultureS et MédecineS
Collection dirigée par Claudine Brelet

Confessions d’un anthropologue

Cultures et Médecines
Dirigée par Claudine Brelet
Toute médecine est « traditionnelle ». Chacune est le produit d’une culture,
d’une tradition, dont découle une certaine perception du monde et de l’être
humain donnant du sens à la souffrance et à la maladie, à la naissance et à la
mort… De cette vision du monde dépendent aussi une manière de
diagnostiquer, des techniques et des pratiques, et les normes autour desquelles
s’institutionnalise la relation soignant-soigné au sein d’une même culture.
Depuis 1948, l’OMS a encouragé les soignants formés à la médecine
occidentale classique à tenir compte de l’approche holistique de l’être humain
et du caractère préventif des « ethnomédecines ». La mondialisation n’est pas
qu’économique… À l’instar des musiques du monde s’enrichissant
réciproquement, le pluralisme médical présenté dans cette collection témoigne
comment et pourquoi soignants et soignés peuvent bénéficier de l’intégration
de la diversité culturelle dans le domaine de la santé.
Dernières parutions
Geneviève N’KOUSSOU, Enfants soldats… enfants sorciers ? Approche
anthropologique dans l’Afrique des Grands Lacs, 2014.
Mourad MERDACI, Anthropologie de la souffrance psychique et sociale. Le
contexte psychosocial algérien, 2012.
Claudine BRELET, Anthrop’eau. L’anthropologie de l’eau racontée aux
hydrologues, ingénieurs et autres professionnels de l’eau, 2012.
Bony GUIBLEHON, Les Hommes-panthères. Rites et pratiques magico-
thérapeutiques chez les Wè de Côte d’Ivoire, 2007.
Nicolas KOPP, Marie-Pierre RETHY, Claudine BRELET et François
CHAPUIS (Sous la dir. de), Ethique médicale interculturelle. Regards
francophones, 2006.

Michael Singleton
CONFESSIONS D’UN ANTHROPOLOGUE

© L’Harmattan, 2015
5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris
http://www.harmattan.fr
ISBN : 978-2-343-05972-3
EAN : 9782343059723
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%