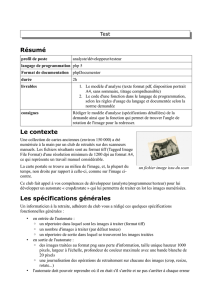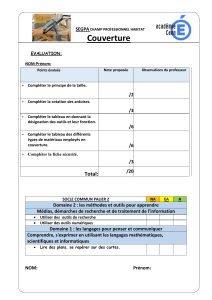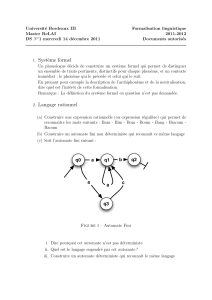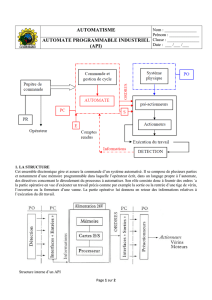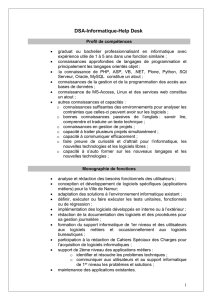Langages formels, Calculabilité et Complexité

Langages formels,
Calculabilité et Complexité
Année 2007/2008
Formation interuniversitaire en informatique
de l’École Normale Supérieure
Olivier Carton
Version du 5 juin 2008

Rédaction
Une toute première version de ce support de cours a été rédigée pendant
l’année 2004/2005 par les élèves Gaëtan Bisson, François Garillot, Thierry Mar-
tinez et Sam Zoghaib. Ensuite, il a été complètement repris et très largement
étoffé par mes soins. Même si la version actuelle est relativement éloignée de la
première version, elle lui doit l’impulsion initiale sans laquelle elle n’existerait
peut-être pas. Certains passages ont aussi bénéficié de quelques travaux de ré-
daction des élèves. Malgré tous ces efforts, ce support de cours contient encore
de trop nombreuses erreurs et omissions. Une certaine indulgence est demandée
au lecteur. Les corrections et suggestions sont bien sûr les bienvenues.
Objectifs
Ce support de cours reflète les deux objectifs de ce cours. Le premier est d’ac-
quérir les principales notions élémentaires en langages formels, calculabilité et
complexité. Le second est de ne pas rester uniquement au niveau des définitions
et trivialités et de montrer quelques jolis résultats de ces différents domaines. Ce
choix fait que des résultats de difficultés très différentes se côtoient. Le premier
chapitre sur les langages rationnels contient par exemple le lemme de l’étoile
mais aussi la caractérisation de Schützenberger des langages sans étoile.
Plan
La structure de ce document reprend la division du cours en deux grandes
parties : les langages formels d’une part, calculabilité et complexité d’autre part.
Chacune de ces deux parties est scindée en deux chapitres. Les deux premiers
chapitres sont consacrés aux langages rationnels et aux langages algébriques et
les deux suivants à la calculabilité et à la complexité.
Téléchargement
Ce support de cours est disponible à l’URL
http://www.liafa.jussieu.fr/~carton/Enseignement/Complexite/ENS/Support/.

Table des matières
I Langages formels 7
1 Langages rationnels 9
1.1 Premières définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Opérations rationnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3 Combinatoire des mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.1 Périodicités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.2 Mots infinis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3.3 Motifs inévitables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.4 Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4 Un peu d’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4.1 Quasi-ordres sur les mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4.2 Ordres sur les mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.4.3 Quasi-ordres sur les arbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5 Langages rationnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.5.1 Expressions rationnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.5.2 Automates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.6 Automates déterministes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.7 Automate minimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.7.1 Quotients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.7.2 Congruence de Nerode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.7.3 Calcul de l’automate minimal . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.8 Propriétés de clôture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.8.1 Opérations booléennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.8.2 Morphisme et morphisme inverse . . . . . . . . . . . . . . 47
1.9 Lemme de l’étoile et ses variantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.10 Hauteur d’étoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1.11 Reconnaissance par morphisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.12 Langages sans étoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1.13 Compléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.13.1 Conjecture de Černý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.13.2 Rationnels d’un monoïde quelconque . . . . . . . . . . . . 66
2 Langages algébriques 69
2.1 Grammaires algébriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.1.1 Définitions et exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.1.2 Grammaires réduites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.1.3 Grammaires propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.1.4 Forme normale quadratique . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3

4TABLE DES MATIÈRES
2.2 Systèmes d’équations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.2.1 Substitutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.2.2 Système d’équations associé à une grammaire . . . . . . . 77
2.2.3 Existence d’une solution pour S(G). . . . . . . . . . . . 78
2.2.4 Unicité des solutions propres . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.2.5 Théorème de Parikh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.2.6 Systèmes d’équations en commutatifs . . . . . . . . . . . 80
2.2.7 Solutions rationnelles des systèmes commutatifs . . . . . . 81
2.3 Arbres de dérivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.3.1 Ambiguïté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.3.2 Lemme d’itération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.3.3 Applications du lemme d’itération . . . . . . . . . . . . . 87
2.3.4 Ambiguïté inhérente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.4 Propriétés de clôture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.4.1 Opérations rationnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.4.2 Substitution algébrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2.4.3 Intersection avec un rationnel . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2.4.4 Morphisme inverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.4.5 Théorème de Chomsky-Schützenberger . . . . . . . . . . . 92
2.5 Forme normale de Greibach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.6 Automates à pile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.6.1 Définitions et exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.6.2 Différents modes d’acceptation . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.6.3 Équivalence avec les grammaires . . . . . . . . . . . . . . 100
2.6.4 Automates à pile déterministes . . . . . . . . . . . . . . . 102
2.7 Compléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.7.1 Réécriture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.7.2 Contenus de pile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.7.3 Groupe libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
II Calculabilité et complexité 109
3 Calculabilité 111
3.1 Préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.1.1 Graphes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.1.2 Logique propositionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.2 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.2.1 Notion de problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.2.2 Notion de codage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.2.3 Machines de Turing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.2.4 Graphe des configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.2.5 Normalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.2.6 Variantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.3 Langages récursivement énumérables . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3.4 Langages décidables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.5 Problème de correspondance de Post . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3.5.1 Présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3.5.2 Indécidabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.5.3 Application aux grammaires algébriques . . . . . . . . . . 139

TABLE DES MATIÈRES 5
3.6 Théorème de récursion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
3.7 Machines linéairement bornées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3.7.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3.7.2 Grammaires contextuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.7.3 Décidabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.7.4 Complémentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
3.8 Décidabilité de théories logiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
3.8.1 Modèles et formules logiques . . . . . . . . . . . . . . . . 149
3.8.2 Arithmétique de Presburger . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3.9 Fonctions récursives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
3.9.1 Fonctions primitives récursives . . . . . . . . . . . . . . . 153
3.9.2 Fonctions récursives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
3.9.3 Équivalence avec les machines de Turing . . . . . . . . . . 157
3.9.4 Thèse de Church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
3.10 Compléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
3.10.1 Écritures des entiers dans une base . . . . . . . . . . . . . 158
3.10.2 Machines de Turing sans écriture sur l’entrée . . . . . . . 161
4 Complexité 165
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
4.1.1 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
4.1.2 Définition des complexités . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
4.2 Complexité en temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.2.1 Théorème d’accélération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.2.2 Changements de modèles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4.2.3 Classes de complexité en temps . . . . . . . . . . . . . . . 168
4.2.4 NP-complétude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
4.2.5 NP-complétude de Sat et 3Sat . . . . . . . . . . . . . . 173
4.2.6 Exemples de problèmes NP-complets . . . . . . . . . . . . 176
4.3 Complexité en espace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
4.3.1 Changement de modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
4.3.2 Classes de complexité en espace . . . . . . . . . . . . . . . 186
4.3.3 Complexités en temps et en espace . . . . . . . . . . . . . 186
4.3.4 Exemples de problèmes dans PSpace . . . . . . . . . . . 187
4.3.5 PSpace-complétude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
4.3.6 Espace logarithmique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
4.3.7 NL-complétude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
4.4 Théorèmes de hiérarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
4.5 Machines alternantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.5.1 Définitions et exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.5.2 Complémentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.5.3 Automates alternants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4.5.4 Classes de complexité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
4.6 Compléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
4.6.1 Machines à une bande en temps o(nlog n). . . . . . . . . 206
Bibliographie 214
Index 215
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
1
/
217
100%