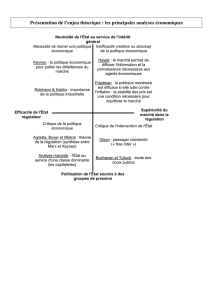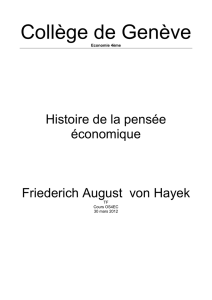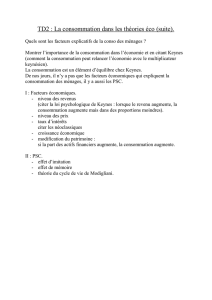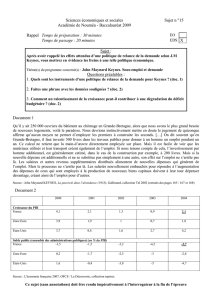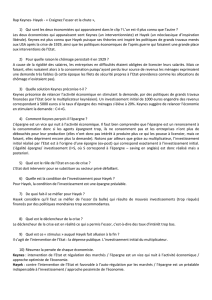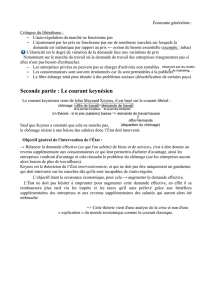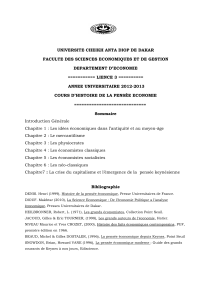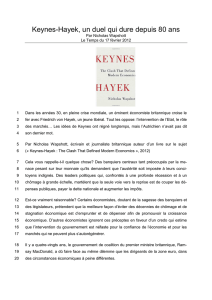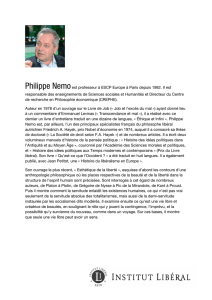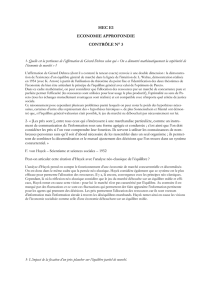Keynes-Hayek, un duel qui dure depuis 80 ans

L’avis de l’expert vendredi17 février 2012
Keynes-Hayek, un duel qui dure depuis 80 ans
Par Nicholas Wapshott
Dans les années 30, en pleine crise mondiale, un éminent économiste britannique
croise le fer avec Friedrich von Hayek, un jeune libéral. Tout les oppose:
l’intervention de l’Etat, le rôle des marchés… Les idées de Keynes ont régné
longtemps, mais l’Autrichien n’avait pas dit son dernier mot. Par Nicholas
Wapshott, écrivain et journaliste britannique auteur d’un livre sur le sujet
Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Des banquiers centraux tant préoccupés par
la menace pesant sur leur monnaie qu’ils demandent que l’austérité soit imposée à
leurs concitoyens indignés. Des leaders politiques qui, confrontés à une profonde
récession et à un chômage à grande échelle, martèlent que la seule voie vers la
reprise est de couper les dépenses publiques, payer la dette nationale et augmenter
les impôts.
Est-ce vraiment raisonnable? Certains économistes, doutant de la sagesse des
banquiers et des législateurs, prétendent que la meilleure façon d’éviter des
décennies de chômage et de stagnation économique est d’emprunter et de dépenser
afin de promouvoir la croissance économique. D’autres économistes ignorent ces
préceptes en faveur d’un credo qui estime que l’intervention du gouvernement est
néfaste pour la confiance de l’économie et pour les marchés qui ne peuvent plus
s’autorégénérer.
Il y a quatre-vingts ans, le gouvernement de coalition du premier ministre
britannique, Ramsay MacDonald, a dû faire face au même dilemme que les
dirigeants de la zone euro, dans des circonstances économiques à peine différentes.
Ramsay MacDonald, embourbé dans une récession mondiale et aux prises avec une
devise internationale souffrante – la livre sterling –, s’est accroché à ce que l’on a
appelé «The Treasury View», un programme de réduction des dépenses publiques
doté d’une profonde croyance au fait que le marché restaurerait la croissance
économique. Mais cette politique n’a pas fonctionné et elle fut la cause d’une
génération de chômeurs.
Le chef de file de ses détracteurs au sein du gouvernement britannique était John
Maynard Keynes, l’économiste du King’s College à Cambridge, duquel le
philosophe Bertrand Russell disait: «Quand je discutais avec lui, j’avais
l’impression de risquer ma vie, et j’en émergeais rarement sans éprouver le
sentiment d’être un imbécile.»
John Maynard Keynes proposait un moyen révolutionnaire pour raviver une
économie à bout de souffle. Il suggérait à la Banque d’Angleterre de maintenir les
taux d’intérêt bas de manière à ce que les entreprises puissent emprunter à bon
marché, et proposait d’abaisser sensiblement les impôts afin d’encourager les
dépenses. Il préconisait également d’employer les chômeurs – 11,4% de la
population active à l’époque – à la construction de routes et de logements.
Aux cœurs sensibles, qui craignaient que de telles mesures ne fassent grimper
encore la dette déjà accablante du gouvernement, John Maynard Keynes répondait
qu’il serait bien temps de la rembourser une fois que l’économie serait à nouveau
prospère. Il ne fallait pas avoir peur du long terme, parce que, écrivait-il, «à long
terme nous serons tous morts».
A l’automne 1931, John Maynard Keynes fut confronté à un ennemi téméraire et
éloquent, Friedrich von Hayek, un jeune économiste viennois appelé par la London
School of Economics (LES) pour contrer les puissantes idées de Keynes. Hayek
était membre de la pragmatique Ecole autrichienne emmenée par Ludwig von
Mises, qui soutenait que le marché s’autocorrigeait et que toute immixtion de la
part des gouvernements finirait en désastre.
Dans un anglais approximatif et en s’appuyant sur des diagrammes triangulaires
complexes, Friedrich von Hayek expliquait pourquoi, selon lui, toute tentative de
tromper le marché en créant des emplois s’avérerait inutile. Les entreprises qui
croissent grâce à un financement bon marché peuvent pendant un temps engager
des chômeurs afin de faire face à une demande artificielle, disait-il, mais à moins
que les taux d’intérêt ne restent indéfiniment bas, des usines finiraient par fermer et
les nouveaux emplois seraient perdus.

Peu de temps après, Keynes et Hayek se lancèrent dans un duel intellectuel qui a
défini les contours du débat qui fait rage aujourd’hui encore sur la question de
savoir si les gouvernements doivent intervenir dans l’économie. D’abord dans des
revues spécialisées, puis dans des lettres privées, les deux hommes ont pointé et
paré. Hayek a donné le premier coup, ferraillant et vitupérant de manière caustique
et impitoyable tandis que Keynes, de 16 ans son aîné, estimait qu’il n’était pas
traité «avec la «bonne volonté» que tout auteur est en droit d’attendre d’un
lecteur».
La querelle s’était envenimée au point que des anciens se précipitèrent pour séparer
les deux duellistes. Arthur Pigou, professeur de renom à l’Université de
Cambridge, les réprimanda pour avoir «utilisé les méthodes du duel» et s’être jetés
l’un sur l’autre «comme des chats de gouttière».
Après y avoir consacré des hectolitres d’encre, Keynes finit par se lasser et le débat
cessa sans conclusion claire. Mais la bataille s’est poursuivie par procuration, avec
les disciples de Keynes, le «Cercle de Cambridge», qui savouraient leurs
empoignades avec les «Autrichiens» de la LES qui, eux, brandissaient l’étendard
d’Hayek.
Chacun des deux économistes avait juré d’imposer sa propre philosophie. Keynes a
publié son œuvre maîtresse en 1939, La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt
et de la monnaie, une œuvre complexe et souvent absconse qui incitait les jeunes
économistes américains, parmi lesquels Milton Friedman et John Kenneth
Galbraith (qui finiront sur les côtés opposés du clivage intellectuel et idéologique) à
appliquer le nouveau credo dans le New Deal de Franklin D. Roosevelt.
Les efforts d’Hayek pour écrire une œuvre majeure n’ont pas porté leurs fruits et il
a échoué à trouver la riposte parfaite à la Théorie générale.
Alors que Keynes avait l’impression d’avoir gagné la partie, il éprouva des doutes
quant à la volonté des politiciens d’appliquer ses idées à une large échelle, sinon
dans des circonstances extrêmes comme une guerre mondiale. Il n’a pas eu à
attendre longtemps. En réponse à l’expansionnisme d’Hitler, les démocraties se
sont lourdement endettées pour se réarmer avant que la tempête nazie n’éclate sur
l’Europe.
La Deuxième Guerre mondiale sembla confirmer la thèse de Keynes qui prétendait
que, si au plus bas du cycle économique, les gouvernements empruntaient et
dépensaient à une large échelle, ils pourraient être certains que le chômage ne
grimperait pas à des sommets douloureux. Entre 1945 et 1975, avec l’aide des
dépenses keynésiennes, l’Occident a bénéficié d’une prospérité sans précédent.
Mais loin de se laisser décourager par le succès de Keynes, Hayek a persévéré et
son livre La Route de la servitude (1944) a ouvert un deuxième front contre son
rival. Refroidi par les leçons de l’Allemagne d’Hitler et de la Russie de Staline,
Hayek a conclu que plus la taille d’un Etat était importante, plus la probabilité de
voir les droits individuels bafoués était grande.
Au milieu des années 70, lorsque les économies occidentales ont été confrontées à
la combinaison de l’inflation et de la stagnation, que l’on a baptisée «stagflation»,
le keynésianisme semblait avoir fait son temps. Les idées de Hayek ont été retirées
des rayons des bibliothèques, dépoussiérées et considérées d’un œil nouveau. Le
résultat en a été le monétarisme, conçu par Milton Friedman, tombé sous le charme
de Hayek et acquis à ses principes de conservatisme fiscal et de maintien des
gouvernements minces. Sous le monétarisme, l’inflation devait être contenue
uniquement en augmentant progressivement, et de manière prévisible, la masse
monétaire.
Accélérons la bobine jusqu’à la crise financière de 2008-2009, lorsque, comme
dans les années 1930, l’économie mondiale a dû faire face à une menace
existentielle et à l’effondrement imminent du système financier. George W. Bush et
ses alliés du G20 se sont instinctivement ralliés non pas à Hayek, mais à Keynes.
Ils ont soutenu les banques en difficulté avec des prêts gouvernementaux monstres
et évité une récession calamiteuse grâce à une relance économique keynésienne
pour laquelle ils ont dépensé des milliards de dollars.
Mais à peine les mesures ont-elles été mises en place que les électeurs en colère ont
éprouvé des regrets, en particulier les protestataires du Tea Party aux Etats-Unis,
qui ont demandé que la dette soit remboursée dans les plus brefs délais. C’était
comme si on avait servi un copieux repas à un homme mourant de faim avant de
vider immédiatement son estomac.

La discussion pour savoir s’il faut stimuler l’économie ou laisser les marchés guérir
spontanément continue à dominer la politique des deux côtés de l’Atlantique. Les
lignes de combat demeurent les mêmes qu’à l’époque de Keynes et de Hayek, et le
ton est resté tout aussi vif.
Les politiciens sont confrontés aux mêmes choix: lutter contre le chômage ou
risquer l’inflation; introduire la relance ou imposer l’austérité; emprunter et
dépenser ou taxer et rembourser la dette.
Un camp est tourné vers la relance keynésienne. Le plan – mort-né – pour l’emploi
du président Barack Obama est un stimulus déguisé de 50 milliards pour créer de
l’emploi grâce à des dépenses en infrastructure. L’autre camp fait écho à la double
attaque de Hayek contre Keynes: selon lui, la relance ne marche pas et gaspille
l’argent du contribuable; et le gouvernement s’attribue une part trop importante du
revenu national.
En Grande-Bretagne, les Hayekiens de la coalition entre les conservateurs et les
libéraux-démocrates du premier ministre David Cameron – inspirés par Margaret
Thatcher, grande partisane de leur héros dans les années 1980 – savourent la
réduction des dépenses publiques au nom de la prudence économique. En Europe,
le pacte franco-allemand tente désespérément de maintenir l’intégration politique
européenne sur les rails en exigeant une réduction du secteur public et le retour aux
budgets équilibrés au Portugal, en Espagne, en Irlande, en Italie et surtout en
Grèce.
Dans ce match retour entre Keynes et Hayek, Hayek est en train de prendre le
dessus. L’Europe s’est engagée dans une décennie de douloureuse austérité,
promettant de rembourser peu à peu la dette et de forcer les gouvernements
ballonnés à maigrir. Aux Etats-Unis, tous les candidats républicains soutiennent le
message de Hayek de rectitude fiscale et de gouvernements plus petits. Hayek
aurait-il gagné ce concours qui dure depuis quatre-vingts ans?
Il est trop tôt pour le dire. Il y a un prix politique significatif à payer pour réduire la
taille de l’Etat et rembourser l’emprunt public. La croissance économique ralentit et
le taux de chômage, déjà élevé, augmente encore. Les désillusions à l’égard des
leaders politiques qui président à un tel gâchis pourraient bien pousser les électeurs
vers les extrêmes. En Europe en particulier, c’est une période périlleuse.
Keynes s’est rendu célèbre lorsqu’il a démissionné de l’équipe des Alliés qui
planifiait d’imposer, dans le Traité de Versailles, des réparations paralysantes aux
Allemands vaincus. Son ouvrage Les Conséquences économiques de la paix était
un chef-d’œuvre d’invective avertissant que l’appauvrissement délibéré d’un pays
industriel avancé allait encourager les mouvements politiques extrêmes et
provoquer une Deuxième Guerre mondiale.
L’Histoire lui a donné raison. L’Allemagne de Weimar a été secouée par des
désordres civils et des révolutions; sa fragile démocratie a été balayée en faveur du
nazisme. Et c’est un risque similaire que prennent aujourd’hui Nicolas Sarkozy et
Angela Merkel lorsqu’ils président à l’appauvrissement délibéré de leurs voisins
européens plus faibles.
© 2012 Le Temps SA
1
/
3
100%