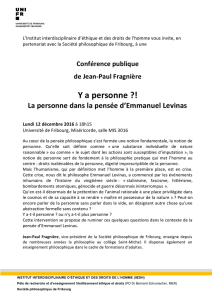EVC et EPR : quelles questions pour l`éthique

1
EVC et EPR : quelles questions pour l’éthique ?
C’est parce que la conscience est ou semble abolie chez les personnes en état dit « végétatif »
que leur situation nous pose une question inévitable : quel est le sens de leur vie ou de cette
forme de vie ? Un premier développement examine la signification philosophique de cette
question (qui éclaire le rapport de l’existence humaine à la valeur qui la constitue au plus
profond, qui est précisément de valoir pour elle-même et d’avoir rapport à des valeurs) et
l’appréhension spécifique du handicap dans ces situations, insistant en particulier sur la
nécessité d’expliciter les angoisses, les représentations et les imaginaires qu’elles impliquent.
Il propose de reconnaître que la question « quel est le sens d’une vie en état végétatif
chronique ? » exige un autre abord que le souhait d’une réponse objective et a pour sens
éthique de rester ouverte dans sa généralité, libérant ainsi la possibilité de réponses concrètes
individuées procédant d’une recherche collégiale permanente, attentive à chaque situation.
Reste une tension entre d’une part la volonté de protéger toujours la personne, protection
garantie par la loi, la personne non consciente demeurant sujet de droit, et d’autre part
l’interrogation portant sur le sens de l’être-en-vie de la personne irréversiblement privée de
conscience, et engageant notre responsabilité. Ainsi se formule l’enjeu permanent du sens
dans le soin, comme sens à élaborer et à partager dans le souci premier du patient et des
proches, sous l’horizon d’une solidarité humaine et sociale. Cette analyse permet d’intégrer
une réflexion sur la délimitation du « déraisonnable » ou sur l’expérience propre des soignants
qui en viennent parfois à mettre en doute l’existence même du syndrome d’état végétatif
chronique en considérant qu’il y a toujours échange, communication, perception de
sensations, aussi infime que soit cette perception, et qu’il n’existe que des états pauci-
relationnels.
Une des questions préjudicielles est ici celle de la conscience et de son attestation
« extérieure » possible lorsque la lésion en interdit la manifestation claire. Le second volet du
propos s’attache sous cet aspect à quelques réflexions interrogatives : que signifie être
conscient ? à partir de quand y a-t-il conscience ? que désigne conscience minimale ? La
question de la conscience enveloppe à la fois un problème philosophique (la conscience est un
concept à expliciter), une question scientifique (identifier les conditions de possibilité et de
manifestation de la conscience), un enjeu épistémologique (que signifie aborder en termes de

2
présence et de fait matériel ce qui n’est pas un objet, mais l’expression même de la
subjectivité vécue en « première personne » ?), une préocupation concrète, enfin, qui
détermine au moins trois aspects essentiels de la prise en charge : la procédure thérapeutique,
le sens vécu des actes de soin et de co-présence, l’espoir ou non d’une amélioration.
Quelques éléments de réflexion sont exposés. On souligne d’abord que le concept
unilatéralement mobilisé dans les études scientifiques, référé sans analyse et de manière
discutable à W. James, est sujet à caution. Les distinctions qu’observe l’anglais entre
« awareness », « wakefulness » et « consciousness » débouchent soit sur des assimilations où
le défini entre dans la définition (ainsi dit-on que « la conscience signifie être conscient de soi
et de son environnement »), soit sur des affirmations qui n’éclairent pas davantage le propre
de la conscience (ainsi parle-t-on d’EVC en présence d’un état « d’éveil sans conscience »).
Par ailleurs, il existe un certain paradoxe à vouloir évaluer chez ces patients une activité
cérébrale synonyme de la conscience alors qu’on définit leur état par une altération ou une
abolition de la conscience. Le risque est plus largement celui d’un cercle méthodologique :
vouloir cerner la nature, le seuil et les niveaux de la conscience à partir d’une définition non
questionnée et présupposée de ce que « conscience » désigne. Plus avant, c’est l’interprétation
des résultats de l’imagerie et de l’électrophysiologie qui pose problème. L’existence d’une
corrélation entre toute pensée et un état cérébral correspondant n’autorise pas à les confondre
et à dire que nous pouvons « lire » des états mentaux. L’obligation de « traquer » la
conscience à partir de signes (avec tout le problème des modalités de leur recueil et de leur
interprétation) ne doit pas occulter l’idée que la conscience n’est pas en elle-même attestable
« extérieurement ». Jusqu’où peut-on dès lors assimiler réponse cérébrale et conscience ? Et
peut-on parler de conscience hors de tout accès à un vécu ? Les processus neuro-
physiologiques (par exemple de nociception) ne suffisent pas pour constituer un « sentiment »
ou un vécu (par exemple de douleur). Il paraît également indispensable de distinguer plusieurs
types de conscience (pré-réflexive ou réflexive). Nombre d’études sur les potentiels évoqués
semblent confondre fonctionnement du cerveau et pensée proprement dite ou assimiler le
cerveau au sujet qui pense. Or, à vouloir identifier la conscience au neuronal, tout en se
réclamant d’un souci éthique (évaluer l’état de la personne et ses chances de récupération,
donc déterminer le type de traitement), on pose un concept de conscience qui ne peut plus
fonder l’expérience de la conscience de soi, donc la responsabilité. Un regard philosophique
rappellera enfin la nécessité de distinguer les notions de conscience, d’identité individuée, de
subjectivité, de personne. On interroge aussi dans cette évocation des problèmes de

3
conceptualisation le caractère problématique du terme « vegetative », que Jennett et Plum,
dans l’article princeps d’avril 1972, qualifient de « non ambigu et neutre ».
Ces élements posés, on peut mettre à distance les affirmations insuffisamment
conceptualisées de certaines présentations de résultats scientifiques, qui à l’instar de certaines
interprétations du soin, risquent de jouer sur l’émotion empathique et des représentations
imaginaires (ce qui n’exclut pas de reconnaître une valeur à l’émotion et aux imaginaires).
Mais on souligne d’autant le caractère incertain de l’appréhension en trop grande extériorité
— par observation neurale — ou inversement sans attestation extérieure fiable — par
témoignage relevant de l’expérience intime — de ces situations. C’est donc la modestie qui
pourrait éclairer en la circonstance une alliance entre science, soin et interrogation
philosophique. Car il s’agit d’articuler 1) le travail de détection de l’activité de conscience, et
de compréhension de ses processus d’avènement ou d’effacement, avec 2) le travail soignant
attentif à protéger, rappeler, promouvoir la présence d’une personne, et 3) une réflexion sur le
sens éthique, épistémologique, intime, social de ces activités en s’instruisant auprès d’elles
mais également en interrogeant leurs présuppositions et leurs normes de référence. Autrement
dit : il s’agit de faire converger le développement des techniques affinant le diagnostic, le
pronostic ou encore les possibilités de neurostimulation avec le souci de l’autre dans son
altérité et sa situation singulière, souci étendu aux tiers (proches, soignants, société), à l’écart
de toute idéologie et de tout moralisme. Le dialogue des savoirs, des questions et des
expériences définit en effet une expression de la solidarité constitutive d’une éthique du vivre
ensemble, elle-même liée à une éthique de la responsabilité soucieuse du sens des situations
pour ceux qui les vivent.
(Jean-Marc Mouillie, Faculté de médecine d’Angers)
1
/
3
100%