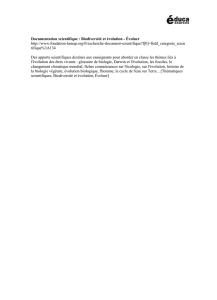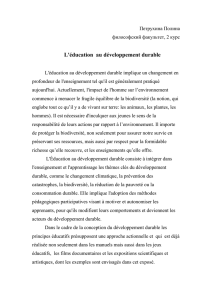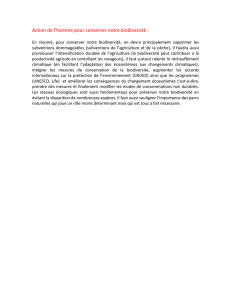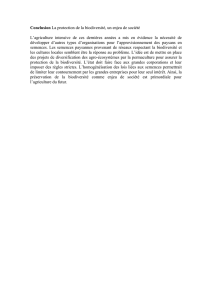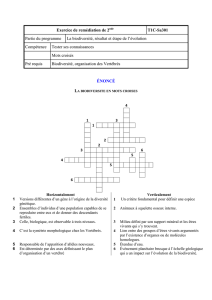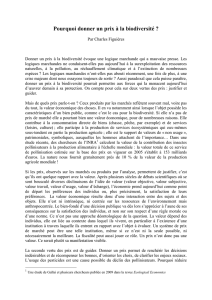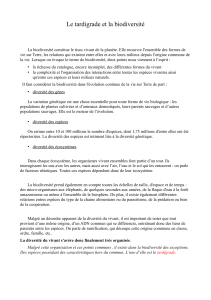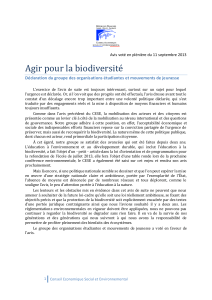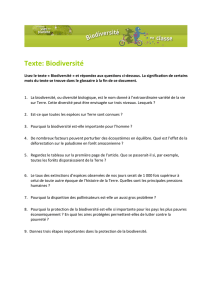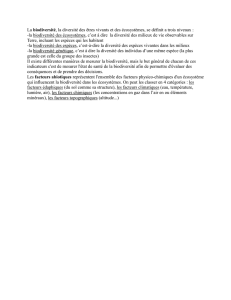CAHIERS D`ÉPISTÉMOLOGIE

CAHIERS
D'ÉPISTÉMOLOGIE
Publication du Groupe de Recherche en Épistémologie Comparée
Directeur: Robert Nadeau
Département de philosophie, Université du Québec à Montréal
Les trois courants complémentaires du champ de l’économie de
l’environnement : une lecture systémique
Olivier Godard
Cahier nº 2005-09 332e numéro
http://www.philo.uqam.ca

Cette publication, la trois cent trente-deuxième de la série, a été rendue possible grâce à la contribution
financière du FQRSC (Fonds québécois de recherche sur la société et la culture).
Aucune partie de cette publication ne peut être conservée dans un système de recherche documentaire,
traduite ou reproduite sous quelque forme que ce soit - imprimé, procédé photomécanique, microfilm,
microfiche ou tout autre moyen - sans la permission écrite de l’éditeur. Tous droits réservés pour tous pays./
All rights reserved. No part of this publication covered by the copyrights hereon may be reproduced or used
in any form or by any means - graphic, electronic or mechanical - without the prior written permission of the
publisher.
Dépôt légal – 2e trimestre 2005
Bibliothèque Nationale du Québec
Bibliothèque Nationale du Canada
ISSN 0228-7080
ISBN: 2-89449-132-8
© 2005 Olivier Godard

Les trois courants complémentaires du champ de
l’économie de l’environnement :
une lecture systémique
Olivier Godard
Directeur de recherche au CNRS
et professeur à l’École Polytechnique de Paris
Mars 2005

Résumé
C’est de façon non contingente au regard de son objet que l’économie de l’environnement s’est
structurée autour de trois courants principaux : le courant néo-classique, abordant
l’environnement comme une collection de biens relevant de la problématique générale de
l’allocation des biens en fonction des préférences des agents ; « l’économie écologique » qui
étudie tendanciellement l’économie humaine comme elle le ferait pour un système écologique ; la
socio-économie, centrée sur l’articulation entre les comportements d’utilisation des ressources et
des milieux, les institutions et les normes sociales. C’est ce que permet de comprendre le concept
d’environnement dérivé de la théorie de l’auto-organisation. Deux points d’appui montreront la
pertinence de ce regard théorique sur ce champ : la révélation de la déficience intrinsèque de
l’approche en termes d’internalisation des effets externes à penser le développement durable ;
l’inadaptation du concept économique de bien pour faire face aux enjeux de la protection de la
biodiversité.
Abstract
It is not by a contingent chance that environmental economics are hosting three main approaches:
the neo-classical one, which considers the environment as a set of goods submitted to the general
problem of searching the best allocation according to individual preferences; ecological
economics, which tends to consider human economy as an ecological system; socio-economics,
focused on links between economic behaviours, institutions and social norms. This is what can be
understood through an examination of the structure of the concept of environment derived from
self-organizing systems thinking. Two insights will demonstrate the relevance of this theoretical
view: the first will reveal the intrinsic deficiencies of the framing of internalizing environmental
externalities for thinking sustainable development strategies; the second will show the ill-
adaptation of the concept of economic good to address challenges of biodiversity protection.
Mots-clé : environnement, théorie économique, auto-organisation, effets externes,
développement durable
Key words: environment, economic theory, self-organization, external effects, sustainable
development
Classification JEL: A13 B41 D62 Q01 Q20

5
Introduction
L’analyse économique ne s’est trouvée véritablement confrontée à la question de
l’environnement que depuis les années 1960. Certes, des bases théoriques avaient été posées bien
avant, tant pour les phénomènes de pollution - de Pigou (1920) à Coase (1960) -, avec
l’introduction de l’idée d’un écart entre coûts sociaux et coûts privés résultant de la présence
d’effets externes -, que pour l’exploitation et la gestion des ressources naturelles - Hotelling
(1931) pour l’économie des ressources épuisables et Gordon (1954) et Shaefer (1955) pour des
ressources renouvelables comme les pêcheries -, sans remonter aux problématiques et débats du
XIXe siècle. Les années 1950 avaient vu des contributions importantes comme l’article de
Samuelson (1954) sur les biens collectifs (désignés de façon impropre comme biens publics à
partir du point de vue initial adopté par Samuelson qui est celui des dépenses publiques), les
articles de Meade (1952) et Scitovsky (1954) sur les distinctions à opérer au sein des effets
externes, mais aussi le livre prémonitoire de Kapp (1950) sur les coûts sociaux de l’économie de
marché.
Un nouveau cycle d’inquiétude environnementale et de critique sociale s’est amorcé et
développé avec puissance, au milieu des années 1960. L’ouvrage de Rachel Carson sur les
menaces chimiques pesant sur les oiseaux date de 1962 ; l’article de Burton Weisbrod
introduisant pour la première fois l’idée de prix d’option dans un débat sur les modes de gestion
des parcs naturels date de 1964, tandis que le livre de Ezra Mishan sur les coûts de la croissance
économique date de 1967. Animé par une double prise de conscience scientifique et militante,
mais aussi pratique, par exemple s’agissant de la gestion de la ressource en eau, ce mouvement a
conduit les gouvernements des pays industrialisés à se doter de nouvelles structures ministérielles
dédiées à la protection et à la valorisation de l’environnement et des ressources naturelles (1969
aux États-Unis, 1971 en France, par exemple).
Dans ce contexte l’abord des problèmes d’environnement par les économistes a pu
prendre deux formes : celle du déploiement des ressources conceptuelles et méthodologiques déjà
acquises, qui n’exclut pas des innovations conceptuelles à l’intérieur d’un cadre donné ; celui de
la recherche d’un renouvellement théorique profond en réponse à un défi inédit. C’est ce qu’on a
observé. Depuis lors, le champ de l’économie de l’environnement est marqué par la diversité des
approches au moins autant que la discipline économique peut l’être de façon plus générale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
1
/
55
100%