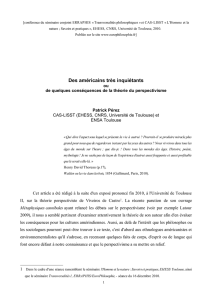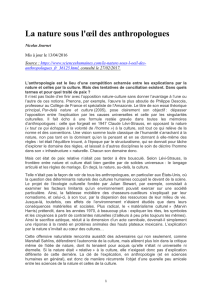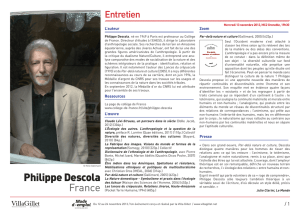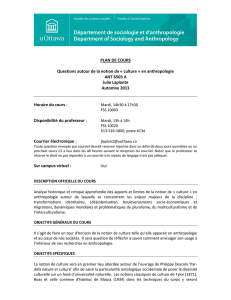Anthropologie et philosophie

Document de travail
ERRAPHIS
1
Anthropologie et philosophie, la croisée des chemins
Pierre Montebello
La croisée des chemins
La philosophie contemporaine est à la croisée des chemins.
Les anciens partages qu’elle a tracés, entre empirique et
transcendantal, psychologie et naturalisme, idéalités et réalités
ne valent plus. L’acte de naissance de la philosophie
contemporaine est son opposition au naturalisme et au
psychologisme, le façonnage d’un transcendantal opposé à la
nature. L’anthropologie, à peine balbutiante, a vite été
considérée comme l’ennemi empirique de la visée
transcendantale et universalisante de la philosophie. Inutile de
retracer ces partages incessants, et d’évoquer les raisons d’un
pareil divorce, c’est l’histoire riche du concept de nature, de
« nature humaine », d’humanité à partir du XVIII siècle, qu’il
faudrait évoquer, après tant d’autres. Si arbitraire que soit ce
qui a éloigné ces disciplines, une certaine conception de la
nature pourrait les réunir à nouveau. A la lecture de Descola ou
de Viveiros de Castro, de Latour ou de Deleuze, nous
comprenons que l’anthropologie, la sociologie et une certaine
philosophie pourraient aujourd’hui se réconcilier après avoir
subi de si nombreux divorces au cours du XIXème et du
XXème siècle.
Beaucoup de choses parlent à un lecteur philosophe de Descola,
de Latour ou de Viveiros de Castro, et elles lui parlent d’autant
mieux qu’il a l’impression qu’ils ne sont pas éloignés d’une
nouvelle conception de la nature qui a émergé dans la
philosophie elle-même. Ce n’est certes pas toute la philosophie,
ni même la majorité des philosophes qui se reconnaitraient en
eux, sans doute même seulement une minorité, celle qui aura
voulu remettre le concept de nature au centre de sa réflexion, et
plus encore une certaine nature, une nature qui ne s’oppose pas
à la culture, qui ne lui fait pas front comme les lois mécaniques
universelles aux lois de la pensée, qui ne s’établit pas sur un
dualisme profond des êtres naturels et de l’homme, sur la
séparation intangible des non humains et des humains, de la
nature et de la culture… Dans Par-delà nature et culture
(Gallimard, 2005), Philippe Descola évoque la solitude du
Spinoza, « Spinoza est bien seul » lorsqu’il récuse un tel

Document de travail
ERRAPHIS
2
partage entre nature et homme, lorsqu’il dénonce
l’anthropologisation de la nature et la dénaturalisation de
l’homme. C’est vrai.
Mais il est vrai aussi que dans son sillage on aperçoit de frêles
esquifs, des penseurs tout aussi solitaires qui inlassablement
sont revenus sur ce partage, sur la transcendance de l’homme,
sur la dénaturalisation de la nature, sa dévitalisation, son
opposition à l’homme. Nature vidée de vie, d’âmes,
d’animacules, de souffles, d’infimes traces de pensée, pur
tombeau pour l’esprit, « automate ventriloque » (Descola, 97),
ontologie morte (Hans Jonas).
Déconstruction de la métaphysique implicite de la nature.
Ce qu’une mince partie de la philosophie et une partie de
l’anthropologie ont en commun, c’est d’avoir compris que la
répartition ferme de la nature et de la culture n’avait rien de
naturelle. Il n’y a guère de philosophes en effet qui aient pris ce
problème au sérieux, sans s’engouffrer tout de suite dans les
droits inaliénables d’une transcendance de la pensée. Peu de
philosophes ont refusé le partage entre nature mécanisée et
transcendance spiritualisé, et opéré une sorte de déconstruction
de ce partage.
. C’est le cas de Nietzsche et de Bergson, de Tarde et de
Whitehead, de Simondon et de Deleuze. Ils ne se sont pas
opposé à la mécanisation ou mathématisation de la nature
mais à la métaphysique implicite qui les sous-tend, dualiste,
rigide, fermé qui oppose nature et esprit, ils n’ont pas refusé
les sciences de la nature mais la métaphysique
unidimensionnelle qui les met au devant de la scène... Raison
pur laquelle ils n’ont jamais consenti à réduire la nature à des
paradigmes scientifiques dominants, que ce soient le
naturalisme ou le physicalisme. Avec le dualisme et la nature
universelle étendue, mécanisée, soumise à des lois irrévocables,
tendant à l’entropie, l’on se donnait moins un instrument
efficace de maîtrise de la nature qu’une métaphysique qui
ravageait de fond en comble les liens ontologiques entre les
êtres. Cosmos lézardé, avec des êtres irrévocablement séparés
et des failles partout. C’est la séparation nature/culture qui a
été l’objet de leur critique, c’est l’absence de séparation entre
elles qui étaient l’objet de leur investigation.
Quand Latour écrit dans son livre-manifeste Nous n’avons
jamais été modernes (La découverte, 1991) que la modernité

Document de travail
ERRAPHIS
3
secrète une sorte de « Constitution » qui répartit de part et
d’autre humains et non humains, qui affirme simultanément la
transcendance et l’immanence de la nature, la construction et la
naturalisation du social, qui rend possible le jeu des
dénonciations infinies (tout manque de transcendance ou
d’immanence, de nature et d’artifice, au choix) il constate aussi
qu’elle repose sur un pôle irréconciliable qui est celui de la
nature inhumaine et celui de l’esprit. De sorte que c’est Kant
qui donne sa forme canonique à une Constitution qui oublie
« l’empire du Milieu » l’immense majorité ontologique des
êtres qui sont des (hybrides) à la fois naturels/culturels :
« Les choses en soi deviennent inaccessibles pendant que symétriquement le sujet
transcendantal s’éloigne infiniment du monde »
(Latour).
La modernité a accentué l’absence de mesure entre nature et
culture à un point abyssal, elle s’est acharnée à établir
l’incommensurabilité de sujets et des objets, soumettant à ses
imprécations furieuses la confusion des sujets et des objets.
Une bonne partie du kantisme « déplacé en plein XXème
siècle » de Habermas à Lyotard n’a vécu que de cette
dénonciation.
On ne lit pas sans une certaine jubilation les cris de lassitude de
Latour envers cette répartition :
« J’avoue que j’en ai par-dessus la tête de me retrouver enfermé dans le seul langage
ou prisonnier seulement des représentations sociales. Je veux accéder aux choses
mêmes et non à leurs phénomènes (…) Je n’en puis plus moi et mes contemporains
d’avoir oublié l’Être, de vivre en bas monde vidé de toute sa substance, de tout son
sacré, et de tout son art, ou de devoir, afin de retrouver ces trésors, perdre le monde
historique, scientifique et social dans lequel je vis » (Latour, 123). « Si méprisant
l’empirie, vous vous retirez des sciences exactes, puis des sciences humaines, puis de
la philosophie traditionnelle, puis des sciences du langage, et que vous vous retirez
dans votre forêt, alors vous ressentez en effet un manque tragique. Mais c’est vous
qui manquez, pas le monde » (Latour, 90).
Ce « Grand partage intérieur » qui caractérise l’occident a pour
conséquence un Grand partage anthropologique extérieur : non
seulement nous séparons nature et culture, mais nous sommes
les seuls à séparer nature et culture car dans toutes les autres
sociétés tout est simultanément signe et chose, culture et nature,
science et société. En réalité, dit Latour, il n’y a pas davantage
de nature universelle que de cultures différentes, il n’y a que
des « natures-cultures » qui opèrent de manière semblable en
construisant simultanément des êtres humains, des êtres non
humains ou même divins.

Document de travail
ERRAPHIS
4
Descola montre à son tour que le concept de nature dont se
sont servis bien philosophies et des sciences n’est qu’une
« construction » physique, épistémologique, sociale, et même
une « construction pratique » (verriers, horlogers, « artisans qui
rendent possible la vie en laboratoire »). Très semblablement à
Latour et aux philosophes déjà cités, il retrace à grands traits
l’histoire de ce « grand partage » qui a réparti d’un côté une
nature uniforme, égale, aveugle, matérielle, « domaine
ontologique autonome », champs d’expérimentation, d’étude,
d’accaparation, et de l’autre, l’homme transcendant, la
civilisation indépendante, la culture autonome.
Ce partage a été rendu possible selon lui par la constitution
d’une cosmologie dualiste qui répartit les âmes et les corps,
l’immense étendue étant soumise à des lois implacables tandis
que le scintillement de la pensée émerge dans cette nuit
matérielle obscure. Descola nous donne l’exemple de la
peinture de paysage de Savery, « Paysage montagneux avec un
dessinateur » de 1606, emblème de ce changement du regard à
l’aurore même de notre époque. Ce qui est présenté dans ce
tableau, ce n’est déjà plus un paysage, mais un paysage vu par
un sujet, un monde soumis à la perspective humaine, connecté à
l’activité représentationnelle de l’homme, un univers balayé par
la géométrie projective :
« La projection plane éloigne les choses, mais ne
porte en elle nulle promesse de leur dévoilement véritable ; comme l’écrit Merleau-
Ponty, ‘c’est au contraire à notre point de vue qu’elle renvoie : quant aux choses
elles fuient dans un éloignement que nulle pensée ne franchit’ » (Descola, 95).
Or, cette cosmologie dualiste, chrétienne en son fond
lorsqu’elle postule la transcendance de l’homme dans un
monde créé, sans vie et sans volonté, lorsqu’elle place au cœur
de l’univers cet homme appelé à commander à la nature et à
toutes les espèces animales, comment imaginer qu’elle désigne
quoi que ce soit de naturel ? Il paraît plutôt que le divorce entre
une nature uniforme et une culture transcendante n’a jamais été
une origine, mais un creuset où les sciences et la religion
chrétienne se sont en somme partagées le monde, d’un côté les
corps et de l’autre les âmes. Si l’autonomie de la culture a pu
devenir l’objet d’une vaste considération à la fin du XIXème
siècle, lorsqu’on s’est mis à distinguer « sciences de la nature »
et « sciences de l’esprit », de Dilthey à Windelband, de Rickert
à Boas…, et donc deux modes de connaissance totalement
séparés, ce n’est pas sous la force d’un appareil critique mais
sous l’impulsion d’un paradigme qui imprégnait tous les
segments du savoir et auquel la philosophie s’est rendue sans

Document de travail
ERRAPHIS
5
opposition aucune. Plus la philosophie rejetait l’empirisme
anthropologique, plus elle accentuait la transcendance de
l’homme, plus elle rejetait le naturalisme, plus elle accusait la
séparation entre transcendance de l’esprit et immanence de la
nature.
L’anthropologie a elle-même accueillie ce dualisme comme la
base de son développement, comme le socle de son
épistémologie, et elle est demeurée infiniment tiraillée entre
naturalisme et culturalisme, universalité naturelle et
particularités culturelles : « monisme naturaliste » et
« pluralisme culturaliste ». La nature est-elle façonnée par la
culture, les instincts, les gênes, les contraintes des milieux, les
déterminismes de toute sorte, la nature jouant le rôle d’une
nature naturante universelle pour tous ses modes y compris
culturels et donc toute la nature naturée ? Ou alors la culture
avec ses symbolismes, ses langages, ses techniques, est-elle en
rupture avec l’ordre de la nature ? Le débat a fait rage, il a tracé
une vaste ligne de démarcation entre matière et esprit,
déterminisme et symboles, réseaux physiques et productions de
sens.
Perspectivisme anthropologique et philosophique
L’anthropologie nous montre aujourd’hui que ce dogme d’une
nature unique à laquelle fait face une myriade de cultures est
tout simplement le présupposé propre à notre culture, le
présupposé qui nous a contraint de poser les questions à travers
son prisme déformant. Elle nous apprend ce que la philosophie
ne pouvait savoir par elle-même : que dans l’ensemble des
cosmologies dont elle a recueillie les témoignages au cours de
ses enquêtes auprès des peuples de la terre, le modèle qui
oppose nature et culture n’a pas de sens, n’existe pas. C’est un
cas très particulier, plutôt « exotique », qui ne saurait servir
d’étalon de mesure des autres cultures.
Il faut en tirer un premier enseignement qui dépasse les
pratiques amérindiennes. Dans toutes les cultures, c’est-à-dire
des milliers de civilisations, il n’y a pas de séparation entre
environnement physique et environnement social, mais au
contraire « continuum d’interaction entre personnes humaines
et non-humaines » (Descola, 41). On retrouve la même
cosmologie chez bien des ethnies :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%
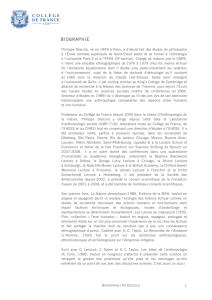
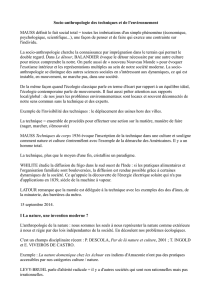
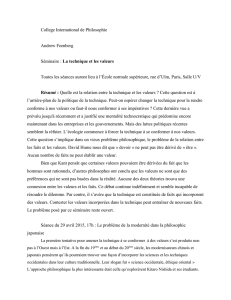
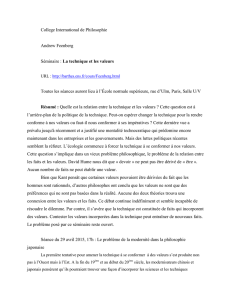
![Par-delà nature et culture [Philippe Descola]](http://s1.studylibfr.com/store/data/004653918_1-6e05b12e0367f5b38f9b6d71106c799f-300x300.png)