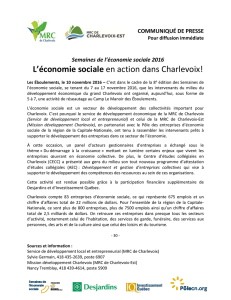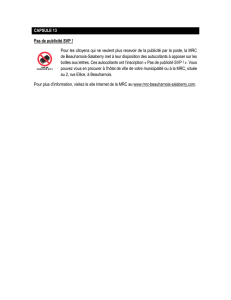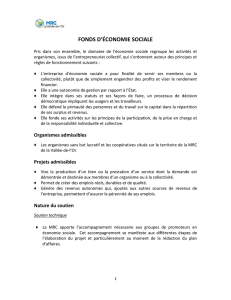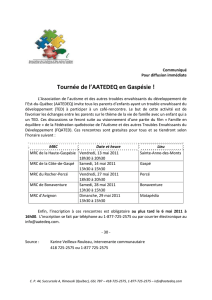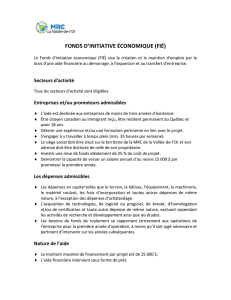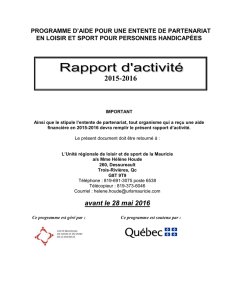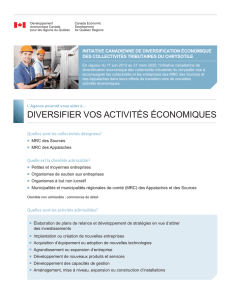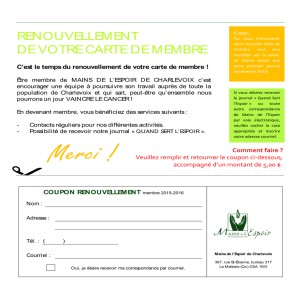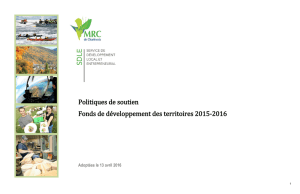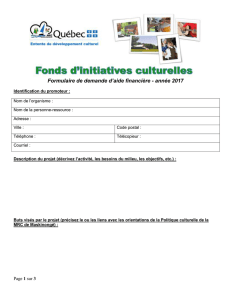Rapport final - MRC de Charlevoix

Étude du patrimoine de la MRC de Charlevoix
Bergeron Gagnon inc., consultants en patrimoine culturel
0
ÉTUDE DU PATRIMOINE DE LA MRC DE CHARLEVOIX
Rapport final
Bergeron Gagnon inc.
Consultants en patrimoine culturel

Étude du patrimoine de la MRC de Charlevoix
1
Table des matières
Table des matières ..................................................................................................................... 0
Préambule ................................................................................................................................... 3
Mandat ........................................................................................................................................ 5
Introduction ................................................................................................................................ 7
Liste des abréviations ............................................................................................................................ 8
Méthodologie .............................................................................................................................. 9
Présentation des territoires d’étude ....................................................................................... 13
A. Caractérisation des zones d’étude ............................................................................. 15
1. Résultats quantitatifs de l’inventaire ................................................................................. 17
2. Le cadre bâti et paysager (Île-aux-Coudres) ..................................................................... 19
2.0 Contexte historique ........................................................................................................................ 19
2.1 L’occupation du territoire .............................................................................................................. 20
2.2 Le patrimoine ................................................................................................................................. 20
2.3 Le paysage ..................................................................................................................................... 21
2. Le cadre bâti et paysager (La Baleine) .............................................................................. 24
2.0 Le contexte historique.................................................................................................................... 24
2.1 L’occupation du territoire .............................................................................................................. 24
2.2 Le patrimoine ................................................................................................................................. 25
2.3 Le paysage ..................................................................................................................................... 26
2.4 Élément problématique .................................................................................................................. 27
2. Le cadre bâti et paysager (Les Éboulements) ................................................................... 29
2.0 Contexte historique ........................................................................................................................ 29
2.1 L’occupation du territoire .............................................................................................................. 30
2.2 Le patrimoine ................................................................................................................................. 31
2.3 Le paysage ..................................................................................................................................... 32
2. Le cadre bâti et paysager (Petite-Rivière-Saint-François) .............................................. 35
2.0 Contexte historique ........................................................................................................................ 35
2.1 L’occupation du territoire .............................................................................................................. 35
2.2 Le patrimoine ................................................................................................................................. 37
2.3 Le paysage ..................................................................................................................................... 39
2.4 Les éléments problématiques ......................................................................................................... 41
2. Le cadre bâti et paysager (Saint-Hilarion) ........................................................................ 43
2.0 Le contexte historique.................................................................................................................... 43
2.1 L’occupation du territoire .............................................................................................................. 43
2.2 Le patrimoine bâti .......................................................................................................................... 46
2.3 Le paysage ..................................................................................................................................... 47
2.4 Éléments problématiques ............................................................................................................... 49
2. Le cadre bâti et paysager (Saint-Joseph-de-la-Rive) ........................................................ 51
2.0 Contexte historique ........................................................................................................................ 51
2.1 L’occupation du territoire .............................................................................................................. 51
2.2 Le patrimoine ................................................................................................................................. 52
2.3 Le paysage ..................................................................................................................................... 54
3. La typologie des bâtiments d’intérêt patrimonial ............................................................ 57
3.1 Les maisons d'habitation ................................................................................................................ 57
3.2 Les bâtiments secondaires ............................................................................................................. 78
B. Évaluation des zones d’étude ..................................................................................... 85

Étude du patrimoine de la MRC de Charlevoix
Bergeron Gagnon inc., consultants en patrimoine culturel
2
1. Analyse de l'architecture à partir de la typologie ............................................................. 87
1.1 La représentation et la caractérisation des types architecturaux domestiques ................................ 87
1.2 Les caractéristiques de l'architecture ............................................................................................. 93
1.3 La valeur d'âge des maisons traditionnelles ................................................................................... 95
2. L’état physique ..................................................................................................................... 97
Introduction : état physique et état d’authenticité : deux éléments bien distincts ................................ 97
2.1 Les maisons d’habitation d’intérêt patrimonial .............................................................................. 97
2.2 Les bâtiments secondaires d’intérêt patrimonial ............................................................................ 98
3. L’état d’authenticité ............................................................................................................ 99
3.1 Les principaux constats communs à toutes les municipalités ......................................................... 99
3.2 Problèmes récurrents à tous les types de bâtiments d'intérêt patrimonial .................................... 100
3.3 Constats propres à certaines municipalités .................................................................................. 103
3.4 L’état d’authenticité du paysage .................................................................................................. 105
4. Les autres contraintes à la mise en valeur ....................................................................... 109
4.1 L’insertion des bâtiments contemporains ..................................................................................... 109
4.2 Affichage commercial .................................................................................................................. 109
4.3 Les réseaux aérien de distribution ............................................................................................... 109
4.4 Antennes paraboliques ................................................................................................................. 110
4.6 Nouveaux développements .......................................................................................................... 110
5. Les édifices et territoires d’intérêt particulier ................................................................ 112
5.1 Analyse sommaire des édifices d’intérêt particulier .................................................................... 112
5.2 Présentation des édifices présentant un intérêt particulier ........................................................... 113
5.3 Recommandations relatives aux territoires d'intérêt ................................................................... 117
C. Identification des objectifs et des orientations ; proposition d’outils de sensibilisation, de
protection et de mise en valeur. .................................................................................... 125
Introduction. La valorisation du paysage … prochain enjeu régional ............................ 127
L’Objectif général .............................................................................................................................. 129
Les objectifs spécifiques .................................................................................................................... 129
L’approche ......................................................................................................................................... 131
1. Présentation générale des mesures de sauvegarde, de conservation et de mise en valeur132
2. Présentation de certaines mesures ................................................................................... 139
2.1 Mesures de sensibilisation ........................................................................................................... 139
2.2.2 Création de sites du patrimoine ................................................................................................ 144
2.3 Mesures de mise en valeur ........................................................................................................... 145
3. Maîtrise d’œuvre et partenariat ....................................................................................... 149
4. Stratégie et priorités d'intervention ................................................................................. 153
4.1 Le rôle de la MRC de Charlevoix – le coffre à outils régional .................................................... 153
4.2 Les priorités régionales ................................................................................................................ 153
4.3 Les priorités municipales – le coffre à outils municipal .............................................................. 153
Conclusion .............................................................................................................................. 157
Bibliographie .......................................................................................................................... 159
Annexe 1 . Lexique utilisé dans la typologie architecturale ............................................... 161
Annexe 2 . Liste des bâtiments d’intérêt patrimonial présentant un intérêt particulier 163
Annexe 3 . Photographies et cartes...................................................................................... 169

Étude du patrimoine de la MRC de Charlevoix
3
Annexe 4 . Informations sur les matériaux de remplacement et les couleurs ................. 171
Préambule
Dans le contexte de la révision de son schéma d’aménagement, la MRC de Charlevoix a
entrepris en 1999 un projet consacré aux territoires d'intérêt patrimonial. Aussi, le schéma
d'aménagement révisé (PSAR) comprend un plan d'action identifiant les interventions à
entreprendre en matière culturelle. Ce projet d'envergure régionale touche six des huit
municipalités de la MRC, soit Les Éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rive, La Baleine,
l'Île-aux-Coudres, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Hilarion.
Puisque Baie-Saint-Paul a déjà effectué plusieurs études et entrepris une démarche de
valorisation de son patrimoine, la municipalité ne participe pas au présent mandat. Par
ailleurs, Saint-Urbain n’a pas jugé pertinent faire partie du processus.
Dans le cas des municipalités visées, la démarche de la MRC implique trois phases
principales, soit :
- l’inventaire architectural ;
- l’étude des territoires d'intérêt patrimonial ;
- le développement d'outils de protection, de mise en valeur et de sensibilisation.
Le présent mandat est consacré à la phase 2, soit l’étude des territoires d'intérêt
patrimonial.

Étude du patrimoine de la MRC de Charlevoix
Bergeron Gagnon inc., consultants en patrimoine culturel
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
1
/
178
100%