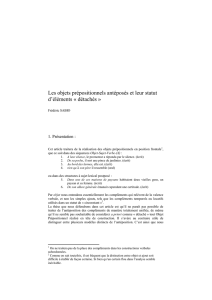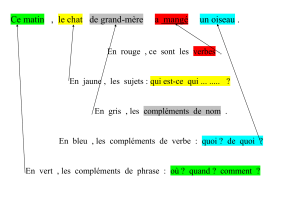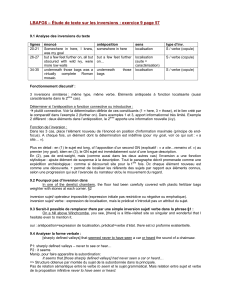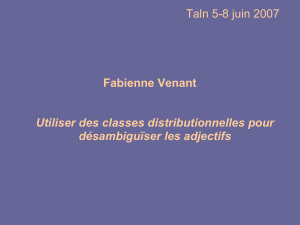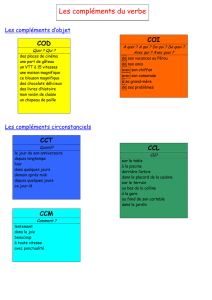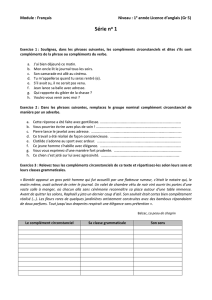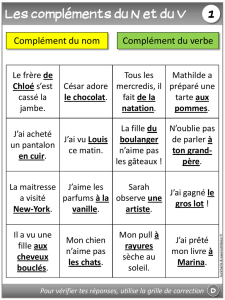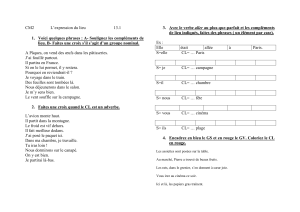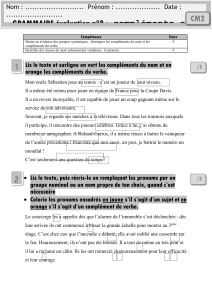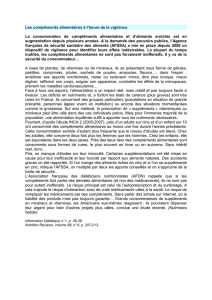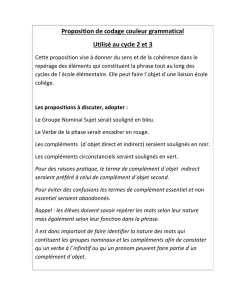L`antéposition des compléments dans le français contemporain

is is a contribution from Lingvisticæ Investigationes 29:1
© 2006. John Benjamins Publishing Company
is electronic file may not be altered in any way.
e author(s) of this article is/are permitted to use this PDF file to generate printed copies to
be used by way of offprints, for their personal use only.
Permission is granted by the publishers to post this file on a closed server which is accessible
to members (students and staff) only of the author’s/s’ institute.
For any other use of this material prior written permission should be obtained from the
publishers or through the Copyright Clearance Center (for USA: www.copyright.com).
Please contact rights@benjamins.nl or consult our website: www.benjamins.com
Tables of Contents, abstracts and guidelines are available at www.benjamins.com
John Benjamins Publishing Company

© 2006. John Benjamins Publishing Company
All rights reserved
Lingvisticæ Investigationes73–82
L’antéposition des compléments
dans le français contemporain
Introduction : Les objets directs sont-ils antéposables ?
Paul est ici
un livre je lis
et al.

© 2006. John Benjamins Publishing Company
All rights reserved
74
Que de la tendresse tu m’inspires
Un bon disque on va s’écouter, d’accord ?
Les modaux je déteste moi
Deux cigarettes j’ai fumé
Moi la bourgeoisie de Province j’ai pas connu
Deux francs vous n’avez pas ?
objet direct
. Les deux formes macro-syntaxiques de l’antéposition
anté-
position
La bourgeoisie de province /préf/ j’ai pas connu /no/
la bourgeoisie de Province
j’ai pas connu
infra

© 2006. John Benjamins Publishing Company
All rights reserved
75
Les F3 /préf/ elle supporterait pas /no/
Combien ça a coûté /préf/ je sais pas /no/
Moi le chocolat /préf/ j’adore /no/
Que de la tendresse /no/ tu m’inspires /post/
que de la tendresse
Deux cigarettes /no/ j’ai fumé /post/tu as beaucoup
fumé
A peine huit ans /no/ il a /post/
2. Micro-syntaxe et macro-syntaxe
C’était un établissement financier qui s’occupait de financement du cinéma
— à la fois — pour la production de films — pour la rénovation de salles de
cinéma — et aussi pour euh la télévision
est

© 2006. John Benjamins Publishing Company
All rights reserved
76
AB
ABBA
Il y avait entre autre Allan Kardec alors là c’était rigolo c’était une
tombe les gens allaient faire un vœu — puis quand ils avaient fait
leur vœu — il y avait une pierre ils mettaient des sous dessus pour que
le vœu soit exaucé
c’était une tombe les gens allaient faire un vœu
il y avait une pierre ils mettaient des sous dessus pour que le vœu soit
exaucé
B
A
B
Malheureusement /préf/ elle est trop faible pour pouvoir faire marche
arrière /no/
Euh pour parler de ma première journée de travail /préf/ euh j’étais parti
le matin très tôt parce que on commençait le travail aux alentours de six
heures du matin /no/
Il me le dirait /préf/ je ne le croirais pas /no/
Malgré qu’elle était ouvrière /préf/ il était pas souple avec elle /no/
Si tant de gens font des cures /préf/ c’est pas pour rien /no/
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%