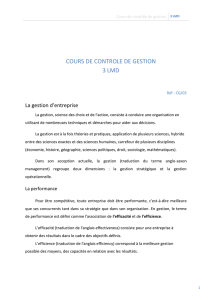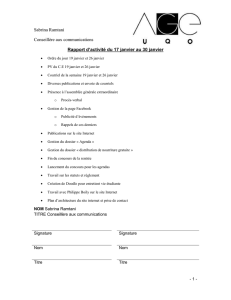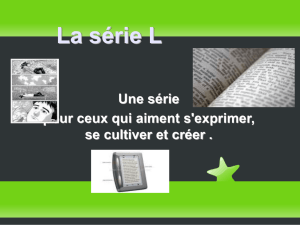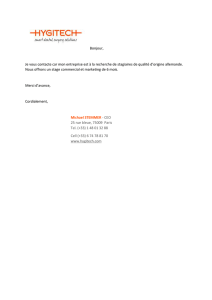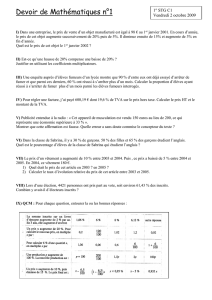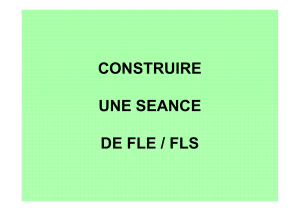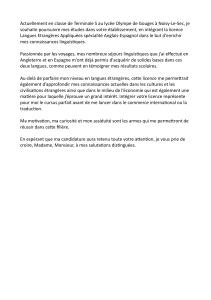communication orale

Matière : CEO 1ère année LMD Mme. Nasrouche Sabrina
La communication (notions générales)
La communication est l'action de communiquer, d'établir une relation avec autrui, de
transmettre quelque chose à quelqu'un. Elle peut aussi désigner l'ensemble des moyens
et techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'une audience plus ou
moins vaste et hétérogène ou l'action pour quelqu'un ou une organisation d'informer et
de promouvoir son activité auprès d'autrui, d'entretenir son image, par tout procédé
médiatique.
Elle concerne aussi bien l'être humain (communication interpersonnelle, groupale…),
l'animal, la plante (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine
(télécommunications, nouvelles technologies…), ainsi que leurs hybrides : homme-
animal; hommes-technologies… C'est en fait, une science partagée par plusieurs
disciplines qui ne répond pas à une définition unique. Comme le constate Daniel
Bougnoux « Nulle part ni pour personne n'existe LA communication. Ce terme recouvre trop
de pratiques, nécessairement disparates, indéfiniment ouvertes et non dénombrables. »
1
La communication humaine est principalement linguistique ; les êtres humains échange
entre eux des messages codés dans une langue en commun, à travers un canal qui
pourrait être naturel ou artificiel, dans un contexte partagé. Ces éléments et bien
d’autres sont représentés par Jackobson dans un schéma récapitulatif appelé « le
schéma de communication ».
1
Daniel Bougnoux, Introduction aux sciences de la communication, La découverte, Collection repères, Paris 2001.

Matière : CEO 1ère année LMD Mme. Nasrouche Sabrina
Langue orale, langue écrite
Toutes les langues sont orales avant d'être écrites : dans l'histoire des sociétés mais
bien sûr aussi pour chaque individu qui parle bien avant d'apprendre/de savoir écrire.
Le code oral, premier accès au langage, est représenté dans l’imaginaire populaire
comme étant naturel et simple, donc, facile à acquérir.
Voilà un des nombreux mythes autour de la langue orale, souvent fondée sur une
confrontation avec la langue écrite.
Mythes selon lesquels…
…la langue orale serait…
…la langue écrite
serait…
Mais…
…familière, populaire…
…soutenue
Il existe pourtant des
formes orales élaborées
comme les discours
prononcés dans les
conférences, les
interviews…etc.
…Plus expressive
qu’organisée logiquement.
La poésie orale est soumise
à une logique linguistique
remarquable.
…une langue fautive.
…une langue correcte.
Tout discours écrit n’est
pas forcément correcte.
…caractérisée par une
grammaire peu complexe.
…caractérisée par une
grammaire complexe.
…certaines études ont
montré que l’oral est
complexe sur le plan
grammatical, alors que
l’écrit l’est sur le plan
lexical.

Matière : CEO 1ère année LMD Mme. Nasrouche Sabrina
L'écriture d'une langue suppose :
Que cette langue ait été intégralement décrite : système
phonétique/phonologique, systèmes et sous-systèmes grammaticaux...
Que l'on connaisse bien le contexte sociolinguistique d'utilisation de cette langue
: en contact avec une autre, fonctions de cette langue, statut, représentations des
locuteurs, etc.
Que l'on soit très informé des processus de standardisation entraînés par
l'écriture.
Que l'on soit conscient de la tâche entreprise : l'écriture d'une langue, c'est sans
doute sa "graphicisation", mais c'est aussi s'engager dans la fabrication de
manuels, de grammaires, de dictionnaires... pour en permettre l'apprentissage, à
la fois par des locuteurs étrangers, mais surtout pour des locuteurs natifs (la
perspective de dictionnaires monolingues doit être envisagée) ;
Que l'on prévoie le développement d'une littérature : il est indispensable que
ceux qui apprennent à lire dans une langue puisse trouver un corpus intéressant,
et notamment un corpus littéraire de qualité suffisante ;
La traduction d'œuvres connues dans d'autres langues et d'autres cultures est
certainement une ressource à ne pas négliger, et la traduction est toujours
l'occasion de nouveaux développements pour une langue, mais c'est aussi une
question extrêmement complexe qu'il ne faut pas sous-estimée.
Les langues orales et les langues écrites diffèrent toujours considérablement.
Les différences entre langues orales et langues écrites sont nombreuses. On soulignera
tout particulièrement :
Les différences de situation : dans l'oralité celui à qui on parle est proche, voire
en face, de celui qui parle, qui voit le mouvement de ses lèvres, profite de ses
gestes et mimiques, décode, plus ou moins consciemment, son intonation, etc.

Matière : CEO 1ère année LMD Mme. Nasrouche Sabrina
La redondance, c'est-à-dire ce qui aide à compenser le "bruit" est extrêmement
différente à l'oral et à l'écrit. On ne peut considérer l'un des médiums comme
plus "redondant" que l'autre, mais ils sont indéniablement différemment
redondants.
La différence de "canal" n'est pas non plus à négliger.
En conséquence, les structures linguistiques sont elles-mêmes changées : là où
l'écrit proscrira la répétition et s'efforcera de faire varier le vocabulaire, l'oral se
servira même de la répétition à des fins intensives : comparer l'oral "il fait froid,
froid, froid..." (avec intonation adéquate) et l'écrit "Il fait très froid" ; "moi, mon
fils, sa femme elle est malade !" (phrase dont le modèle est courant en situation
d'oralité), "la femme de mon fils est malade" (modèle de l'écrit), etc.
La ponctuation souvent présentée comme un ensemble de marques destinées à
"remplacer" l'intonation, est bien incapable de rendre la richesse de l'intonation,
tant dans ses fonctions "grammaticales" que dans ses fonctions "expressives".
I.A PROPOS DE L’ORAL
QU’EST CE QUE L’ORAL?
1/Les caractéristiques de l’oral par rapport à l’écrit:
La linguistique a permis un nouveau regard sur l’oral: l’oral n’est pas un écrit dégradé, il a son
propre code avec ses propres marques ( linguistiques et communicationnelles).
Mais aujourd’hui la différence entre l’écrit et l’oral ne se situe plus dans les situations de
communication: directe avec un locuteur présent pour les échanges oraux et différée avec un
locuteur absent pour les échanges écrits. En effet les technologies de l’information et de la
communication remettent en cause ces distinctions avec l’utilisation des répondeurs
téléphoniques qui permettent un oral différé, avec internet qui utilise une communication écrite
directe, à peine différée. La distinction concerne plutôt des types de discours et des pratiques

Matière : CEO 1ère année LMD Mme. Nasrouche Sabrina
discursives différentes.
- discours se construit à plusieurs.
- contexte, rôle important.
se référer à Orecchioni
2/La complexité de l’oral:
L’oral ne se réduit pas à une émission sonore, la compétence langagière orale est double:
- linguistique :connaissances phonologiques, morphologiques et syntaxiques.
- communicationnelle: règles discursives, psychologiques, culturelles et sociales qui régissent
l’utilisation de la parole en fonction des contextes.
S’ajoutent à ces compétences langagières d’autres éléments importants dans une interaction
verbale: des éléments corporels avec les gestes, les mimiques, des éléments voco - acoustiques
avec les intonations, la vitesse d’élocution.... L’oral est donc ‘multicanal’: il combine des
moyens linguistiques, communicationnels, kinésiques et paralinguistiques.
Erreur ! Argument de commutateur inconnu.
Nous distinguons différentes composantes de la prise de parole1:
- Pragmatiques: comprendre l’enjeu de la situation, la tâche langagière requise par la situation,
donner du sens à sa prise de parole, choisir la ( ou les) conduite(s) discursive(s) adaptée(s).
- Discursives: maîtriser la ( ou les) conduite(s) discursive(s) requise(s) par la situation: narrative,
explicative ou argumentative...
- Linguistiques: maîtriser les formes linguistiques adaptées à la situation et requises par la
conduite discursive choisie: syntaxe, lexique, intonation.
- Métalinguistiques: contrôler son discours et agir sur sa production pour s’adapter à
l’interlocuteur ou mieux exprimer sa pensée.
- Travail sur soi: oser prendre les risques requis par la prise de parole, maîtrise le volume de sa
voix, son débit, son geste et son regard.
J Dolz et B Schneuwly2 ajoutent d’autres moyens non linguistiques intervenant dans la
1 Groupe oral-Créteil ‘Enseigner l’oral à l’école primaire.’, p21.
2 Dolz J., Schneuwly B. ‘ Pour un enseignement de l’oral. Initiation aux genres formels à l’école’,
p57.
communication orale: la position des locuteurs, leur aspect extérieur ( vêtements, coiffure...) et
l’aménagement des lieux.
Si progressivement les moyens verbaux et linguistiques deviennent dominants, les autres moyens
( kinésiques) ne disparaissent pas pour autant. Nous savons que la compétence de
communication est la première dans le développement de l’individu et précède la compétence
linguistique: l’enfant communique d’abord avec sa mère à travers des interactions non verbales
et apprend à parler ensuite.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%