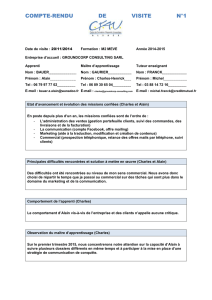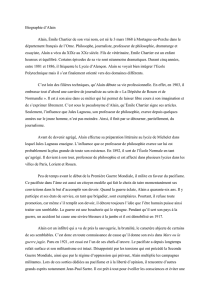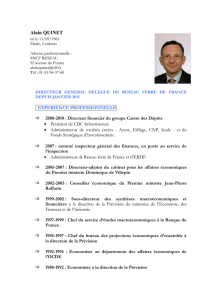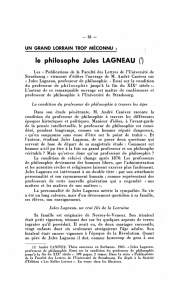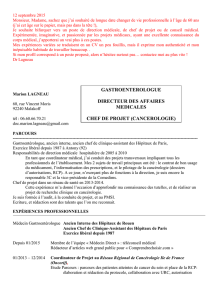Lagneau, la guerre et le devoir de résistance Une lecture des

La république et la nouvelle démocratie des citoyens
Lagneau, la guerre et le devoir de résistance
Une lecture des Souvenirs concernant Jules Lagneau
Emmanuel Blondel
Les Souvenirs concernant Jules Lagneau sont une méditation sur la Sévérité. Sévérité de
Lagneau à l’égard d’Alain, immédiatement sentie par l’élève rebelle et séduit. Entre les deux, une
opposition, que l’élève se sentira la tâche de développer, mais aussi de comprendre, et dont il
formule ainsi la teneur : « Ayant jugé une fois les pouvoirs réguliers, les ayant condamnés et
redressés, [Lagneau] pouvait-il promettre une obéissance sans condition, bien plus une
obéissance d’esprit sans condition, comme pourtant il me paraît qu’il a toujours voulu faire, à
l’égard de l’ensemble des pouvoirs divinisés en quelque sorte sous le nom de la Patrie ? ».
Réflexions sombres, approfondies pendant les années de journalisme et par l’expérience de la
guerre : « cette volonté de croire et en vérité d’adorer, quels que fussent les chefs, et en prenant
la haute politique comme un mystère impénétrable au bien commun, c’était bien clairement à
mes yeux la cause responsable de ce massacre machinal auquel je participais ». Seules pensées à
avoir fait de son existence « une espèce de drame », ces réflexions se nouent ici une fois de plus
sous la plume d’Alain, et prennent la forme d’un retour sur son passé de journaliste politique et
d’écrivain ; elles confèrent une urgence particulière à la méditation renouvelée de Spinoza et de
Platon, de la religion et du fanatisme, et tendent à faire éclater de l’intérieur, par leur mouvement
propre, la claire architecture du projet initial des Souvenirs. Mais c’est aussi par ce voyage au
cœur de la Sévérité que s’explicite réflexivement la nécessité d’un choix de s’inscrire dans
l’histoire des hommes, choix qui ne pourra jamais prétendre produire sa propre justification.
L’ouvrage
La rédaction des
Souvenirs concernant Jules Lagneau
i commence le 15
juillet 1923, à quelques mois du trentenaire de la mort du maître. Le projet
de quelques anciens, Alain l’évoque dans l’ouvrage, est de rassembler ses
trop rares écrits : articles, discours de distribution des prix, correspondance,
manifestes politiques (les
Simples notes
). Le résultat dépassera de loin ce
projet initial, puisque cet effort collectif aboutira à la publication de plusieurs
volumes : les
Écrits
proprement dits, les
Célèbres leçons
, le
Cours sur Dieu
,
les
Souvenirs concernant Jules Lagneau
. Mais cet ensemble s’est constitué
progressivement. Lorsqu’Alain prend la plume, même les
Célèbres leçons
n’existent pas en projet. Alain avait projeté, en 1898, de rédiger certaines de
ces leçons. Il y avait renoncé, se résignant à publier dans la
Revue de
métaphysique et de morale
un ensemble de « Fragments » extraits des notes
préparatoires de Lagneau, rassemblant dans le copieux commentaire qu’il
en livraitii les esquisses de rédactions les plus abouties. En 1923, son propos
n’est pas de renouer avec cet effort ; parallèlement à la préparation du

La république et la nouvelle démocratie des citoyens
volume des
Écrits
, il entreprend la rédaction d’un volume complémentaire,
ce volume de « Souvenirs » dans lequel il se propose de faire resurgir en sa
vérité la figure de son maître, et en particulier de donner, mais de manière
plus synthétique et sans s’en tenir à la lettre, une idée de son enseignementiii.
Un premier mouvement de composition clair peut être identifiéiv :
l’ouvrage comprendra quatre parties, d’une quinzaine de pages chacune. La
première, qui recevra pour finir le titre de « Souvenirs d’écolier », évoque le
choc de la rencontre, la figure du maître, une première référence au « petit
carnet noir » à partir duquel Lagneau exposait son cours de Psychologie ; la
deuxième revient sur la lecture de Platon, et en même temps sur le contenu
des leçons consacrées à la perception ; la troisième, sur la lecture de
Spinoza, et naturellement sur les leçons consacrées au jugement. La
quatrième nous fait saisir dans la figure de Lagneau celle d’un maître de
liberté.
Ce bel équilibre ne sera pas conservé. L’ouvrage, visiblement écrit tout
d’un trait, s’enrichit de deux ajouts fondamentaux.
Le premier est dû à une circonstance tout à fait heureuse : la réapparition
de Léon Letellier, fidèle entre les fidèles, qui apporte à Alain une rédaction
exemplaire du
Cours de psychologie
de 1889-90, ainsi qu’une rédaction
intégrale du
Cours sur Dieu
, qu’Alain ne connaissait qu’indirectement. Cet
événement modifie l’ensemble de la physionomie du projet initial de
restitution ; le
Cours sur Dieu
sera publié, ainsi que la rédaction par Letellier
du
Cours sur le jugement
et de la leçon
Évidence et certitude
. Le
Cours sur
la perception
paraîtra en même temps, mais dans une rédaction très
éloignée du contenu des notes de Letellier : il est clair qu’Alain ici s’est senti
contraint de renouer avec ses premières tentatives, et que cette dernière
rédaction porte sa marque plus que toute autre. Les
Souvenirs
eux-mêmes,
et c’est là notre premier « encart », s’augmententv d’une mise au point
qu’Alain juge nécessaire pour que la publication du
Cours sur Dieu
ne
détourne pas le lecteur d’une juste appréciation du génie de son maîtrevi : cet
encart représente, dans la version définitive, toute la fin du premier
« chapitre » (pp. 189-194). C’est la même nécessité, sans doute, qui pousse
Alain à insérer à la fin de la rédaction du
Cours sur Dieu
, qu’il n’avait pas
entendu, les deux derniers paragraphes, dont il raconte (229) que Lagneau
les improvisa au terme, semble-t-il, d’une leçon consacrée au jugement, et
dont les formules sévèresvii vont hanter la composition des
Souvenirs
:
La certitude est une région profonde où la pensée ne se maintient
que par l’action. Mais quelle action ? Il n’y en a qu’une, celle qui
combat la nature et la crée ainsi, qui pétrit le moi en le froissant. La
lâcheté, elle, a deux faces, recherche du plaisir et fuite de l’effort. Agir,

La république et la nouvelle démocratie des citoyens
c’est la combattre. Toute autre action est illusoire et se détruit (...). Mais
faut-il (...) faire la vie au lieu de la subir ? Encore une fois ce n’est pas
de l’intelligence que la question relève ; nous sommes libres, et en ce
sens, le scepticisme est le vrai. Mais répondre non, c’est rendre
inintelligibles le monde et soi, c’est décréter le chaos et l’établir en soi
d’abord. Or, le chaos n’est rien. Être ou ne pas être, soi et toutes
choses, il faut choisir.
Le « second encart » est bien plus considérable : dans l’édition la plus
récente, il représente seize pages (173-188), soit l’équivalent de la première
rédaction. C’est d’ailleurs sans douteviii ce déséquilibre qui justifiera
l’apparition des « titres », et le recours à la division en chapitres : « Souvenirs
d’écolier », « Platon », « Spinoza », « L’Homme ». Mais cette fois, l’encart ne
se justifie pas par un événement extérieur. Il relève d’une nécessité autre.
Alain vient d’évoquer les passions de Lagneau (« Lagneau était de Metz ») ;
il a rappelé la passion antiprussienne du maître (« on m’a conté qu’un
professeur allemand ayant désiré entendre une de ses leçons, Lagneau ne
put prendre sur lui de parler ») et son antisémitisme (« Lagneau avait un fort
préjugé contre les Juifs ») : d’où l’interrogation d’Alain sur ce qu’eût été son
attitude lors de l’affaire Dreyfus :
Il y a une chose dont je suis sûr, c’est qu’il n’aurait nullement
approuvé en aucun cas les passions politiques qui m’y jetèrent moi-
même, non plus que cette collaboration suivie aux petits journaux qui
datent de ce temps-là. Non plus, je le crains, ce que j’ai écrit de la
guerre et de la paix. De mon côté je n’aimerais guère entendre ce qui
sera dit solennellement à Metz quand on honorera sa mémoire dans la
maison où il est né. J’ai connu de sombres méditations sur la route de
Metz, entre Rambucourt et Flirey ; c’était pendant l’hiver de 1914 ;
mais apaisons ces tristes pensées, qui sont à peine des pensées.
Nous sommes réunis pour évoquer « Alain dans ses œuvres et son
journalisme politique ». La référence ici est précise : il s’agit pour Alain
d’évoquer ce que Lagneau eût pensé de son œuvre de journaliste et de ses
premières œuvres, et en particulier de
Mars ou la guerre jugée
; mais aussi
ce qu’il eût pensé de ses « passions politiques ». Or il me semble que ce
mouvement, par lequel Alain s’efforce de se confronter à la supposée
sévérité de son maître, gouverne l’organisation des
Souvenirs
dans leur
première rédaction, mais aussi, et de manière encore plus frappante, le
surgissement et la forme de ce « second encart » ; et que se manifestent ici
des aspects déterminants de la décision d’écrire et de la pratique de
l’écriture chez Alain.

La république et la nouvelle démocratie des citoyens
Un essai sur la sévérité
Revenons au thème. Car c’est bien sur le thème de la sévérité que s’ouvre
le livre (155) :
Je veux écrire ce que j’ai connu de Jules Lagneau, qui est le seul
grand homme que j’aie rencontré. Il était mieux de livrer au public un
exposé systématique de la doctrine ; mais cela je ne l’ai point pu. Les
raisons s’en montreront chemin faisant ; je puis dire que ce qui me
rendit la tâche impossible ce fut surtout la peur d’offenser cette ombre
vénérée. Nos maîtres, vers l’année 1888 qui est celle de mes vingt ans,
étaient sévères comme on ne l’est plus ; mais ce maître de mes pensées
l’était, en ce qui me concerne, par des raisons plus précises. J’étais déjà
un habile rhéteur, et je ne respectais rien au monde que lui ; ce
sentiment donnait des ailes à ma prose d’écolier ; en écrivant je
combattais pour lui, et je méprisais tout le reste, d’où une audace, une
force persuasive, un art de déblayer qui amassèrent plus d’une fois des
nuages autour du front redoutable.
Cette entrée en matière fait donc retour sur les échecs antérieurs
(rédaction d’un « exposé systématique de sa doctrine »), et présente les
Souvenirs
comme l’ouvrage par lequel Alain se propose de
transfigurer en
méthode d’écriture
ce qui lui avait rendu la tâche « impossible ». Cette
« peur » est sans prise, autre qu’elle-même : aussi écrire de Jules Lagneau
revient-il à penser le sens de cette expérience de la « sévérité », sévérité de
Lagneau envers Alain, sévérité aussi, nous y reviendrons, d’Alain envers son
maître, ce qui est sans doute le sens du passage vers lequel nous nous
dirigeons.
Quelques jalons. On retrouve naturellement le thème de la sévérité dans
ce qui constituait à l’origine la conclusion de la première partie (188),
puisque cette conclusion, dans la première rédaction, s’enchaînait
directement au passage que nous venons de citer :
Lagneau ne traitait jamais de morale. Sans doute se défiait-il des
passions ; mais je ne crois point du tout qu’il eût été en ces matières
hésitant ou indulgent. Bien plutôt je le vois terriblement clairvoyant et
sévère. Mais quoi ? Nous étions des enfants, et il ne nous connaissait
guère.
Beaucoup plus loin, à la fin du chapitre IV, Alain revient sur ces thèmes
désormais solidaires : la sévérité, la rhétorique (
cf.
« j’étais déjà un habile
rhéteur »), le fait que Lagneau ne traitait pas de morale (239) :

La république et la nouvelle démocratie des citoyens
Ce qu’il y a de pensée dans notre vie oscille sans cesse entre
l’incrédulité et la Foi, la première se réduisant au fatalisme sous toutes
formes, l’autre consistant d’abord dans ce pouvoir d’oser, sans lequel il
n’y a point d’action ni même de pensée. Mais si je me laissais aller à
expliquer ces idées (...) je craindrais de voir le visage du Juge se couvrir
de nuages (...). Au temps des examens et concours, je savais très bien
adapter l’instrument à un sujet qui m’était nouveau. La rhétorique, qui
qui qui
qui
est cet art de transposer
est cet art de transposerest cet art de transposer
est cet art de transposer, donnait alors des résultats brillants, et même, à
ce que je crois maintenant, sans grave méprise. Mais au retour, et tout
joyeux de raconter mes exploits d’écolier, je trouvais ce front nuageux,
ce regard perçant, et l’expression du plus complet mépris.
Alain revient alors sur une anecdote : l’écolier passe le Concours général,
le sujet porte sur la Justice, ce qui n’est pas indifférent. La rhétorique, cette
« diabolique facilité » (210), resurgit aussi : « C’était une question que
Lagneau ne traitait jamais. Toutefois, confiant dans la rhétorique, j’aperçus
aussitôt une méthode de transformation, comme disent les géomètres, qui
me faisait maître du sujet. J’approchai ma plume de mon papier blanc ». Ici
revient la sévérité :
Lagneau se trouvait là parmi les professeurs surveillants. Invoquant ce
Sinaï, plus orageux que jamais, que n’allais-je pas transcrire sur mes
tables de la Loi ? Mais lui me fit un signe plein de force, qui voulait
dire : Vous ne savez rien là-dessus, je vous défends d’improviser. Je fis
deux ou trois sonnets.
Cette sévérité qui refuse l’hommage, et donc la rhétoriqueix, hommage
d’enfant qui désapprendrait de se faire homme, est précisément présentée
comme énigmatique apprentissage de la liberté, ce qui établit le lien entre le
premier et le dernier chapitre :
Qu’y a-t-il en cette sévérité sans complaisance ? (...) Quel est cet art
de décourager, qui donne courage ? Le sujet était de ceux qui veulent
réponse (...). N’est-ce pas se moquer de la justice que disserter de la
justice, bien ou mal, quand le langage même nous avertit qu’un esprit
juste enferme toute la justice qu’il peut tenir, hors de l’action ? C’est
livrer la justice aux hasards. Et il me semble que je tiens ici devant moi
l’esprit des
Simples notes
, et enfin la véritable raison pour quoi
Lagneau ne traitait jamais de morale. Par opposition essayons ici de
penser au Politique, dont la fin est toujours de déterminer l’autre selon
une règle.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%