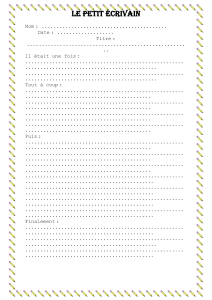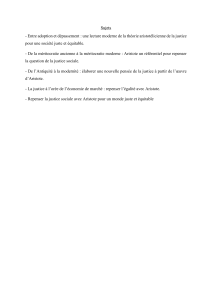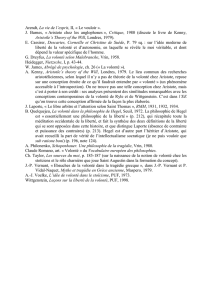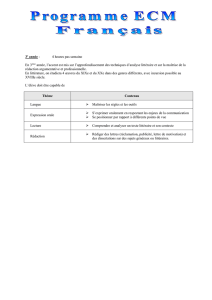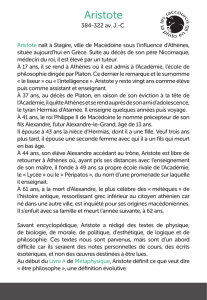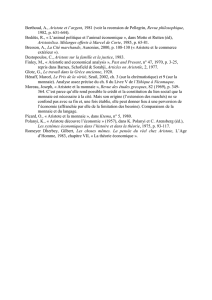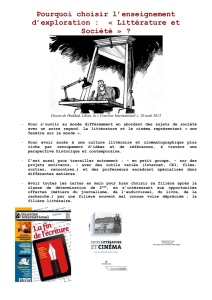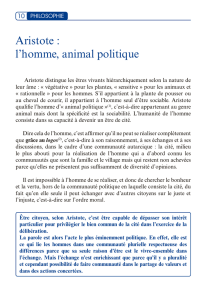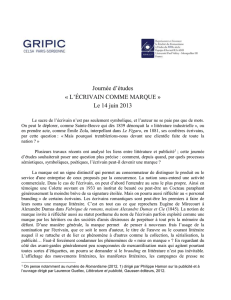Corrigé type La critique littéraire est un effort de discernement qui s

Corrigé type
La critique littéraire est un effort de discernement qui s'applique aux œuvres des écrivains, soit pour
les juger, soit pour expliquer leur formation, leur structure, leur sens. C’est une discipline qui
s'intéresse aux genres littéraires et à tous les genres confondus. On vise à imposer les règles prescrites
pour aboutir à une belle œuvre littéraire. De nouvelles formes et de nouvelles tendances qui se mettent
en rupture avec le classicisme d'Aristote. Cette rupture est caractérisée par le refus des règles
classiques.
a- L’idéalisme d’Aristote : (03 points) Aristote a profondément modelé la vision occidentale de
l’art. La définition aristotélicienne de l’art comme imitation a fait l’objet de nombreux débats,
ainsi que sa conception de la tragédie comme une forme de purification (« catharsis »).
Aristote donne sa célèbre définition de l’art comme imitation. Les différents arts se
distinguent les uns des autres par ce caractère essentiel : soit ils imitent différemment, soit ils
imitent des choses différentes. Aristote note qu’il n’existe pas de nom qui désigne l’art qui
imite en général par le langage, et qui regrouperait à la fois les dialogues de Socrate et les vers
de poète, c’est-à-dire philosophie, poésie, littérature…D’autre part, l’imitation peut améliorer,
conserver ou déprécier l’objet imité. Ainsi, alors que la tragédie représente l’homme supérieur
(de par la profondeur et la gravité de sentiment qu’il affiche), la comédie se moque des travers
des hommes et se plaît à dépeindre les hommes comme inférieurs à ce qu’ils sont en réalité.
L’imitation est non seulement source de connaissance, mais aussi de plaisir. Aristote note par
exemple ce paradoxe apparent, selon lequel nous répugnons à la vue d’un cadavre, mais nous
prenons plaisir à voir celui-ci représenté sur un tableau, par exemple dans une scène de guerre.
Aristote définit la comédie comme l’imitation d’hommes de qualité morale inférieure, mais on
trouve surtout sa célèbre définition de la tragédie, comme catharsis (purification). En effet, en
tant qu’elle suscite la pitié et la crainte, elle opère la purgation propre à pareilles émotions.
b- Le biographisme : (03 points) Pour Saint Beuve l'auteur est le médiateur entre la société et
la littérature. Ses convictions, ses événements qu'il a vécus, ses circonstances participent à la
création de son œuvre. C'est le Biographisme.
c- « La faculté maîtresse » : (03 points) Hyppolite Taine est historien. La critique est pour lui
une forme de l'histoire. Il croit réussir en cherchant à dégager la faculté maîtresse de l'auteur
qu'il étudie, en expliquant celle-ci par l'influence de la race, du milieu, du moment. Taine ne
semble pas s'apercevoir que ses analyses ne peuvent expliquer ce qu'est proprement le génie.
C'est qu'en réalité il faut commencer par distinguer entre l'histoire littéraire, qui peut être
scientifique et impersonnelle, qui étudie les conditions d'existence des œuvres littéraires
(matérialité du texte, sources, genèse psychologique ou historique, etc.), et la critique
littéraire, qui s'efforce d'apprécier et de juger les œuvres pour éclairer les choix du public.
d- « La littérature est comme le rêve » : (03 points) Différente avec la psychanalyse : la
psychocritique s’exerce sur les œuvres non sur les gens, ce n’est pas de la thérapeutique mais
de l’interprétation. Pas de vertu curative. L’œuvre est envisagée à la manière d’un rêve (Freud,
le rêve et son interprétation). Le travail du rêve consiste à deux procédés : la condensation de
deux images en une seule, son équivalent en littérature est la métaphore, et le déplacement :
c'est la focalisation sur un seul détail , son équivalent en littérature est la métonymie. La
création littéraire est apparentée au rêve éveillé, la thématique la transposition d’un travail de
Université Mohamed Boudiaf
NIVEAU : 2 ème année LMD
Faculté des Lettres et des Langues
MODULE : Littératures de langue française
Département des Lettres & Langue Française
Enseignante responsable : Mme Houichi

rêve, satisfaction de désirs inconscients. L’œuvre oscille entre création consciente et processus
inconscient. On ne peut comprendre le détail que par l’ensemble, il est donc nécessaire
(encore une fois) de faire le tour complet de l’œuvre d’un auteur. La psychocritique remet à
l’ordre du jour le rapport vie œuvre, mais selon un procédé différent, mais cela place cette
critique un peu a contre courant de ce qui se fait dans la nouvelle critique. Les souvenirs
personnels jouent un rôle dans la création ou ils sont transposés et transformés. L’œuvre ne
raconte pas la vie. Les personnages rencontrés dans les œuvres sont différentes facettes de la
personnalité de l’auteur. Les œuvres sont en partie le produit d’un fond de souvenir oubliés et
réveillés par un événement présent. L’écrivain réagis au monde qui l’entoure. Son œuvre se
développe et s’élabore à partir d’un réseau d’obsessions par le biais de masques. Les œuvres
servent à superposer des masques sur le visage de l’écrivain.
e- Le mythe personnel (03 points) : Contrairement à la critique de l’imaginaire, il y a une
méthode psychocritique. On part de l’idée que le langage combine plusieurs logiques à la fois
dont deux qui s’entremêlent : la synthèse du langage conscient et inconscient. Quand l’auteur
trace une phrase, il veut dire une chose, et il la dit effectivement, mais il s’y glisse également
des choses qu’il dit aussi, mais sans le savoir. Charles Mauron : Des Métaphores Obsédantes
au mythe personnel, introduction à la psychocritique, La méthode consiste à relever dans le
texte des associations d’idées involontaires sous les structures voulues du texte. Métaphores
obsédantes : hantise, répétition de ce qui angoisse le moi de l’auteur, qui tente de régler un
problème chargé de valeurs affectives (affects) contradictoires. On peut remonter au mythe
personnel à partir de ces obsessions, à la structure mentale. Ce mythe est d’origine très
ancienne, il se constitue généralement à l’adolescence, quand la dernière étape est la
vérification biographique. Mais seulement en dernier lieu. C’est l’œuvre qui explique la vie et
non l’inverse (…)
2/- Œuvre-objet / œuvre-reflet (03 points) : Les approches psychocritique, sociocritique, de critique
thématique, de critique formaliste ou structuraliste donnent lieu à de véritables expériences de
laboratoire. La critique structurale s'intéresse à repérer les propriétés observables de l'œuvre, comme la
récurrence des signes symétriques entre des sons et des mots. Elle s'intéresse à l'origine de l'œuvre. Par
contre, les herméneutiques qui cherchent l'originalité de l'œuvre hors l'œuvre, dans la société et dans la
vie de l'auteur. Elle est proche de la critique thématique, sauf que cette dernière est liée à l'imaginaire.
Le sens de l'œuvre donc, est intertextuel. La philosophie de l'œuvre-objet (l'œuvre est un objet
d'étude). Elle est opposée à l'œuvre-reflet. C'est une œuvre en tant quantité matérielle et en tant que
construction objective ayant ses propriétés internes. Pour la critique structurale, il ne faut pas
confondre l'homme et l'artiste. La littérature a été déchue de son statut, sous la montée des positivistes
alors, elle s'est repliée sur elle-même d'où l'idée de l'intransitivité de l'œuvre (on ne peut pas passer de
l'œuvre à la société) Le style n'est pas un exercice, il est une trame savamment élaborée qui assure la
cohérence de l'œuvre. L'écriture est devenue un travail municieux et laborieux. Il faut une maîtrise
parfaite de langue. l'écrivain est comme une calculatrice, il est un être de langage.
- Moi social / moi profond (02 points) : La critique thématique considère l'œuvre comme une totalité
qui reflète un paysage intérieur. Elle constitue l'univers imaginaire de l'auteur. Elle se met en rupture
avec la psychocritique, la sociocritique et le biographisme car elle ne s'intéresse qu'à l'œuvre sans se
référer à l'histoire littéraire ou à la société. L'auteur se trouve obsédé par un thème qui se répète dans
toutes ses œuvres. L'auteur gère et domine son obsession. ( l’obsession). L'auteur fait accepter son
défaut par la présence d'un autre moi loin du moi social. C'est le moi profond qui fait l'identité de
l'écrivain. (la sublimation). Le but de la thématique est d'atteindre la vision du monde de l'auteur
(comment il aperçoit le monde).
1
/
2
100%