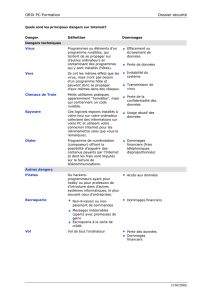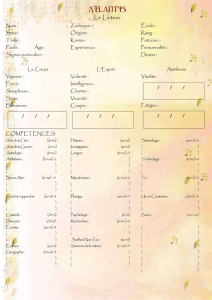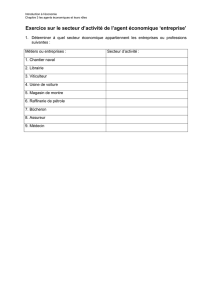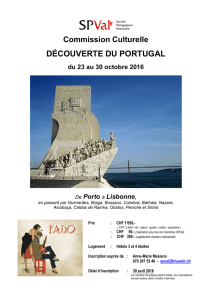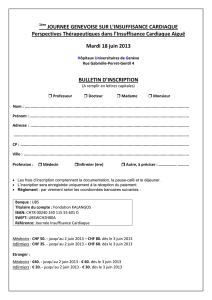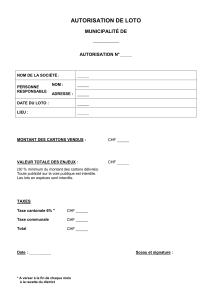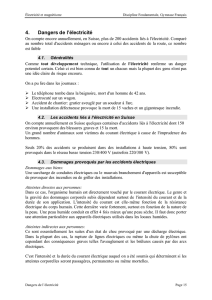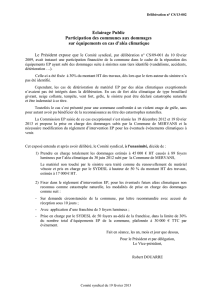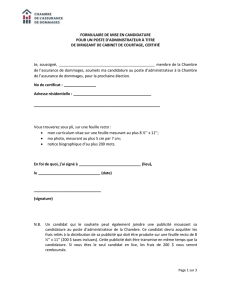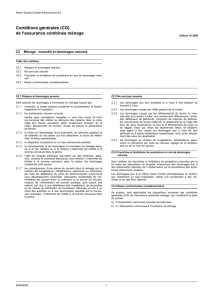Compte rendu d`ateliers - Interkantonaler Rückversicherungsverband

Compte rendu d’ateliers
Evolution du climat et de la vulnérabilité
des bâtiments en Suisse jusqu’en 2050:
Répercussions attendues sur les dangers naturels et les dommages aux bâtiments

2
Editeur
Tous droits réservés © 2008
Union intercantonale de réassurance
Bundesgasse 20
CH-3001 Berne
www.irv.ch
Auteurs
Peter Christen
Dr Thomas Egli
Thomas Frei
Dr Christoph Frei et Florian Widmer
Dr Stefan Heuberger
Dr Felix Keller
Dr Pierino Lestuzzi
Dr Bernard Loup
Dr Christoph Raible
Ulrich Roth
Dr Hans-Heinrich Schiesser
Peter Schmid
Illustrations
Sigmaplan SA
Coordination
Sigmaplan SA: Ulrich Roth, Thomas Frei
UIR: Dr Stefan Heuberger, Rolf Meier
Réalisation et production
Rickli + Wyss, Berne
Tirage
400 exemplaires en allemand
100 exemplaires en français
Les droits sur l’exposé de Christoph Frei et Florian Widmer sont détenus par MétéoSuisse et PLANAT
Remerciements
Nous remercions tous les conférenciers et les participants pour leurs contributions.
Conférenciers: Peter Christen, Dr Thomas Egli, Dr Christoph Frei, Dr Stefan Heuberger,
Martin Kamber, Dr Felix Keller, Dr Pierino Lestuzzi, Dr Bernard Loup, Dr Christoph Raible,
Dr Hans-Heinrich Schiesser, Peter Schmid
Interkantonaler Rückversicherungsverband
Union intercantonale de réassurance
Interkantonaler Rückversicherungsverband
Union intercantonale de réassurance
Impressum

3
Avant-propos ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4
1er atelier: Répercussions du changement climatique sur le potentiel de dommages futur ������������������������������ 5
Bases de discussion et sujets abordés par l’UIR ......................................................................................................... 5
Aperçu du changement climatique prévisible jusqu’en 2050 ...................................................................................... 8
Changements dans les tempêtes: intensité et répartition spatiale en Suisse ............................................................. 11
Changements dans les chutes de grêle: intensité et répartition spatiale en Suisse ................................................... 12
Changements dus à la fonte du permafrost et au retrait glaciaire: processus et répartition spatiale ......................... 14
Stratégie de la Confédération ................................................................................................................................... 16
Résultats: discussion et analyse des hypothèses par les participants à l’atelier ....................................................... 17
2e atelier: Evolution future de la vulnérabilité des bâtiments aux dangers naturels ����������������������������������������� 21
Bases de discussion et sujets abordés par l’UIR ........................................................................................................ 21
Stratégie de la Confédération pour restreindre les dommages aux bâtiments ............................................................ 21
Protection des objets appliquée aux bâtiments ........................................................................................................... 22
Matériaux et modes de construction prévenant des dommages aux bâtiments .......................................................... 24
Diminution de la vulnérabilité des bâtiments à l’aide de normes ................................................................................. 25
Application dans la pratique par les communes et les cantons ................................................................................... 27
Résultats: discussion et évaluation des hypothèses par les participants à l’atelier ..................................................... 28
Scénarios d’évolution des différents facteurs influençant la vulnérabilité des bâtiments ............................................. 31
Conclusions �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
ANNEXE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Programme du 1er atelier du 17 septembre 2007 au Naturama d’Aarau ...................................................................... 33
Participants au 1er atelier ............................................................................................................................................ 35
Programme du 2e atelier du 25 septembre 2007 au Naturama d’Aarau ....................................................................... 34
Participants au 2e atelier ............................................................................................................................................. 35
Table des matières

4
Deux ateliers d’experts d’une journée intitulés «Répercussions du changement climatique sur le potentiel de dommages
futur» et «Evolution future de la vulnérabilité des bâtiments aux dangers naturels» ont été organisés dans le cadre d’une réé-
valuation du potentiel de dommages dus aux dangers naturels effectuée par l’Union intercantonale de réassurance (UIR). Ils
visaient à déceler des tendances dans les répercussions du climat prévu sur les dommages imputables aux dangers naturels
jusqu’en 2050 et dans l’influence des mesures de réduction des dommages sur la vulnérabilité des bâtiments durant ce laps
de temps. Quelque vingt-cinq experts – climatologues, ingénieurs, assureurs et autorités – ont participé à la discussion.
Le présent document, conçu comme un compte rendu d’ateliers, comprend les contributions aux discussions, les hypo-
thèses, les résumés et les conclusions relatives à ces deux journées de réflexion.
Peter W. Schneider, Directeur UIR
Avant-propos

5
1er atelier Répercussions du changement climatique
sur le potentiel de dommages futur
1er atelier Répercussions du changement climatique
sur le potentiel de dommages futur
Bases de discussion et sujets abordés
par l’UIR
Dr Stefan Heuberger, Union intercantonale de réassurance,
Berne
Introduction
L’Union intercantonale de réassurance (UIR) est le réassu-
reur des dix-neuf établissements cantonaux d’assurance de
Suisse (fig. 1). Seuls des bâtiments sont assurés, si bien que
les dommages évoqués sont toujours des dommages aux
bâtiments. On qualifie de «dommages éléments naturels»
ceux qui sont occasionnés par les phénomènes naturels
tempête, chute de grêle, inondation, glissement de terrain/
chute de pierres, pression de la neige et avalanche (fig. 2).
Contrairement aux dommages incendie, les dommages élé-
ments naturels ont crû au cours des vingt dernières années,
tant en moyenne qu’en variabilité (fig. 3).
Diverses méthodes – statistiques, probabilistes et basées
sur des scénarios – sont applicables pour évaluer le potentiel
de dommages. Elles exploitent toutes des données passées.
Des milliers d’années sujettes à événements, si ce n’est plus,
sont simulées dans le cas des méthodes probabilistes – qui
permettent notamment de déterminer la période de retour
des événements –, mais les paramètres introduits dans les
modèles sont des valeurs mesurées, donc tirées du passé.
L’UIR veut dorénavant compléter les analyses classiques du
potentiel de dommages par une « composante avenir ». Cela
implique de quantifier au mieux les deux facteurs influen-
çant les dommages que sont les événements naturels
et la vulnérabilité des bâtiments.
Evénements naturels et changement climatique
L’intérêt porte donc sur les événements naturels futurs (dans
la mesure où ils peuvent être appréhendés par les modèles
climatiques en Suisse). L’UIR accorde une grande impor-
tance aux trois «dangers principaux» que sont la tempête, la
grêle et l’inondation (dommages annuels indexés pour
1980–2006 en fig. 2 et 4). Les glissements de terrain/chutes
de pierres, la pression de la neige et les avalanches occa-
sionnent des dommages annuels dix fois inférieurs en
moyenne (fig. 2 et 4 f–h). Géographiquement parlant, le risque
devant être assuré par l’UIR correspond aux dix-neuf can-
tons suisses mis en évidence dans la figure 1. Une estima-
tion de l’ensemble du risque requiert donc des prévisions de
dommages aussi précises que possible pour les différents
cantons. Aussi faut-il également prendre en compte les pro-
cessus et changements à petite échelle (p. ex. «recrudes-
cence des chutes de grêle dans les Préalpes, mais diminu-
tion dans le Jura?» ou «augmentation du risque de glissement
de terrain/chute de pierres suite à la fonte du permafrost le
long de la crête principale des Alpes?»).
Il faut aussi considérer le fait que des petits dégâts en grand
nombre peuvent également aboutir à d’importants dom-
mages annuels. Or les événements de petite à moyenne
ampleur sont en nette augmentation. Les scénarios appli-
qués ne doivent donc pas se limiter aux événements impor-
tants ou extrêmes.
Figure 1: Les dix-neuf cantons (en rouge) possédant
un établissement cantonal d’assurance des bâtiments.
24%
8% 34%
34%
Tempêtes (77 mio. CHF)
Grêle (53 mio. CHF)
Inondations (76 Mio. CHF)
Glissements de terrain,
chutes de pierres
(5 mio. CHF)
Pression de la neige
(10 mio. CHF)
Avalanches (5 mio. CHF)
Total: 226 mio� CHF
Figure 2: Dommages annuels moyens recensés par les dix-neuf
établissements cantonaux d’assurance, classés par danger,
pour la période de 1980 à 2006. Les montants totaux ont été
indexés sur 2006 sur la base du capital d’assurance.
1400
1200
1000
800
600
400
200
080 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
Figure 3: Evolution des dommages dus aux éléments naturels
et au feu recensés par les dix-neuf établissements cantonaux
d’assurance. Les montants totaux ont été indexés sur 2006 sur
la base du capital d’assurance.
Montant total des dommages indexé (mio. CHF)
Dommages éléments naturels Dommages incendie
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%