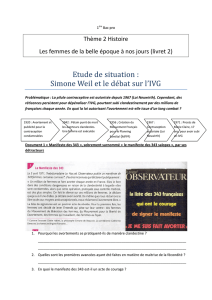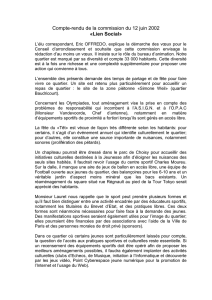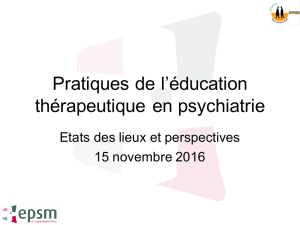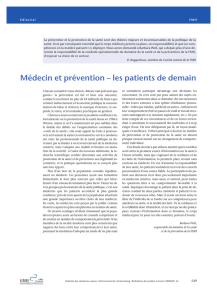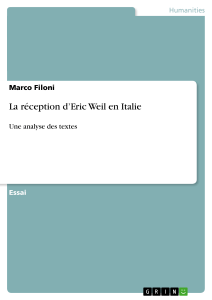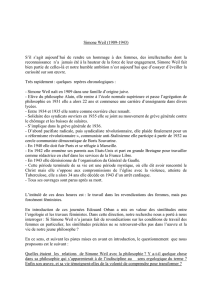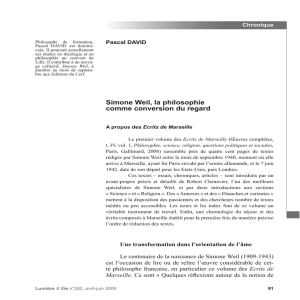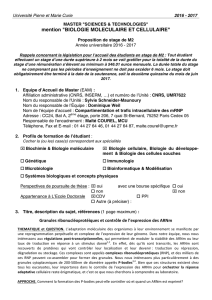Poulin_Marie-Eve_MEP_2010_memoire

Université de Montréal
Le sacrement du malheur chez Simone Weil
par
Marie-Ève Poulin
Département de littérature comparée
Faculté des arts et des sciences
Mémoire présenté à la Faculté des arts et des sciences
en vue de l’obtention du grade de Maîtrise ès arts (M.A.)
en littérature comparée
décembre 2010
© Marie-Ève Poulin, 2010

Université de Montréal
Faculté des arts et des sciences
Ce mémoire intitulé :
Le sacrement du malheur chez Simone Weil
Présenté par :
Marie-Ève Poulin
a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :
Éric Savoy, président-rapporteur
Terry Cochran, directeur de recherche
Agnès Conacher, membre du jury

i
Résumé
Pour Simone Weil, le malheur est « quelque chose de spécifique, irréductible à
toute autre chose, comme les sons, dont rien ne peut donner aucune idée à un
sourd-muet ». Il s’apparente à un sacrement, à un rite sacré susceptible de
rapprocher l’homme du divin. Et si la pensée weilienne se révèle non-conformiste
pour aborder la figure du malheur, c’est parce qu’elle ne se limite pas à une
tradition unique, mais trouve écho tant dans la religion chrétienne et le Nouveau
Testament que dans la philosophie grecque de l’antiquité – principalement le
stoïcisme et le platonisme – et dans certains textes orientaux tels que la Bhagavad-
Gîtâ et le Tao Te King. Par un singulier amalgame de ces influences, Weil donne
naissance à une méthode spirituelle dont une des étapes fondamentales est le
malheur, thème très fécond pour dénouer et affronter le dialogue entre spiritualité
et contemporanéité. Parce que cette méthode ne peut pleinement être appréhendée
que sur la frontière de l’athéisme et de la croyance religieuse, approfondir ses
implications permet d’interroger les traces du sacré dans les civilisations
occidentales. Retracer les étapes de son développement permet également de
sonder le rapport qu’entretiennent les hommes avec le malheur, ainsi que de porter
un regard sensible sur une époque où l’actualité fait souvent état des malheureux
alors que le malheur d’autrui semble être une réalité à fuir.
Mots-clés : Weil [Simone]; malheur; souffrance; nécessité; Bien [le]; attention;
spiritualité; ascèse; sacrifice; Dieu.

ii
Abstract
For Simone Weil, a calamity is “something specific that cannot be reduced to
anything else, just as sounds are inconceivable for a deaf-mute.“ It resembles a
sacrament, a sacred rite bringing man closer to the divine. Weil’s thinking with
regard to the notion of calamity appears nonconformist because it does not limit
itself to a single tradition, but finds echoes simultaneously in the Christian religion
and the New Testament, in ancient Greek philosophy - mainly Stoicism and
Platonism - and in certain eastern texts such as the Bhagavad-Gita and the Tao Te
King. By a strange combination of these influences, Weil gives birth to a spiritual
method of which one of the fundamental stages is “calamity”, a very fertile ground
for opening up and coming to terms with the dialogue between spirituality and
contemporaneousness. Because this method can be completely understood only at
the boundary between atheism and religious faith, examining its implications
allows for questioning the traces of the sacred in Western civilizations. Retracing
the stages of its development also allows for reflecting on the relationship between
man and calamity or catastrophy, permitting as well a measured consideration of
an epoch when current events often bring to the fore the calamitous fate of others
as a reality to be avoided at all costs.
Keywords : Weil [Simone]; calamity; suffering; necessity; Good [the]; attention;
spirituality; asceticism; sacrifice; God.

iii
Table des matières
Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Dédicace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Chapitre 1 : Ascèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mouvements de la pensée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Discipline des actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Chapitre 2 : Sacrifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Figure de l’amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Mystère de la Croix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-ii
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
1
/
103
100%