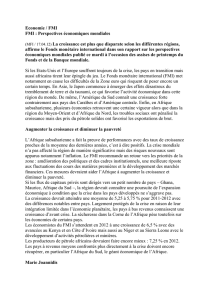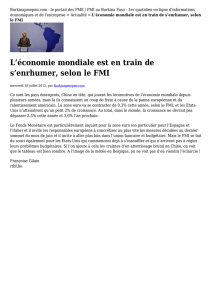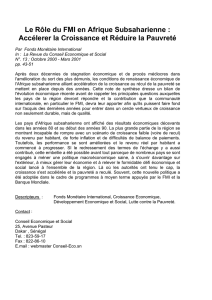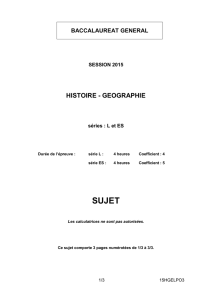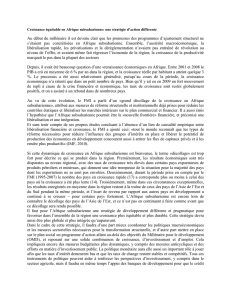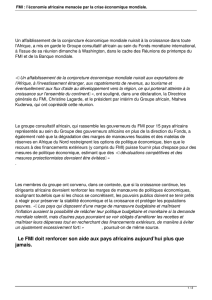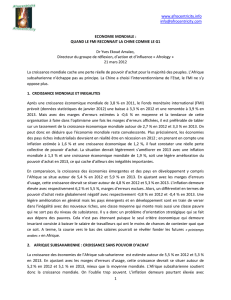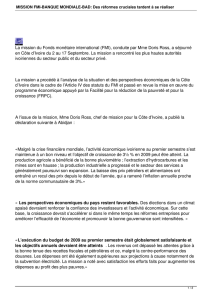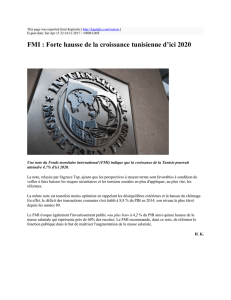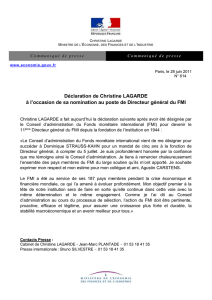Voir le document

Les remontrances de l’approche monétariste des interventions du FMI en Afrique
subsaharienne.
La question de savoir si le recours au crédit du FMI est un droit ou un privilège
semble ne pas été tranchée à Bretton Woods. Dès lors c’est l’expérience qui nous
permet d’établir un corps de doctrine et de procédure d’utilisation des ressources de
l’institution connu sous le nom de « conditionnalité ».
Concrètement les crédits conditionnels ne sont accordés qu’après l’amortissement de
négociations menées avec le pays demandeur sur les conditions d’un déséquilibre de
la balance des paiement. L’accord de tirage(accord de confirmation, accord élargi…)
prévoit explicativement un plan de redressement identifiée en terme de critère de
performance.
Les crédits sont utilisables par tranches débloquées après que le FMI, s’est assuré de
l’accomplissement du plan accepté par le pays bénéficiaire. Une suspension dans le
déblocage des crédits est donc possible si les critère de performances ne sont pas
atteints. Ce fut par exemple le cas en avril 1982 pour le sept pays africains accusés
de ne pas avoir pu ou voulu respecter les engagements qu’ils avaient souscrits.
De l’examen des divers programmes de stabilisation mis en œuvre par le FMI en
Afrique, il apparaît que si dans le détail chaque programme est particulier, de
nombreux éléments sont permanents. Cette uniformité permet d’isoler le système de
conditionnalité du FMI. Un paquet de mesures standardisées sert de base à la
politique de stabilisation imposée en contrepartie de la signature de l’accord :
• Le contrôle strict du déficit budgétaire par la réduction des dépenses publiques,
l’abolition des subventions aux produits de consommation, l’accroissement de la
pression fiscale et la hausse des tarifs des entreprises publiques.
• Le contrôle étroit de l’évolution de la masse monétaire par l’encadrement du
crédit bancaire et la hausse des taux d’intérêts.

• La compression de la masse salariale et l’ajustement des prix intérieurs sur les
coûts de production et de commercialisation réels (libéralisation des circuits
internes). On retrouve ici un ensemble de mesure de caractère anti-inflationniste
centrées sur la régulation de la demande finale.
Dans les pays qui n’appartiennent pas à la zone franc CEFA, deux mesurer
complémentaires viennent en règle compléter le dispositif :
• La libération du contrôle des changes ;
• L’ajustement du taux de change (dévaluation).
Nous avons remarqué que ces deux dernières mesures sont cohérentes avec le
statuts du fonds (notamment l’article VIII) qui font obligation aux Etats membres de
supprimer toutes les restrictions sur les paiements courants, les arrangements
monétaire discriminatoires ou les politiques de maintien de parités artificielles. En
revanche, aucun texte ne fournit à notre avis une base claire. L’expérience explicite
du fonds dans les politiques économiques intérieures des Etats membres.
Formellement, il ne doit connaître que les taux des régimes de change, mais parce
qu’il estime que la stabilisation monétaire est condition d’un rééquilibre de la balance
des paiements, l’entend aussi montrer sur la structure des dépenses publiques, le
soubassement analytique des inventions du FMI est l’approche monétaire de la
balance de paiements.
Le diagnostic type s’organise autour de la séquence suivante :
Excès structurel
de la demande
sur l’offre
intérieure
Politique laxiste
de crédit :
Déficit
budgétaire
Hausse de la
masse salariale.
Création
monétaire
excessive
Inflation
Déficit de
balance des
paiements
Endettement ou
dévaluation

Depuis un certain moment, sous la pression de certains pays en développement, le
FMI a été contraint d’infléchir légèrement sa doctrine et est passé d’ajustement
structurel à la facilité réduction de la pauvreté. Malgré ce changement de concept qui
visait à améliorer les conditions sociales des populations, on constate
malheureusement que rien n’a changé malgré cette nouvelle génération de
programme d’ajustement.
Pour éviter que l’effort d’ajustement de dépenses publiques n’ait qu’un effet
déflationniste, il a décidé de soutenir les programmes de pays qui s’efforceraient
d’améliorer l’offre de ressources et d’élargir la base de production de leurs
économies. Certains accords de confirmations prévoient désormais des mesures
sectorielles de nature structurelle. Mais c’est surtout par une collaboration avec la
Banque Mondiale que le FMI tente d’intervenir sur les structures de production :
La réussite d’un accord FMI est devenu un préalable de lait à l’accord de prêt
d’ajustement structurel de la banque. De plus en plus la conditionnalité propre à
chaque des deux institutions tend à se surajuster pour donner toute sa force à une
politique d’assainissement conforme à l’orthodoxie néo-libérale. La triptyque
austérité/privatisation/unité des prix sert toujours de fondement à cette politique.
De ce qui précèdent il saute, aux yeux que la critique de l’approche monétariste qui
sous-entend le diagnostic des experts du FMI comme leurs recettes de politique
économique peut se situer sur deux niveaux cohérents dans le cadre des hypothèses
de la théorie néo-classique (théorie quantitative de la monnaie, théorie de la parité
des pouvoirs d’achat, théorie des coûts comparatifs). Les mesures libérales se
structures économiques africaines. L’efficacité des mesures de redressements
inspirées par le modèle de référence est donc faible. Mais ces mesures finissent par
agir en profondeur sur ces structures en ajustant l’économie intérieure sur les
évolutions du marché mondial ; ce faisant elles contribuent à mettre en cause les
capacités nationales de maîtrise de développement. Portons de la critique interne et
analysons le redressement financier qui s’impose incontestablement dans dans la

plupart de pays africains. Pour éviter les phénomènes de fuite en avant d’une
économie de crédit généralisé.
Pour établir uns structure de prix relatif plus conforme à une affectation production
de ressources financières. Pour résorber le défit de l’Etat et interrompre la chaîne
sans fins des impayés. La rigueur de la gestion publique est devenue très importante
et elle passe par de profondes transformations au niveau de la politique budgétaire
et monétaire de l’Etat. L’équilibre à court terme a trop longtemps été sacrifié sur
l’autel des politiques volontaristes de développement. Mais force est d’admettre que
si « mauvaises » politiques monétaires, budgétaires et de taux de change peuvent
sérieusement handicaper le développement, de « bonnes » politiques de régulation à
court terme ne sont pas en elles-mêmes une condition suffisante pour garantir une
croissance durable de la production.
Les ajustements par les prix sont peu efficace à court terme. Si sur une longue
période, la production agricole commercialisée est élastique par rapport aux prix
producteur tel n’est pas le cas à court – moyen terme du fait des rigidités foncières
(disponibilités des terres), humaines (force de travail agricole disponible), techniques
et financières (fournitures d’intrant, crédit de campagne), commerciales (enlèvement
et distribution des produits, existence de marchés parallèles)…..par ailleurs, toute
répercussion d’une hausse des prix agricoles sur les prix consommateurs qui se
combine avec la stagnation des salaires aggrave la situation de rationnement en ville
et joue négativement sur le taux de productivité du travail salarié ou quasi-salarié. La
déflation associée en particulier à la limitation des dépenses d’investissement de
l’Etat a un impact dépressif sur l’offre nationale et accroît les déséquilibres financiers,
en particulier pour les unités publiques ou parapubliques qui travaillent pour le
marché intérieur. La dévaluation du taux de change ne peut avoir un effet décisif sur
le rétablissement de la balance commerciale. Ceci tient au caractère rigide à court –
moyen terme de la majorité des importations (biens alimentaires de base, pièces
détachées, équipement industriel, intrants agricoles, pétrole). Ceci tient également à
l’inélasticité de l’offre des exportations primaires qui sont cédées sur des marchés où
le prix est en règle générale une donnée exogène pour les producteurs africains.

En fait, la dévaluation a un effet inflationniste et exerce sournoisement une
réallocation des ressources internes au profit des non producteurs : propriétaires
fonciers, intermédiaires commerciaux, détenteurs de devises.
Dans la mesure où la crise financière des pays africains est de caractère structurel,
les mesures d’austérité risquent d’aggraver le dérèglement des activités et
contrecoup amplifier les déséquilibres internes et externes.
L’objectif principal du FMI est, par le rétablissement des déséquilibres des Etats, pour
rassurer la communauté financière internationale. Or, du strict point de vue de la
rationalité interne, la politique économique et financière préconisée par le FMI n’est
pas cohérente et risque d’aggraver que le moyen terme l’insolvabilité des Etats.
L’objectif de rétablissement à court terme des équilibres financiers implique que le
déficit annuel de la balance des paiements soit financé, le FMI faisant d’ailleurs di
financement du déficit un préalable à toute intervention de sa part. Deux possibilités
complémentaires s’offrent alors pour assurer le biais d’un rééchelonnement et le
financement du « gap » par appel aux bailleurs de fonds internationaux. Les bailleurs
de fonds internationaux peuvent suppléer dans le cadre d’un rééchelonnement, un
pays à reporter, l’ensemble de ses échéances (principal et intérêts pour une période
donnée, et ce, aussi bien pour la dette publique (club de Paris) que la dette bancaire
(club de Londres). Une période de différé est accordé pour le remboursement du
principal. La gai en trésorerie à court terme est alors évident. Cependant, le
problème de l’ampleur de la charge de la dette n’est pas réglé pour autant, il est
simplement du court terme sur le moyen terme, sous une forme aggravée. Tout
rééchelonnement a, en effet, u coût sous la forme d’une majoration des taux
d’intérêts initiaux. Les échéances futures sont ainsi élevées, et la situation financières
à moyen terme, lorsque le remboursement au titre du principal intervient dès la fin
de la période en différé, devient rapidement critique.
Les bailleurs de fonds internationaux peuvent, dans le cadre d’un groupe
« consultatif », consentir des prêts pour couvrir la gap restant, bien que ces prêts
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
1
/
37
100%