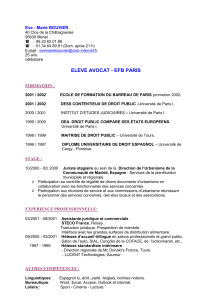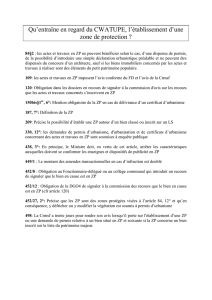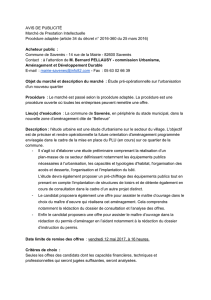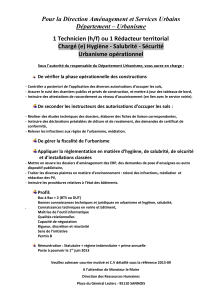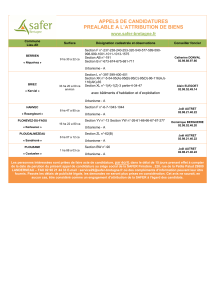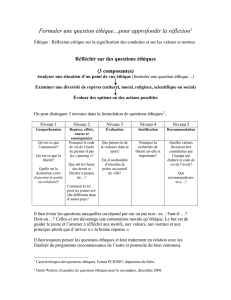Penser la transition éthique de l`urbanisme pour l`aménagement de

1
Penser la transition éthique de l’urbanisme pour l’aménagement de villes durables
Le cas de la France et de la Suisse
Rémi Baudouï
Université de Genève
Résumé
Les transformations de l’État providence en État animateur ont conduit la puissance publique à
limiter ses capacités d’action dans le domaine de la gestion sociale de la ville par l’urbanisme. Les
ambitions éthiques au cœur de la constitution des théories et savoirs de l’aménagement des villes
au début du XX
e
siècle, ont cédé le pas à un « oubli » éthique que porte une vision néolibérale de
l’évolution des sociétés. A partir de l’étude des cas français et suisse, cet article a pour objet
d’étudier les conditions de mise en œuvre de la transition éthique de l’aménagement durable des
villes.
Dans l’Europe de la Révolution industrielle, la constitution des États-nations s’est
déterminée sur l’émergence, entre domaine public et domaine privé, d’un nouveau
champ « social » dont l’enjeu fut d’intégrer « l’économie familiale et les activités
ménagères dans le domaine public » afin de faire société (Arendt, (1961 : 85). Les défis
auxquels les villes ont été confrontées au XIXe siècle ont porté sur les questions
d’hygiène, d’accès à l’emploi salarié, à la sécurité au travail, l’accès au logement digne, à
la santé publique et à l’éducation. La création des lois sur la gratuité des soins médicaux,
la pension vieillesse et l’assurance accident du travail prises par Guillaume Ier dans
l’Empire allemand entre 1883 et 1889, le développement des prérogatives municipales
dans le champ de l’hygiène et l’instruction publique en Grande-Bretagne, l’émergence
d’un social municipalisme en Autriche, en Allemagne puis en France contribuent à faire
de l’urbanisme le champ disciplinaire de l’aménagement des villes. Les notions de
solidarité et d’égalité des chances fondent dès la fin du XIXe siècle le discours réformiste
urbain.
Bien que depuis une vingtaine d’années la recherche francophone puise dans le débat
anglo-saxon de la gouvernance les conditions d’un renouvellement des manières de faire
la ville (Le Galès, 1993), les questions éthiques dans l’urbanisme demeurent absentes.
En France, dans le système de la démocratie représentative, la participation des
habitants aux débats publics, est présentée comme recelant les principes éthiques
nécessaires aux mutations du cadre bâti (Donzelot et Epstein,2006). Préalable à toute
décision publique, la participation citoyenne est définie comme une pratique éthique du
compromis intégrant les intérêts particuliers dans un tout collectif (Talbot, 2006). En
Suisse, il est admis que dans le système décentralisé de la liberté communale et de la

2
démocratie directe, les citoyens suisses développeraient des principes éthiques qui
assurent la sécurité collective. Vivant dans un territoire politique de liberté, dans la
conscience de soi et de l’autre, ils auraient ainsi acquis un esprit civique accompli
(Gasser, 1976).
Au-delà des différences entre démocratie représentative et démocratie directe, cet
article vise à réinterroger la place actuelle de l’éthique dans l’urbanisme. Peut-on parler
« d’oubli éthique » ? Dans quelle mesure la théorie du bien commun, relayée par
l’urbanisme, ouvre-t-elle les voies à une meilleure intégration des enjeux du
développement durable en matière d’équité et solidarité sociales ? Cette réflexion sera
conduite à partir des conceptions arendtiennes du bien commun, du domaine public et
de la justice et du «principe responsabilité» déployé par Hans Jonas (1979). Dans un
premier temps, il s’agira de s’interroger sur les fondements éthiques de l’urbanisme lors
de sa constitution comme savoir et discipline et les conditions de sa disparition à partir
des Trente Glorieuses. Dans un deuxième temps, il s’agira de s’interroger sur les
conditions de restauration aujourd’hui d’une éthique renouvelée conforme aux
exigences du développement durable des villes.
.Les fondements éthiques de l’urbanisme
Renvoyant explicitement au concept d’urbanité au sens classique de capacité à vivre
ensemble, le mot urbanisme apparu en 1910 semble approprié pour faciliter dans une
logique réformiste « la paix sociale ». L’abandon des conflits entre groupes et classes
sociales est conçu à partir de la construction d’un espace public de dialogue. Par ses
ambitions de solidarité entre riches et pauvres, il promeut l’intérêt général au rang de
philosophie politique. Son émergence laborieuse, tant en France qu’en Suisse, s’explique
par la résistance des élites bourgeoises qui se sont opposées à la constitution d’un droit
d’expropriation mettant selon elles en péril l’inaliénabilité de la propriété privée.
Les ambitions éthiques de l’urbanisme furent au cœur des réflexions sur le
réaménagement des villes: « L’urbanisme peut et doit contribuer au progrès moral et
social » (Risler, 1916 : 271). En France, l’enjeu fut de faire de l’urbanisme une technique
à part entière de la gestion du social (Baudouï et Cohen, 1995). En Suisse, les communes
s’engagèrent dans l’aménagement de leur territoire en prenant en considération les
enjeux des nouvelles zones à bâtir, la protection des sites, des paysages et des zones
agricoles, le développement de réseaux urbains et de transports.
Le système politique français de la démocratie représentative et celui suisse de la
démocratie directe portent deux conceptions éthiques différentes. Le premier postule
que le positionnement individuel ne peut pleinement s’accomplir que par le relais d’une
institution qui intériorise les règles instituées et acceptées par chaque citoyen. À
l’inverse, la Suisse revendique une éthique de soi
1
, trouvant dans l’interaction avec
autrui les conditions d’une gouvernance démocratique et participative garante du bien
public. Le processus référendaire, institué comme droit civique, offre tant aux citoyens,
tant au niveau communal, cantonal que fédéral les moyens de soumettre à la votation
populaire un texte pouvant contester tout projet de loi.
1
Au sens d’Emmanuel Lévinas, soit une éthique qui engage la responsabilité de chacun
par impossibilité de se dérober à sa propre responsabilité face au regard d’autrui.

3
En France, les polémiques sur la reconstruction post 1914-1918 et sur l’échec de la
planification de la région parisienne de 1934-1939 ont exacerbé le débat politique de la
IIIe République entre partisans de la centralisation administrative et libéraux favorables
à la limitation stricte des missions publiques. Dès 1940, le régime de Vichy dépossède
les communes de leur pouvoir d’urbanisme et le confie à une Délégation Générale à
l’Equipement National (DGEN), ancêtre du ministère de la Reconstruction et de
l’Urbanisme (MRU) créé en octobre 1944 et rebaptisé en 1966 ministère de
l’Equipement. En Suisse, les logiques décentralisées en matière d’urbanisme sont
encouragées. Autour des années 1940, les cantons s’octroient les instruments de
l’aménagement du territoire. Ce n’est qu’en 1969 qu’un nouvel article constitutionnel
(article 22quater) donne à la Confédération les moyens «d’édicter par la voie législative
des principes applicables aux plans d’aménagement que les cantons seront appelés à
établir en vue d’assurer une utilisation judicieuse et rationnelle du territoire». Si la
Confédération et les cantons peuvent, par voie législative et au nom de l’intérêt public,
engager l’expropriation privée, une autre disposition constitutionnelle adoptée le même
jour (article 22ter) garantit dans la Constitution fédérale la propriété privée. «Ces deux
dispositions constitutionnelles doivent dès lors être considérées comme de même rang
et se comprendre l’une par rapport à l’autre», la constitutionnalité de la propriété privée
limitant l’intervention de la puissance fédérale dans l’aménagement du territoire
(Donzel et Flückiger, 1999 : 571 sqq).
Deux conceptions éthiques opposent les systèmes politiques français et suisse. Dans le
premier cas, l’urbanisme renvoie à une éthique de type institutionnel, garante de
l’intérêt général. Elle s’appuie sur une éthique de la responsabilité de l’agent
administratif
2
. Dans la démocratie directe suisse, les valeurs éthiques de l’urbanisme
sont portées par les individus perçus d’abord comme citoyens éclairés dont les choix
sont responsables. Cette éthique individuelle se réfère au Contrat social rousseauiste et
trouve son accomplissement dans l’acte politique démocratique. Selon cette conception,
la volonté générale, pour être libre et non faussée, ne pourrait conduire à l’erreur. En
tant qu’entité, le peuple ne pourrait pas se tromper dans ses choix démocratiques.
. Les limites de la raison éthique dans l’urbanisme
La croissance économique, l’élévation continue du niveau de vie, la constitution d’une
classe moyenne tant en France qu’en Suisse, ont été les moteurs d’un « urbanisme de la
croissance », durant les Trente Glorieuses, (1945-1973) prompt à résoudre les défis de
développement des villes. En France, la création en 1955 des zones à urbaniser en
priorité (ZUP) a répondu aux besoins de logements décents liés à l’exode rural vers les
centres urbains. La Loi d’orientation foncière de 1967 engage a posteriori l’idée de
service public d’urbanisme en facilitant un droit d’expropriation pour cause d’utilité
publique. Le renforcement de l’autorité jacobine de l’État au détriment des collectivités
territoriales fait cependant l’impasse sur la démocratie participative. Au plan national, le
réaménagement des villes satisfait aux conditions d’une éthique institutionnelle de
l’intérêt général défendue par les élites technico-administratives des grands corps de
l’État (Kessler, 1986). Avec un taux de croissance économique annuel moyen de 5,05%
2
Au sens de Max Weber, soit une éthique qui engage la responsabilité du détenteur légal
d’une autorité qui obéit pour sa part à l’ « ordre impersonnel » de l’État de droit.

4
dans les années 1960, la France connaît une modernisation économique et sociale
rapide : fin des bidonvilles et des logements insalubres, éradication de la tuberculose,
baisse de la mortalité, allongement de la durée de vie, accès pour tous à l’emploi et
réduction des inégalités. Durant la même période, la Suisse, avec un taux de croissance
économique annuel moyen de 5,27%, s’est prévalue des mêmes résultats. Face à
l’explosion démographique, les cantons urbains se sont engagés dans la construction de
grands ensembles d’habitation. Toutefois les ambitions technocratiques de planification
des urbanistes et décideurs ont été freinées par les associations de quartier et les
votations populaires qui revendiquent la protection d’un art de vivre et le maintien
d’une urbanité classique. Les outils procéduraux de la démocratie participative ont bien
fonctionné.
La crise économique mondiale des années 1970 marque une rupture majeure dans la
croissance des villes européennes. En France, si les centres d’échanges internationaux,
les cités d’affaires relèvent de la dynamique de la ville, il se constitue dans un même
temps des espaces de déqualification économique et culturelle marqués par la relégation
sociale. Au début des années 1990, les collectivités territoriales peinent à la fois à être
des moteurs de la compétition économique et à maintenir la cohésion sociale. Le
territoire urbain glisserait selon Touraine de la « société de discrimination vers la
société de ségrégation » (1991).
Les populations immigrées se retrouvent prisonnières des grands ensembles de
logements que leur ont légués les populations ouvrières françaises ayant accédé à la
propriété privée. Au fil des décennies, les périphéries cumulent les handicaps : chômage,
échec scolaire, marginalisation sociale, incivilité et violences. Le sentiment d’abandon
ressenti (Kokoreff, 2008) engage le déploiement de formes de replis communautaires.
Peu à même de porter un projet de société juste sous la tutelle de l’État jacobin,
« l’urbanisme de la croissance » de la France s’amoindrit dans le tournant néolibéral. La
logique managériale du partenariat public/privé ouvre les conditions financières d’un
développement urbain qui se veut rentable. La fin de l’État providence ouvre les voies à
la crise du modèle républicain (Baudouï, 1992). L’exclusion sociale par l’économique
affecte les banlieues.
Avec les lois de la décentralisation de 1982, l’urbanisme redevenu une compétence
politique municipale ouvre les voies à une «démocratie de guichet » d’attribution
clientéliste des marchés de bâtiments et travaux publics et subventions. Elle fausse le jeu
de la concertation démocratique (Donzelot et Estèbe, 1994) et fonde une « République
féodale » par le gouvernement des élites sans consultation démocratique réelle
(Coudert, 1991). Les décisions locales en matière d’urbanisme, pour être contraintes par
des coalitions d’intérêts ou des coalitions de causes d’acteurs spécifiques (advocacy
coalitions), modifient en cours de processus les objectifs initiaux. Elles fragilisent le
maintien de l’intérêt général. Quant à la « participation citoyenne » vantée par les élus,
elle se résume le plus souvent à une consultation préalable des habitants qui ne peut
remettre en cause le processus engagé.
Les prises illégales d’intérêts telles la corruption et le financement illégal des acteurs
et groupements politiques dans le domaine de l’urbanisme sont plus nombreuses. Par
exemple, à dessein de protéger son patrimoine familial, un ancien conseiller technique
du ministre des Finances est mis en examen pour détournement du tracé de la ligne à
grande vitesse Bordeaux-Espagne. La mutation de l’État providence en État animateur

5
dans le traitement des banlieues conduit la puissance publique à gérer ad minima les
interfaces entre acteurs privés et acteurs publics. Trente deux ans après les émeutes des
Minguettes, la politique de la Ville n’a pas atteint les buts fixés (Donzelot et Estèbe,
1994). La mise en place de dispositifs de correction sociale, ayant pour mission d’inciter
les communes les plus riches à se doter de logements sociaux pour atteindre une mixité
sociale souhaitée (loi d’orientation pour la Ville de 1991 ; loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbain de 2000) se heurte à la mauvaise volonté des acteurs politiques
concernés et à l’opposition des résidents les plus fortunés.
Société multiculturelle, la Suisse doit son succès au rôle historique moteur de ses villes
dans ses capacités à absorber la main d’œuvre étrangère dans le triple registre de l’accès
à un emploi, à l’éducation et à la citoyenneté. En Suisse, plus de deux millions de
personnes ont des origines ou de la descendance étrangère. Aujourd’hui, un habitant sur
cinq est étranger. Un quart de la main d’œuvre en Suisse est étrangère. Dans un monde
globalisé, les causes de migration ont changé de nature. Au-delà de leur structuration
selon des logiques d’emploi et de rationalité d’offres, elles portent à la fois sur les
questions de refugiés de guerre et de persécutés politiques ou encore de migrations
économiques clandestines. La variable importante en termes de différenciation spatiale
est celle de l’appartenance culturelle. L’accès sélectif des arrivants selon leurs revenus et
la nature des emplois accessibles engage des processus divergents de localisation
spatiale qui recèlent des diversités de situations peu comparables les unes aux autres.
La forte périurbanisation définit un processus de développement exogène au reste de
la ville comme en témoigne l’émergence accélérée durant ces décennies de l’insertion
spatiale des nouveaux migrants internationaux selon un double processus de sélection :
richesse et appartenance culturelle. Les villes suisses rassemblent les individus par
groupes et communautés, selon des « affinités électives » choisies ou subies. Ces
analyses sur la situation des étrangers en Suisse urbaine et les conditions de leur
ségrégation spatiale ne sont pas à dissocier d’autres mouvements structurels qui
affectent les villes depuis une vingtaine d’années. Au premier chef figurent une
fragmentation sociale accrue, une cohésion sociale affaiblie, la montée en puissance de
l’individualisme, l’émergence de la « nouvelle pauvreté » et la dilution du lien social (Da
Cunha, Leresche et Vez, 1998). En second, le mouvement hétérogène de la gentrification
des villes suisses se caractérise à la fois par la reconquête des centres-villes – de Zurich,
Genève, Bâle et Lausanne – par des classes supérieures, objets de promotion
immobilière privée (Rérat, 2008).
Un double processus de ghettoïsation est à l’œuvre. Le « ghetto subi » qui conjugue la
pauvreté et précarité sociale définit un clivage spatial sur la base d’une ethnicisation-
relégation dans certains quartiers et communes. Le « ghetto choisi » (Pinçon-Charlot,
2007) de la construction volontaire de l’entre-soi
3
engage la construction de
lotissements sécurisés pour les populations aisées, dérivés directement des gated
communities américaines. Avec la ségrégation sociale des villes suisses font jour des
tensions importantes entre populations que traduit la montée de l’intolérance, de la
3
L’entre-soi définit le processus d’individualisation renforcée conduisant les habitants
à se domicilier et échanger au quotidien en fonction des critères d’appartenance au
même groupe social en termes de richesses et de valeurs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%