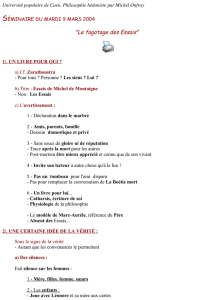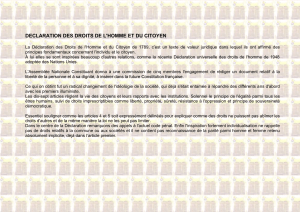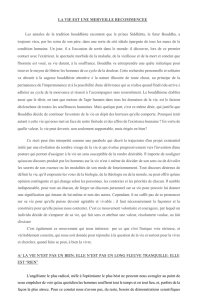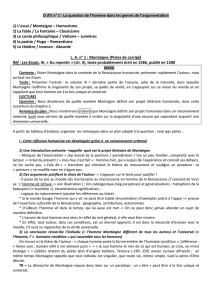Quelle est la fin de l`instruction ?

Quelle est la fin de l'instruction ?
Lire un extrait du livre Le roman du monde, Flammarion, 2001, pp. 360-363
« À un enfant de maison qui recherche les lettres, non pour le gain, ni tant pour les
commodités externes que pour les siennes propres, et pour s'en enrichir et parer
au-dedans, ayant plutôt envie d'en tirer un habile homme qu'un homme savant, je
voudrais aussi qu'on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête
bien faite que bien pleine, et qu'on y requît tous les deux, mais plus les mœurs et
l'entendement que la science; et qu'il se conduisît en sa charge d'une nouvelle
manière. » Montaigne, Essais, l, XXVI.
Quelle est la fin de l'instruction? Former un homme capable de penser et d'agir
par lui-même. Il lui faudra pour cela disposer des références que fournit la
culture. Mais seule la puissance du jugement éclairé peut donner sens et réalité à
ce projet.
Un tel homme sera en mesure de se conduire, c'est-à-dire d'être l'auteur de ses
actions comme de ses pensées. En ce sens, l'instruction est le fondement décisif
d'une éducation qui se propose de former des hommes libres. C'est dire que
l'autonomie rationnelle de la personne va de pair avec sa lucidité morale, et que
l'érudition ne saurait y suffire. Le maître qui émancipe le jugement de l'élève ne
peut être confondu avec le maître qui domine. Le latin dirait que le magister se
distingue du dominus : celui qui m'instruit pour que je puisse un jour me passer de
maître n'a rien à voir avec celui qui entend exercer sur moi un pouvoir de
domination. Le premier permet de résister au second, et c'est en ce sens que l'on a
pu parler d'école libératrice.
L'« institution des enfants », dont parle Montaigne, requiert donc des maîtres
savants, certes, mais qui ne confondent pas la connaissance avec l'érudition. La
véritable instruction suppose la présence à soi de la conscience dans la
connaissance. Comprendre, ce n'est pas seulement se souvenir, et l'on peut «
apprendre par coeur » sans avoir l'intelligence réelle de chose ainsi «apprise».
Quant aux savoirs, ils ne peuvent s'accumuler sans ordre à la façon d'objets inertes
transmis rangés. Il ne s'agit donc pas de s'en remplir comme on remplirait un vase,
mais de s'en nourrir intérieurement, pour façonner cette puissance de jugement qui
fonde réellement la lucidité.
La « tête bien faite» ne suppose pas une tête vide, mais un type d'existence du
savoir qui en fasse la sève de la lucidité. Montaigne précise que la « tête bien
pleine » n'est pas en fait réellement opposable à la « tête bien faite » si elle se
caractérise par la richesse d'une culture maîtrisée, bien différente d'une érudition
par simple empilement. Tout dépend de la façon dont les connaissances s'y
agencent en une « tête bien faite ». Les deux exigences ne sont pas incompatibles
dès lors que le souci prioritaire est de mettre en perspective l'acquisition des

connaissances et la sagesse qui en finalise la raison d'être.
Il ne s'agit en aucun cas de prétendre que le savoir comme tel n'a pas de valeur,
mais de s'en prendre à la valorisation de la seule mémoire cumulative. Rabelais
avait déjà tourné en dérision l'apprentissage fondé sur la mémoire mécanique,
comme celui qui consistait à faire apprendre à Gargantua une grammaire latine en
dix-huit ans et onze mois, avec le souci qu'il pût en fin de compte la réciter « par
coeur et à revers ». Mais comme Rabelais également, Montaigne critiquait
l'ignorance parée de sophistique qui prétendrait opposer la tête bien faite à la tête
bien pleine.
Le «conducteur» sera d'autant mieux en mesure d'instruire pour émanciper qu'il
aura lui-même cultivé un rapport vivant au savoir, et pour cela se sera davantage
efforcé d'être apte à bien penser. L'entendement ne s'oppose à la science que si
celle-ci se fige dans la simple mémorisation de savoirs tout faits, sans
compréhension active de ce qui les fonde, ni appréhension de leur sens dans la
recherche du vrai et du bien. « Science sans conscience n'est que ruine de
l'âme.»
Ici se joue le sens de l'idéal encyclopédique, trop souvent confondu avec
l'empilement sans principe de connaissances diverses. L'encyclopédie, selon
l'étymologie, c'est l'éducation embrassant l'ensemble des connaissances dans un
cercle raisonné, c'est-à-dire au sein d'un ordre qui permette de saisir le sens et la
portée de chacune. Ainsi comprise, elle est aux antipodes de la caricature trop
usuelle qui sous le nom péjoratif d'« encyclopédisme » entend la disqualifier.
L'idéal encyclopédique est bien celui d'une unité organique des savoirs, visant le
savoir, en son sens émancipateur et critique. Chez Rabelais déjà, l'encyclopédie,
comme ensemble complet de connaissances, permet une reconnaissance de la
place, du statut, de chaque savoir. La systématisation circulaire (en grec,
enkuklos) s'accorde parfaitement avec l'idée d'un cycle entier de formation
(païdeia), dans la mesure où l'édifice des connaissances acquises par l'humanité
entière peut fournir la base de l'instruction de chaque homme, et soutenir ainsi le
processus éducatif en lui transmettant toute la richesse d'un héritage.
L'élève, le petit homme, se met à l'écoute de toute l'humanité, de la culture
universelle, pour s'élever lui-même à la plénitude de son être, à la pensée instruite
qui délivre des faux-semblants du vécu immédiat et participe à la
construction toujours difficile de la lucidité. Quant à la dimension critique et
libératrice de l'idéal encyclopédique, il faudra y revenir plus loin, mais il est déjà
possible de rappeler que l'encyclopédie des humanistes de la Renaissance s'oppose
aux totalisations dogmatiques et autoritaires des « Summae » médiévales, sommes
de savoirs sous finalité émancipatrice.
C'est le sens de l'institution des enfants, puis de l'institution scolaire, qui peut se
comprendre à partir de là. « L'École est le lieu où l'on va s'instruire de ce que l'on
ignore ou de ce que l'on sait mal pour pouvoir, le moment venu, se passer de
maître» (Jacques Muglioni, Philosophie, Ecole même combat, 1984). Une telle
définition peut valoir pour toute école, particulière ou générale. Mais dans le cas
d'une institution publique, soucieuse de soustraire l'instruction à la disparité des
situations de fortune et de pouvoir comme de culture familiale, elle prend un sens

d'une singulière portée.
L'instruction n'est pas simple acquisition de biens culturels, de connaissances
détenues sur le mode de l'avoir. Elle concerne l'être, qui s'accroît et se révèle tout à
la fois au fur et à mesure qu'il prend ainsi conscience de ses potentialités et qu'il
les accomplit. Spinoza le rappelle, dans un langage fort: la puissance de
comprendre, en se développant, accroît la puissance d'agir, qui à son tour
stimule et féconde la puissance de comprendre. Cette dialectique heureuse fait
advenir l'autonomie de jugement, ressort essentiel de la liberté. L'instituteur ou le
professeur n'a rien d'un dispensateur d'informations qui traiterait les connaissances
comme des objets morts, à « transmettre» comme on transporte un objet d'un lieu
à un autre.
Agissant pour que mûrisse, par la culture et les repères essentiels dont elle
s'assortit, le pouvoir de juger, il apprend effectivement à l'élève ce qui, un jour, lui
permettra de se passer de maître. La présupposition généreuse d'une telle
démarche est que tout homme détient la puissance de penser, et qu'il ne s'agit que
de l'éveiller à elle-même, de l'élever, comme dit si bien le mot élève.
Instruction et formation du jugement ne sont donc pas dissociables. L'enjeu, c'est
l'émancipation intellectuelle et tous les registres d'émancipation qu'elle rend
possibles: l'homme, le citoyen, le travailleur, peuvent alors assumer la liberté. Ils
s'accomplissent ensemble, et non de façon inversement proportionnelle. Former
l'homme, dans la plénitude de ce qu'il peut être, c'est donner au citoyen sa
référence la plus exigeante et son assise la plus sûre. Instruire le futur citoyen afin
que sa raison puisse juger librement et fonder l'autonomie, c'est donner au
travailleur une culture universelle qui le libère de sa place dans la division du
travail; c'est lui permettre également de ne pas s'enfermer dans
l'unidimensionnalité d'un métier.
L'école ouvre alors sur le légitime souci de soi, compris à l'échelle de toute
l'humanité. Une telle école ne se soucie pas seulement de ce que l'homme fera
dans son « travail » : elle veut rendre possible la richesse de son épanouissement,
et faire éprouver la diversité de ses registres. Un homme qui s'ennuie, captif des
données particulières de son existence, prisonnier d'une vision du monde induite
par la seule division du travail, c'est déjà un citoyen en déshérence - proie facile
pour les fanatismes d'exclusion ou les haines de compensation, ou tout simplement
l'idéologie douce des préjugés ordinaires. L'idéal de la tête bien faite, dont rêvait
Montaigne, n'a rien perdu de son actualité. »
Henri Pena-Ruiz,
Professeur de Philosophie en Première Supérieure au Lycée Fénelon,
Professeur de Philosophie à l’Institut d’Études Politiques de Paris
Le roman du monde, Flammarion, Paris 2002, p.360-363
1
/
3
100%
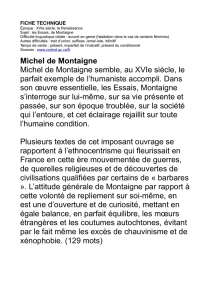


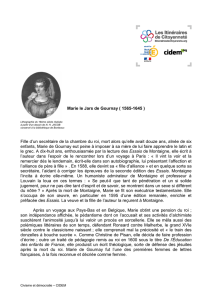

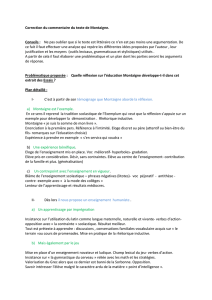
!["Les auteurs" [ / 33.06 Ko]](http://s1.studylibfr.com/store/data/002766794_1-066a78493fb2577980249b334dcf04ce-300x300.png)