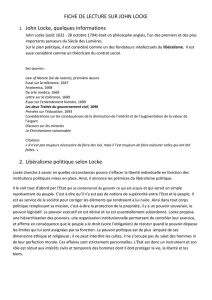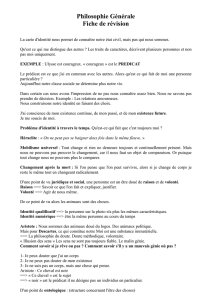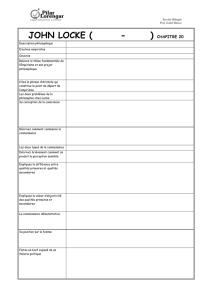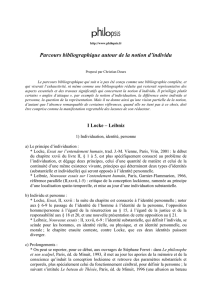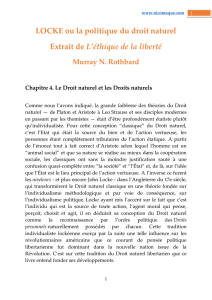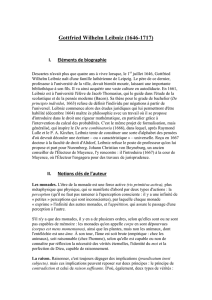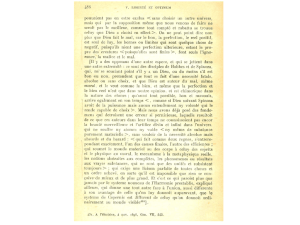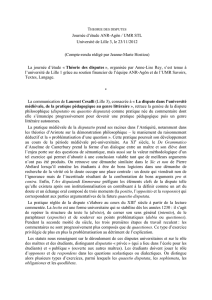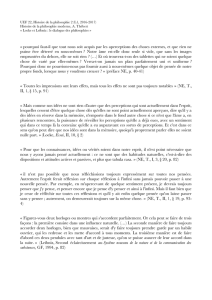Gábor Boros (Budapest): Philosophie mécanique et philosophie

Gábor Boros (Budapest):
Philosophie mécanique et philosophie morale dans les Nouveaux essais
En critiquant la classification des sciences dans le dernier chapître de l’
Essai de Locke Leibniz écrit que « chaque partie paroit engloutir le tout », qui
signifie entre autre que « tout pourroit entrer dans la Philosophie pratique
comme servant à nostre felicité. [...] De sorte que la doctrine de la felicité
humaine ou de nostre bien et mal absorbera toutes ces connoissances, lors qu’on
voudra expliquer suffisamment tous les moyens qui servent à la fin que la raison
se propose. » (522)
On peut bien lire ces phrases en tant qu’avertissement à l’interprête : il ne
faut pas négliger la lecture des Noveaux Essai qui centre sur la philosophie
morale comme un des enjeux principaux dans l’échange de Leibniz avec Locke.
Locke lui n’aurait pas disputé cette conséquence. Il n’a pas du tout celé que
même au cas où on expecterait de lui une argumentation purement théoretique –
comme dans les chapîtres contre l’innéité – était au moins un de ses enjeux
principaux la morale. Selon lui, les sujets d’un état monarchique qui étaient
considérés par des partizans du patriarchisme en analogie avec des fils dans une
famille, devaient-ils se traiter comme de citoyens égaux. Or la méthode la plus
prometteuse pour acquérir cette fin semblait Locke sans doute la purification
analytique voire réforme de l’entendement au sens d’élimination de notions ou
idées innées dans la reconstruction de la genèse de notre connaissance. Car un

2
des plus aptes moyens de supérieurs politiques et écclésiastiques de perpétuer
ses pouvoir était de faire croire les sujets que ses propres opinions étaient innées,
c’est-à-dire indiscutables. Il est intéressant d’observer que Leibniz, lui, a réduit
l’apologie lockéenne de l’égalité des points de vue individuels à la fin du
premier livre d’Essai à « un point » qui est « plustost de police que de
philosophie » : « Il est vray que pour eviter les scandales et les desordres, on
peut faire des reglemens à l’egard des disputes publiques et de quelques autres
conferences ; en vertu des quels il soit defendu de mettre en contestation
certaines verités establies : mais c’est plustost un point de police que de
philosophie. » (108)
Avant d’esquisser la réponse de Leibniz aux idées lockéennes concernant
la morale, il nous faut rassembler quelques thèses caractéristiques à la
philosophie morale de l’Essai même. Le débat avec des partisans de la théorie
de l’innéisme pratique, la théorie des modes mixtes, celle de différentes sortes
des lois et les « relations morales » : tels sont les piliers de cette philosophie,
auxquels on doit ajouter le hédonisme en tant qu’un caractère distinctif de la
théorie de Locke. Bien entendu, la question de l’éducation adéquate a également
une importance pivotale, sans laquelle les autres éléments mentionnés ne
seraient que de pures abstractions. Pourtant on doit se borner maintenant à ne
nous rapporter que quelques lignes de force principales.
Locke avait pour but de bannir le fantôme du relativisme moral qui
accompagnait la philosophie mécanique. Comment s’explique la possibilité de

3
cette espèce du relativisme et comment peut-on l’éviter à la base de la
reconstruction lockéenne de l’acte du jugement moral? La source principale de
l’ambiguïté dans la morale selon Locke est le concept du « mode mixte », c’est-
à-dire l’idée complexe composée des idées simples d’importance morale. Car,
semblables aux idées complexes de la géometrie , les modes mixtes n’ont aucun
modèle naturel hors de notre esprit : ils sont leurs archétypes même (2,31,3).
Donc même s’ils peuvent en principe être traités dans le cadre d’un système
aussi cohérent et sans contradiction interne qu’est la géometrie – « je ne doute
nullement, dit Locke, qu’on ne puisse déduire, de Propositions évidentes par
elles-mêmes, les véritables mesures du Juste & de l’Injuste par des
conséquences nécessaires, & aussi incontestable que celles qu’on emploie dans
les Mathématiques, »
1
– ils y émergent plusieurs difficultés qui empêchent la
construction d’une morale euclidienne. Car, bien qu’il soit vrai que « le sage
Auteur de notre Etre » nous procurait un système de l’adéquation mutuelle entre
les puissances des choses hors de nous et nos idées simples, les modes mixtes ne
sont formés de ces idées simples que par des hommes. De plus, c’est toujours au
1
„L’idée d’un Etre Suprême, infini en puissance, en bonté & en sagesse, qui nous a fait, & de qui nous
dépendons; & l’idée de Nous-mêmes comme de Créatures intelligentes & raisonnables, ces deux idées, dis-je,
étant une fois clairement dans notre esprit, ensorte que nous les considérassions comme il faut pour en déduire
les conséquences qui en découlent naturellement, nous fourniroient, ‚a mon avis, de tels fondemens de nos
Devoirs, & de telles régles de conduite, que nous pourrions par leur moyen élever la Morale au rang des Sciences
capables de démonstration. … je ne doute nullement qu’on ne puisse déduire, de Propositions évidentes par
elles-mêmes, les véritables mesures du Juste & de l’Injuste par des conséquences nécessaires, & aussi
incontestable que celles qu’on emploie dans les Mathématiques, si l’on veut s’appliquer à ces discussions de
Morale avec la même indifférence & avec autant d’attention qu’on s’attache à suivre des raisonnemens
Mathématiques.“ (4. 3. 18; p. 454) Si l’on prend les propositions „Il ne sauroit y avoir de l’injustice où il n’y a
point de propriété“ ou „Nul Gouvernement n’accorde une absolue liberté“, on peut être aussi certain de leur
vérité „que d’aucune qu’on trouve dans les Mathématiques.“ Donc, d’après Locke il peut y avoir un système de
la raison mathématique de la morale, une éthique définitive soi-disant, dont „le véritable fondement“ „ne peut
être autre chose que la volonté ou la Loi de Dieu, qui voyant toutes les actions des Hommes … tient, pour ansi
dire, entre ses mains les peines & les récompenses, & a assez de pouvoir pour faire venir à compte ceux qui
violent ses ordres avec le plus d’insolence.“ (1. 2. 6.; 27/8)

4
milieu d’une communauté de langue que nous les forment. C’est « dans le but
même du Langage » que les « diverses combinaisons d’idées simples en autant
de Modes distinctes » se trouvent expliquées. « Car les Hommes l’ayant institué
pour se faire connaître ou se communiquer leurs pensées les uns aux autres aussi
promptement, qu’ils peuvent, ils font d’ordinaire de ces sortes de collections
d’idées qu’ils convertissent en Modes complexes auxquels ils donnent certains
noms, selon qu’ils en ont besoin par rapport à leur manière de vivre & à leur
conversation ordinaire. »
2
Cette origine des modes mixtes a pour conséquence
qu’ils changent souvent non seulement d’un pays à l’autre mais aussi dans un
même pays d’une époque à un autre : « les Langues sont sujettes à de continuels
changemens. » Donc la relativité morale s’est enracinée déjà dans l’un des
fondements de l’évaluation morale. Mais il y a encore d’autres difficultés.
Prenons l’idée de l’infidélité ! Lors même que cette idée soit adéquate dans
l’entendement de celui qui a décidé le premier de convertir quelques idées
simples à cette même idée complexe qu’il a désignée par le mot « infidelité »,
les autres, qui apprendront ce mot en s’appropriant la vocabulaire de la langue
française, n’en auront-ils plus une idée adéquate : ils ne possèderont plus l’idée
première qui – par conséquence – servira pour eux quasiment d’un archétype.
En outre, la plupart des idées de modes mixtes sont très complexes : ils sont
extrêmement difficile à apprendre et à être utilisés proprement.
2
2,22,5

5
Cependant il ne sont pas seulement les modes mixtes qui affaiblissent
l’idée d’une morale démonstrative chez Locke. Car étant une fois formé et étant
désigné par de noms appropriés, les modes mixtes, elles, doivent être rapportés à
des lois appropriées pour mettre en lumière la valeur morale de l’action désignée
par l’idée et le nom. « [L]e Bien et le Mal considéré moralement, n’est autre
chose que la conformité ou l’opposition qui se trouve entre nos actions
volontaires & une certaine Loi. »
3
Mais les rapports entre les lois et les modes
mixtes qui doivent correspondre à eux ne s’éclaircie pas du tout d’une manière
évidente. Car tout d’abord, quelles sont ces lois ?
« Voici, ce me semble, les trois sortes de Loix auxquelles les Hommes
rapportent en général leurs action, pour juger de leur droiture ou de leur
obliquité : 1. la Loi Divine ; 2. la Loi Civile ; 3. la Loi d’opinion ou de
réputation, si j’ose l’appeler ainsi. Lorsque les Hommes rapportent leurs actions
à la première de ces Loix, ils jugent par-là si ce font des Péchés ou des Devoirs ;
en les rapportant à la seconde ils jugent si elles sont criminelles ou innocentes ;
& à la troisième, si ce sont des Vertus ou des Vices. »
4
La valeur morale d’une action relève donc d’un acte du jugement qui
rattache l’idée de l’action à l’idée d’une loi. Or, considéré d’un point de vue tout
formel les Loix, eux aussi, ne sont que des collections d’idées simples « que
nous recevons par Sensation ou par Réflexion » (2,28,14.). La connaissance de la
rectitude ou l’obliquité d’une action est donc simplement la connaissance de « la
3
2,28,5.
4
Coste, 280.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%