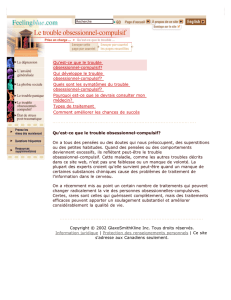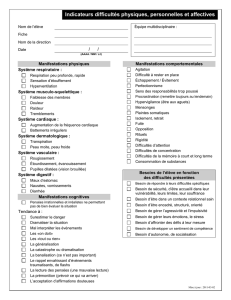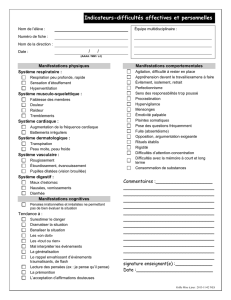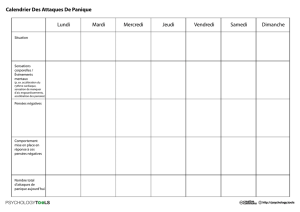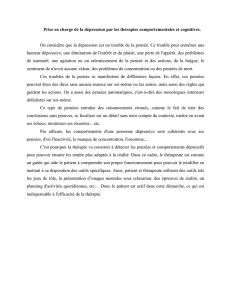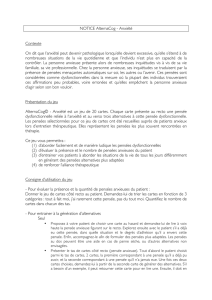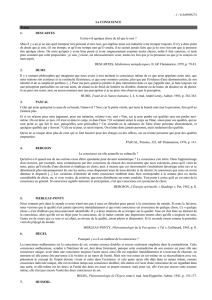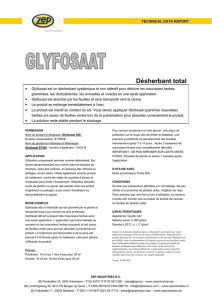UNE PENSÉE PEUT-ELLE ÊTRE MAUVAISE ?

IGITUR – ARGUMENTS PHILOSOPHIQUES. VOL. 1 N° 3, 1-17
ISSN 2105-0996
UNE PENSÉE PEUT-ELLE ÊTRE MAUVAISE ?
Martin Gibert
CRÉUM
Université de Montréal
RÉSUMÉ
Doit-on exclure certaines pensées de la délibération morale ? Pour répondre à cette
question de psychologie morale, je propose, à la suite d’un exemple de Bernard Williams,
de définir les mauvaises pensées comme des représentations mentales imaginées. On
peut qualifier ces pensées de mauvaises pour deux raisons : parce qu’elles témoigne-
raient du caractère vicieux d’un agent ou parce qu’elles auraient une influence négative
sur le jugement moral. Dans cet article, je soutiens d’une part que ces raisons sont
problématiques et d’autre part que, même si certaines pensées sont effectivement mau-
vaises, les normes délibératives qui prétendraient les bannir sont déraisonnables. En
effet, celles-ci sont souvent inapplicables et, surtout, beaucoup trop coûteuses pour la
délibération morale.
ABSTRACT
Should we exclude certain thoughts from moral deliberation ? In order to answer
this question in moral psychology I propose, following an example of Bernard Williams,
to characterize bad thoughts as imagined mental representations. Thoughts may be
regarded as bad for two distinct reasons : because they express an agent’s vicious
character or because they have a negative influence on moral judgment, respectively.
In this paper I make two separate claims. On the one hand I argue that these reasons
for thinking a thought may be bad are problematic themselves. On the other hand I also
claim that, even if thoughts are bad, deliberative norms that propose to ban them are
unreasonable, because such norms are typically impractical and too costly for moral
deliberation.
MOTS-CLÉS
Bernard Williams, Délibération morale, Imagination, Mauvaise pensée

Une pensée peut-elle être mauvaise ? M.GIBERT
1 INTRODUCTION
Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ce commandement bi-
blique peut s’interpréter comme proscrivant non seulement l’adultère
mais aussi l’idée même de le commettre 1. Il instaurerait par là une
catégorie morale spécifique : celle de mauvaise pensée. Car certaines pensées
semblent effectivement impures, pécheresses, néfastes. Si les pensées rela-
tives à la sexualité sont sans doute de bonnes candidates au titre de mau-
vaises pensées, il n’est pas interdit d’élargir le champ pour y inclure toute
pensée qui va à l’encontre d’une norme morale ou religieuse. Ainsi, un verset
du Coran fait dire à Allah : « Ô vous qui avez cru ! évitez de trop conjecturer
[sur autrui] car une partie des conjectures est péché. » (Sourate 49 ; Verset
12). De même, dans son roman 1984, George Orwell imagine une catégorie
spéciale de crimes, les crimes de la pensée – et une police spécialisée : la
police de la pensée. Mais que penser de ce genre d’interdits ?
Pour répondre à cette question, je m’appuierai sur une thèse que Bernard
Williams illustre dans l’exemple suivant :
Une façon d’écarter certaines actions, et souvent la meilleure, c’est de ne
jamais y penser. On se sent mal à l’aise avec l’homme qui déclare au cours
d’une discussion sur la façon de traiter ses concurrents en politique ou
en affaires : « Bien sûr, nous pourrions les faire tuer, mais nous devrions
écarter cette éventualité dès le départ. » Il n’aurait jamais dû avoir l’occa-
sion d’écarter cette éventualité. Il est caractéristique de la moralité qu’elle
tend à négliger la possibilité que certaines préoccupations sont le mieux
représentées dans ce silence délibératif (Williams, 1991, 200).
Williams a-t-il raison de soutenir que, lors d’une délibération 2, nous de-
vrions ne pas entretenir certaines pensées ? Telle est la question. Mais elle im-
plique en fait deux volets qu’il convient de distinguer. Premièrement, on peut
se demander s’il est légitime de qualifier certaines pensées de mauvaises :
j’envisagerai deux arguments militant en faveur de l’existence des mauvaises
pensées – mais j’essaierai d’en limiter la portée. Cela laisse néanmoins ou-
verte une seconde question : des normes proscrivant les mauvaises pensées
devraient-elles régir nos délibérations morales ? Or, à l’encontre de Williams
qui prône l’idée d’un « silence délibératif », je soutiendrai que de telles normes
doivent être rejetées. Mais avant tout, il importe de préciser à quel type de
contenus mentaux appartiennent les mauvaises pensées.
1. Le neuvième commandement existe aussi en version longue : « Tu ne convoiteras pas la
femme de ton prochain ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur ou sa servante, ni son bœuf
ou son âne : rien de ce qui est à lui ». Interprété comme proscrivant des mauvaises pensées, il
signifierait donc que, par exemple, l’idée même de voler l’âne de mon prochain est mauvaise.
2. Dans tout l’article j’entends par « délibération », la délibération morale individuelle – et non
pas la délibération collective.
IGITUR –ARGUMENTS PHILOSOPHIQUES 1

M.GIBERT Une pensée peut-elle être mauvaise ?
2 QU’EST -CE QU’UNE (MAUVAISE)PENSÉE ?
Dans le langage commun, les émotions négatives, les obsessions, les pen-
sées parasites, voire les (mauvais) rêves peuvent se voir qualifiés de mau-
vaises pensées. Et, en un certain sens, elles le sont bien. Mais il faut voir que
ces contenus mentaux échappent largement au contrôle de la volonté. Dans la
mesure où ils reposent essentiellement sur des processus inconscients, nous
ne pouvons les chasser de notre esprit. Or, si on admet le principe que « devoir
implique pouvoir », il s’ensuit qu’il paraît vain de se doter d’une quelconque
norme délibérative cherchant à les interdire. C’est pourquoi je me concen-
trerai sur des contenus mentaux que l’on peut effectivement chasser, ou, à
tout le moins, essayer de chasser. Ainsi, les pensées de tuer son prochain, de
le voler, de lui mentir, de lui nuire d’une manière ou d’une autre, de même
que les pensées blasphématoires, scatologiques ou les pensées associées aux
péchés capitaux (paresse, orgueil, envie, etc.) pourront certainement se pré-
valoir d’être des mauvaises pensées, pour autant qu’on les contrôle. Mais
quelle faculté produit ce genre de contenus mentaux ?
L’imagination me semble être la meilleure candidate. En effet, celle-ci per-
met de respecter le principe « devoir implique pouvoir » : puisque je peux dé-
cider d’imaginer telle ou telle chose, je peux avoir un devoir de ne pas le
faire. D’ailleurs, que fait l’homme dans l’exemple de Williams ? Il suppose ou
il imagine qu’il tue ses concurrents, et il a bien décidé de le faire. Je propose
donc de définir les mauvaises pensées comme des représentations mentales
imaginées dont je suis à l’origine et que je peux chasser. En soutenant que
l’imagination est la meilleure candidate, j’écarte sciemment trois autres types
de contenus mentaux : les intentions, les croyances et les percepts.
Ne pourrait-on pas assimiler les mauvaises pensées à des intentions ? Cela
irait à l’encontre de l’exemple de Williams : l’homme qui délibère ne forme
pas l’intention de tuer ses concurrents, il se contente d’en envisager la pos-
sibilité. Si l’intention (ou la décision) est l’étape ultime d’une délibération ou
d’un raisonnement pratique, notre problème se situe, pour sa part, en amont.
D’ailleurs, force est de constater que la question de savoir s’il existe des mau-
vaises intentions 3n’est guère douteuse : une intention de nuire à autrui, par
exemple, est sans conteste une mauvaise intention (et les kantiens y sont tout
particulièrement sensibles). Pour des raisons similaires, j’écarterai également
la catégorie des désirs qui, sans s’identifier aux intentions, s’en rapprochent
par leur caractère motivant.
Les mauvaises pensées pourraient-elles alors être des percepts ou des
3. Il n’est d’ailleurs pas forcément aisé de discerner dans la notion religieuse de mauvaises
pensées ce qui relève exactement de l’intention. Mais il me semble que Mathieu, par exemple, ne
se contente pas de condamner l’intention de l’adultère lorsqu’il dit : « Vous avez appris qu’il a été
dit : Tu ne commettras point d’adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme
pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur » (Mathieu 5, 28). L’idée
qu’il serait possible de commettre l’adultère semble tout aussi proscrite.
2VOLUME 1, NO3 (DÉCEMBRE 2009)

Une pensée peut-elle être mauvaise ? M.GIBERT
croyances ? Une délibération morale repose très souvent sur de tels conte-
nus mentaux. Ainsi, je peux percevoir une personne qui m’inspire du dé-
goût comme je peux croire que les femmes sont, en droit, supérieures aux
hommes : ces considérations peuvent bien prendre part à ma délibération.
Mais, encore une fois, le principe « devoir implique pouvoir » suppose que
l’on écarte ce type de considérations. En effet, les percepts et les croyances
sont passifs, involontaires et d’origine externe. Je ne décide pas de perce-
voir telle personne dégoutante, tout comme je ne décide (habituellement 4)
pas de croire que les femmes sont, en droit, supérieures aux hommes. Afin
de proscrire un contenu mental, je dois être capable d’en contrôler, sinon le
surgissement, du moins le bannissement.
Mais l’originalité de l’imagination consiste justement dans sa capacité à
« mimer » des percepts et des croyances, tout en nous assurant un certain
contrôle sur ces quasi-croyances ou ces quasi-percepts. Ainsi, Schroeder
et Matheson (2006) montrent qu’il existe (presque) un consensus pour dé-
finir l’imagination comme une attitude cognitive distincte des percepts et des
croyances. Imaginer une chose, c’est en considérer mentalement la possibi-
lité, sans la percevoir, ni même croire qu’elle est le cas. Ainsi, lorsque j’ima-
gine mon voisin et sa femme nus, c’est parce que je perçois qu’ils sont habillés
ou que je ne les perçois pas du tout. On peut, dans ce cas, parler d’imagi-
nation perceptuelle : la représentation mentale imaginée a pour contenu une
image (et cette image n’est pas nécessairement d’ordre visuel : je peux aussi
imaginer qu’ils hurlent de plaisir ou qu’ils sentent la fleur d’oranger. . .). De
même, je peux imaginer que l’un ou l’autre désire commettre l’adultère avec
moi – je n’ai alors pas d’image particulière de mes voisins, je fais plutôt une
sorte de supposition. On peut, dans ce cas, parler d’imagination proposition-
nelle : la représentation mentale imaginée possède un contenu proposition-
nel 5.
Et il ne fait pas de doute que des représentations mentales imaginées
participent souvent à nos délibérations. Un exemple simple peut l’illustrer.
Considérons une jeune femme qui vient de découvrir qu’elle est enceinte
et se demande si elle doit avorter. Admettons qu’elle délibère. Elle va évi-
4. Ce point mériterait une discussion plus approfondie. En effet, on peut parfois tenir un
agent pour responsable de ses croyances : celui qui a une croyance raciste par exemple au-
rait pu faire l’effort épistémique d’en vérifier les présupposés. En ce sens (qui respecte « devoir
implique pouvoir »), sa croyance est bien mauvaise. Il s’ensuit que les « mauvaises croyances »
constituent peut-être une catégorie recevable de mauvaises pensées. Cet article ne traite pas de
ce cas spécifique - et mes conclusions ne pourront donc être étendues aux mauvaises croyances.
5. Si les vocables « imagination perceptuelle » et « imagination propositionnelle » me sont
propres, ils coïncident néanmoins avec des distinctions très similaires qu’opèrent de nombreux
auteurs : McGinn (2004), Currie & Ravenscroft (2002), Goldman (2006). Signalons toutefois que
certains auteurs considèrent que la supposition ne relève pas à proprement parler de l’imagi-
nation : White (1990) ou Gendler (2000), par exemple. Mais il ne semble pas que cela ait une
incidence sur les arguments présentés ici. Il conviendrait seulement de distinguer deux types de
mauvaises pensées : les mauvaises imaginations et les mauvaises suppositions.
IGITUR –ARGUMENTS PHILOSOPHIQUES 3

M.GIBERT Une pensée peut-elle être mauvaise ?
demment considérer un certain nombre de croyances, certaines factuelles,
d’autres plus normatives : que le père est son petit ami, qu’elle peut compter
sur l’aide de ses parents, qu’il lui reste trois années d’étude avant de devenir
comptable, qu’elle n’aime pas vraiment les enfants, que la loi de son pays
lui permet d’avorter, que l’Église condamne l’avortement. . . Mais sa délibé-
ration ne se cantonnera vraisemblablement pas à cela. Elle envisagera aussi
des possibilités, plus ou moins pertinentes : que son petit ami la quitte, que
le bébé soit une fille, que l’accouchement soit douloureux, que le bébé soit
adopté par un couple stérile, que ses parents réagissent de telle ou telle ma-
nière à l’annonce de la grossesse. . . Autrement dit, elle imaginera un certain
nombre de choses, tantôt sur le mode perceptuel (la douleur de l’accouche-
ment), tantôt sur le mode propositionnel (l’adoption par un couple stérile).
Cet exemple n’a rien d’extravagant. Il y a donc de bonnes raisons de penser
qu’une large part de nos délibérations morales s’appuie sur des considéra-
tions de cet ordre, soit des représentations mentales imaginées. Reste à savoir
si cela est toujours moralement acceptable.
3 EST -IL MAL DE PENSER À MAL ?
Les mauvaises pensées peuvent donc se définir comme des représenta-
tions mentales imaginées. Mais pourquoi sont-elles mauvaises ? Dans l’exem-
ple de Williams, un homme fait une déclaration sur la possibilité d’un ho-
micide – possibilité qu’il rejette aussitôt. Cette déclaration indique qu’il y a
pensé : il a considéré cette possibilité dans sa délibération (il l’a probablement
fait sur le mode de l’imagination propositionnelle plutôt que perceptuelle). Et
c’est précisément ce que Williams lui reproche. Pour accréditer son reproche il
invoque alors le « malaise » que nous ressentirions face à cet homme. Pourtant
la chose ne va pas tout à fait de soi.
D’une part, on pourrait parfaitement imaginer que la déclaration de l’hom-
me est ironique : dans ce cas, les spectateurs, quand bien même ils ne riraient
pas aux éclats, ne ressentiraient certainement aucun malaise. Autrement dit,
pour être condamnable, la déclaration (et la représentation mentale qui la
précède) se doit d’être « sérieuse ». D’autre part, l’exemple de Williams sup-
pose que notre réaction à ce que dit l’homme coïncide avec notre réaction à
ce qu’il pense. Or, il se pourrait que le malaise proviennent d’abord du fait
que l’homme, dans ce contexte particulier, ait jugé nécessaire de verbaliser sa
délibération – et, qui plus est, au moyen d’un « nous » inclusif. Certes, dans la
mesure où nos représentations mentales imaginées sont privées, on ne voit
guère comment y avoir accès autrement que par une verbalisation. Mais on
peut concevoir un contexte différent, un contexte où « penser à voix haute »
serait plus habituel : le cabinet d’un psychanalyste, par exemple. Or, dans
ce cas, il me semble loin d’être évident qu’un auditeur (caché sous le divan !)
éprouverait un malaise en entendant : « Bien sûr, je pourrais les faire tuer,
mais je devrais écarter cette éventualité dès le départ ». Bref, si, intuitive-
ment, le malaise ressenti fournit bien un indice, il demeure insuffisant pour
4VOLUME 1, NO3 (DÉCEMBRE 2009)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%