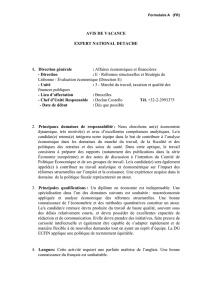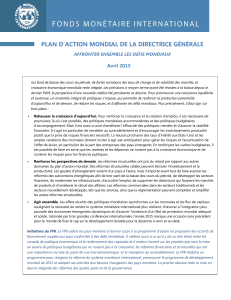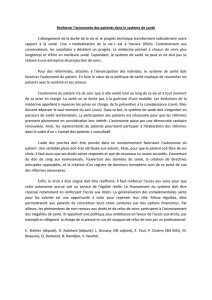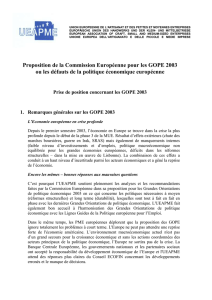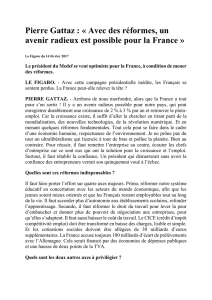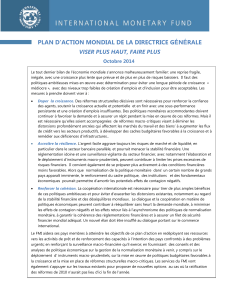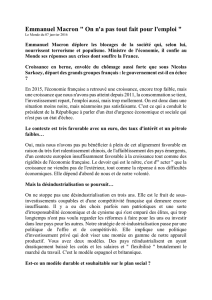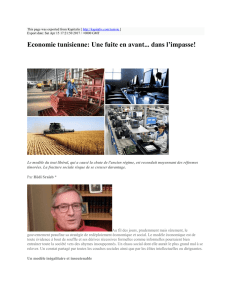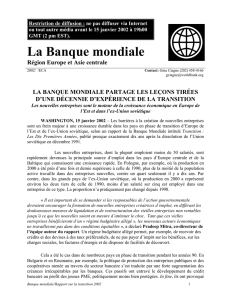Politique économique et croissance en Europe

Politique économique et croissance en Europe
Rapport au CAE
Philippe Aghion, Élie Cohen et Jean Pisani-Ferry
Mars 2006
Le constat de la médiocre performance européenne n’est pas contesté. Les chiffres attestent en effet que le PIB
par tête de l’Union européenne à quinze stagne depuis trente ans à 70 % environ de celui des États-Unis et qu’en
son sein ceux des grands pays développés, Allemagne, France et Italie, ont décliné de cinq à dix points au cours de
la même période.
Les raisons de cet affaissement donnent, en revanche, matière à débat. Leur élucidation est d’autant moins évi-
dente qu’à la fin des années quatre-vingt, alors que les États-Unis s’interrogeaient sur les ressorts de leur apparent
déclin, nombre d’experts annonçaient l’avènement du siècle européen (Thurow, 1992). L’Europe paraissait avoir
trouvé la secrète alchimie entre souveraineté collective et prérogatives maintenues des États, stabilité macroéco-
nomique et initiatives hardies dans les nouvelles technologies, Marché unique et préservation des modèles sociaux
nationaux. Que s’est-il donc passé ?
Schématiquement, quatre thèses s’affrontent.
La première thèse soutient que « l’Europe ne va pas si mal » et que la performance européenne est simplement
l’effet d’un choix collectif au détriment du travail et en faveur du loisir (Blanchard, 2004) : les Européens ne souf-
friraient pas d’un retard de productivité, mais paieraient simplement les conséquences d’une insuffisante appé-
tence pour le labeur.
La deuxième thèse met l’accent sur les politiques macroéconomiques (Fitoussi, 1995 et Fitoussi et Le Cacheux,
2005). Au gré de cette analyse, la croissance européenne pâtirait essentiellement de politiques excessivement et
durablement restrictives, qui finissent par enrayer l’ensemble du système économique.
La thèse aujourd’hui dominante impute principalement le retard de croissance européen à la combinaison d’une
intégration inachevée et de réformes structurelles incomplètes. Le rapport Sapir (Sapir et al., 2004) en a donné la
version la plus élaborée(2).
La dernière thèse enfin déplace le problème : ce n’est pas tant à une crise européenne que nous serions confron-
tés, qu’à celle de l’Allemagne, de l’Italie et de la France. La diversité interne de l’Union européenne et les perfor-
mances très contrastées des pays membres expliqueraient un phénomène improprement qualifié de crise euro-
péenne (Wyplosz, 2005).
Ces explications contiennent chacune une part de vérité, mais nous paraissent également insatisfaisantes. (…)
La thèse de Blanchard (2005) qui met en avant la préférence pour le loisir offre une explication possible – encore
que sujette à discussion – de l’écart de revenu entre États-Unis et Europe au milieu des années quatre-vingt-dix,
mais elle ne nous paraît pas pouvoir rendre compte de la dégradation relative de la performance européenne de-
puis une dizaine d’années. En particulier, le vif contraste entre les évolutions de la productivité de part et d’autre
de l’Atlantique ne peut pas être analysé dans cette grille.
La deuxième thèse, qui incrimine les politiques restrictives (Fitoussi, 1995, Fitoussi et Le Cacheux, 2005), rend
compte de certains épisodes – la désinflation des années 1982-1987, la réponse aux crises monétaires puis la con-
vergence vers les critères de Maastricht des années 1992-1997, mais il ne nous semble pas possible d’attribuer à
l’orientation des politiques macroéconomiques une performance régulièrement décevante sur une période de
trente ans. Comme nous venons de le rappeler, la politique macroéconomique n’a pas constamment été restrictive.
En attestent d’ailleurs que la dette publique moyenne de la zone euro soit passée de moins de 60 % du PIB à la fin
des années quatre-vingt à près de 80 % en 2004, et que les taux d’intérêt nominaux et réels soient aujourd’hui à
des niveaux historiquement bas. Par ailleurs, l’explication par la demande peine à rendre compte du ralentissement
de la productivité globale des facteurs qui a marqué l’évolution de la croissance européenne au cours des dernières
décennies et plus particulièrement depuis dix ans.

Plutôt que par un caractère uniformément restrictif, il nous semble que c’est par la faiblesse de la stabilisation
qu’il faut caractériser la politique macroéconomique européenne. Cependant, la qualité de la stabilisation est
sans effet sur la croissance à long terme dans l’approche usuelle de la politique économique. Tant qu’on raisonne
dans ce cadre, traditionnel, stabilisation et croissance sont deux questions disjointes qui relèvent d’instruments
distincts. Nous montrerons dans le chapitre II que telle est bien l’hypothèse sous-jacente au système de politique
économique européen et dans le chapitre IV que cette hypothèse n’est pas nécessairement fondée.
La troisième thèse, aujourd’hui dominante, impute principalement le retard de croissance européen à la combinai-
son d’une intégration inachevée et de réformes incomplètes. Selon cette explication que développe par exemple le
rapport Sapir (2004), qui est sous-jacente aux prescriptions de la Commission et de la Banque centrale, et qui est
reprise, verbalement du moins, par le Conseil européen, l’Europe souffrirait avant tout d’être restée à mi-chemin.
La persistance au sein de l’Union européenne d’une fragmentation du marché des services et des marchés finan-
ciers, d’une part, la réticence de nombreux États, surtout parmi les plus grands pays de la zone euro, à libéraliser
leurs marchés du travail et leurs marchés des biens, expliquerait que l’Europe n’ait connu ni le retour au plein em-
ploi ni le redressement des gains de productivité dont les États-Unis ont fait l’expérience. C’est sur cette analyse, du
moins son volet interne, que se fonde en France le récent rapport Camdessus (2004).
Cette explication ne nous satisfait pas non plus. Dans sa version courante, elle laisse en effet accroire que rien n’a
été fait depuis trente ans et suggère qu’un retour durable à la croissance ne requiert qu’un peu de volonté poli-
tique. Or s’il est clair – nous y reviendrons – que beaucoup reste à faire pour intégrer les économies européennes
et les doter de marchés efficients, comment expliquer que tout ce qui a été entrepris jusqu’ici n’ait produit aucun
effet ? Pourquoi le marché unique et l’euro n’ont-ils pas, ou apparemment pas, apporté les bénéfices attendus ?
(…)
Enfin la quatrième thèse, celle de Wyplosz (2005), réfute la dimension européenne des problèmes et plaide pour
des réponses nationales. Selon cette analyse, le « plus d’Europe » serait une illusion et c’est d’abord d’une réap-
propriation de la politique économique par les gouvernements nationaux qu’il faudrait attendre une réponse aux
difficultés. On peut avoir de la sympathie pour l’idée que certains gouvernements européens se sont défaussés sur
« Bruxelles » de responsabilités qui leur appartenaient. Les gouvernements français se sont particulièrement illus-
trés dans cet exercice qui n’est certainement ni très digne de respect, ni surtout très productif. Mais faut-il pour
autant exonérer les politiques européennes et plus précisément le système de politique économique européen de
toute responsabilité ? Cela nous paraît excessif.
(…)
Cependant il nous semble qu’il y a au moins deux idées importantes qui ont échappé à la réflexion et aux débats
sur comment stimuler la croissance et l’innovation en Europe. La première idée, à nos yeux la plus fondamentale,
c’est que, contrairement à ce que dispensent la plupart des manuels d’économie et ce qu’économistes aussi bien
keynésiens qu’anti-keynésiens ainsi que la plupart des décideurs économiques tiennent pour acquis, il n’y a pas
nécessairement dichotomie entre : d’une part la croissance (de long terme) qui reposerait exclusivement sur les
caractéristiques structurelles de l’économie et sur la nature des marchés ; et d’autre part la politique macroéco-
nomique dont l’objectif premier sinon unique serait de stabiliser l’économie et réduire l’impact des chocs à court
et moyen terme. Selon leur vision, la politique macroéconomique n’affecterait la croissance qu’indirectement en
garantissant la stabilité des prix et du taux de change. Tout au contraire, ce chapitre tend à montrer qu’une poli-
tique macroéconomique contra-cyclique adéquate est de nature à stimuler la croissance économique dans des
économies comme la nôtre où les entreprises sont sujettes a des contraintes de crédit. En fait nous allons plus
loin en montrant que l’effet positif de politiques macroéconomiques contra-cycliques sur la croissance persiste
lorsque les marchés de produits et du travail ont été libéralisés. Il n’y a pas substituabilité, mais plutôt complémen-
tarité entre politique macroéconomique contra-cyclique et la libéralisation de ces deux marchés. (…)
La seconde idée, c’est que l’introduction de réformes structurelles à grande échelle, et la transition vers un sys-
tème économique avec des marchés plus flexibles, est un processus coûteux, et que le coût des réformes est
celui de satisfaire la contrainte d’économie politique. Comme nous le montrons dans la seconde partie du chapitre
et dans l’annexe, ceux parmi les pays développés qui ont réussi à s’engager dans la voie des réformes ont, soit
bénéficié d’effets de signaux (ce que nous appelons les effets « dos au mur ») qui ont certainement contribué à
en réduire le coût politique, soit accompagné les réformes structurelles de politiques macroéconomiques expan-
sionnistes (monétaires ou budgétaires) pour financer le coût de ces réformes. C’est là un aspect important qui n’a
pas été pleinement pris en compte notamment dans le rapport Camdessus lorsque celui-ci se réfère à l’exemple
des pays européens « réformateurs » pour justifier un big bang dans les réformes structurelles en France. (..)

En résumé, la politique budgétaire et en particulier l’investissement public et l’aide aux entreprises, doivent être
contra-cycliques pour favoriser la croissance, et ce d’autant plus que le pays est moins développé financièrement.
En revanche, la cyclicité des dépenses de consommation courante n’a pas d’incidence sur la croissance.
(…)
L’analyse à la fois théorique et empirique dans cette première partie suggère que l’activisme macroéconomique
est d’autant plus nécessaire que les marchés financiers ne sont pas pleinement développés, et d’autant plus
efficace que les marchés des biens et du travail sont réactifs. Nous avons en effet abouti à la conclusion que s’il y a
substituabilité entre développement du marché du crédit et politique budgétaire contra-cyclique, au contraire, la
libéralisation des marchés des produits et du travail ne fait que renforcer le rôle de l’activisme macroéconomique
dans la croissance de long terme.
(…)
Si les réformes structurelles possèdent toutes les vertus que nous leur attribuons, pourquoi ces réformes n’ont-
elles pas déjà été engagées ou ne sont-elles pas engagées rapidement par les décideurs politiques ? Autrement
dit, pourquoi sont-elles impopulaires à un point tel que les décideurs politiques préfèrent souvent opter pour le
statu quo ? N’ont-elles par pour objectif d’améliorer le bien-être social ou au moins celui d’une large majorité de la
population ?
Trois types d’explications, largement complémentaires, ont été proposés pour expliquer les blocages politiques à
de telles réformes (Kanbur, 2001 et Bénassy et al., 2005). Premièrement, l’inégale répartition des gains
d’efficience et des coûts associés aux réformes entre différents groupes d’intérêt, et l’anticipation que le gouver-
nement ne saura pas accompagner les réformes de politiques de redistribution adéquates. Ensuite, une réparti-
tion inégale des coûts et bénéfices au cours du temps : alors que les coûts sont largement supportés à court terme
par les générations courantes, les bénéfices se manifestent à moyen et long terme, et donc au profit des généra-
tions futures qui évidemment ne sont pas pleinement présents aujourd’hui pour apporter leur soutien politique
aux réformes. Enfin, l’imperfection des marchés et l’existence de coûts de transaction (incomplétude des con-
trats, asymétries d’information, etc.) qui font que le théorème de Coase ne s’applique pas et par conséquent que
certaines réformes sont bloquées même si elles conduisent à des gains d’efficacité.
(…)
Première leçon : pour pouvoir surmonter les contraintes d’économie politique, il faut accompagner les réformes
structurelles de politiques budgétaires et monétaires expansionnistes, surtout en l’absence d’effets de « dos au
mur » comme c’est le cas nous semble-t-il au sein la zone euro. Deuxième leçon : les États-Unis, malgré leurs mar-
chés boursiers et hypothécaires et leurs fonds mutuels nettement plus développés que les nôtres, maintiennent
un niveau d’activisme budgétaire et monétaire bien supérieur à celui de l’Europe, et avec des résultats très posi-
tifs en matière de croissance. Étant donné que le développement financier est une entreprise de très longue ha-
leine, pourquoi ne pas faire comme eux et appliquer nous aussi des politiques budgétaires plus contra-cycliques
afin de pleinement bénéficier de la libéralisation des marchés du travail et des produits ? Ce n’est qu’une fois que
les marchés de crédit en Europe auront été pleinement libéralisés que les gouvernements pourront éventuellement
se dispenser de l’activisme budgétaire.
1
/
3
100%