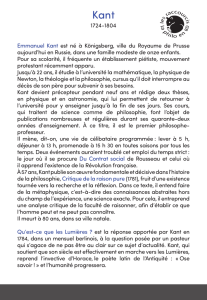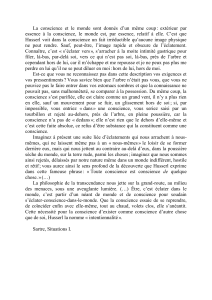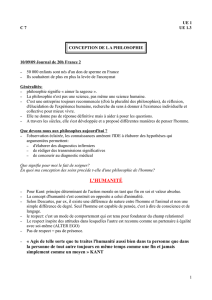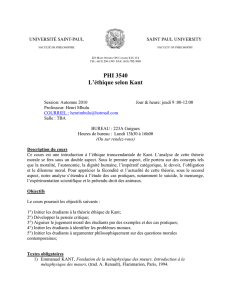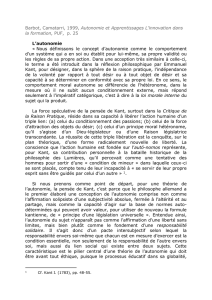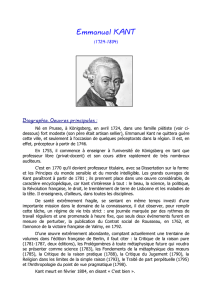1 - Unil

1
Université de Lausanne
Faculté des Lettres – Section de philosophie
Chaire de philosophie générale et systématique
Cours de philosophie générale automne 2011
Professeur : R. Célis, Assistante : S. Burri
« Introduction à la pensée phénoménologique »
La crise des sciences exactes comme amplification du monde
Nous prolongeons notre réflexion sur la crise des sciences telle qu’elle a été exposée par Edmund
Husserl dans son texte La crise de l’humanité européenne et la philosophie, par la lecture de l’essai du physicien
et philosophe Pierre Kerszberg. Dans La crise des sciences exactes comme amplification du monde, l’auteur
commence par relever ce que Husserl avait déjà souligné en son temps, à savoir que les sciences
humaines ne sont pas arrivées à la hauteur des sciences exactes. Si l’on prend l’exemple de la médecine,
qui fait usage des sciences naturelles, et qui parvient à traiter des maladies ou complications sévères
avec des résultats satisfaisants, on ne peut en dire autant de l’économie, des sciences politiques et
sociales ou de la psychologie qui, dans bien des cas, sont impuissantes à prévenir ou à trouver des
solutions aux problèmes qu’elles sont censées résoudre.
Or un des fondateurs de la sociologie, Emile Durkheim, avait déjà diagnostiqué en plein milieu du
19e siècle un morcellement complet du corps social et des communautés de la plupart des pays
européens industrialisés. Non seulement, aucun remède à ce que Durkheim nomme « anomie » ne fut
trouvé entre-temps, mais à l’époque où Husserl écrit sa « Krisis », ou plus exactement La crise des sciences
européennes, dont le texte que nous avons lu en résume quelques enjeux, cette division s’étend, sur un
mode hostile, à toutes les nations européennes. En effet, ce n’est pas seulement l’Allemagne —
confrontée à la montée du nazisme — qui est malade mais toutes les nations qui consciemment ou
inconsciemment ont favorisé la misère et la détresse de la population allemande, auxquelles Adolf
Hitler prétendait trouver une issue rapide. Mais pourquoi, peut-on se demander, Husserl se livre-t-il à
des considérations épistémologiques, et non à une réflexion morale ou politique, pour diagnostiquer la
crise qui s’abat sur l’Europe ? Pour répondre à cette question, il convient de se prémunir contre l’idée
qu’Husserl ne ferait que pratiquer une dénonciation facile et stéréotypée de ce que l’on appelle les
techno-sciences. Les techno-sciences sont, selon Husserl, tout à fait légitimes dans leur domaine, c’est-
à-dire lorsqu’elles ne prétendent pas offrir une solution à tout. C’est bien plutôt la fascination
démesurée pour lesdites techno-sciences qui est digne de soupçons et qu’il s’agit de démystifier. En
l’occurrence, ce soupçon s’est avéré pertinent, car c’est bien à la technologie que le national-socialisme,
et les autres pays à sa suite, y compris les Etats-Unis et l’usage qu’ils feront de l’énergie atomique,
auront recours pour préparer la guerre la plus dévastatrice et la plus cruelle que le monde a jamais
connu. Une fois le conflit déclaré – et un grand nombre de personnalités lucides le jugeaient inévitable
– la surenchère au niveau de la recherche de solutions technologiques définitives n’a cessé de
s’amplifier. Ce qui explique qu’aujourd’hui la technologie excelle surtout par son pouvoir de
destruction.
Mais d’où proviennent cette fascination et cette croyance en la tout puissance des techno-sciences ?
Pour Husserl, ce n’est rien d’autre que son exactitude, toujours accrue par sa constante mathématisation
qui suscite pareille naïveté. Certes, la nature est chiffrée et est constituée par des nombres, à la manière
d’une partition musicale, ainsi que Pythagore et Platon l’avaient déjà découvert. Mais là n’est pas le
problème selon Husserl. Qu’est-ce qui pose alors à vrai dire problème ? C’est le fait que, peu à peu, la
science qui était à l’origine d’abord theoria — à savoir la compréhension qui n’a pour seule finalité
qu’elle-même— est aujourd’hui d’emblée soumise aux exigences de son instrumentalisée. Par l’exercice
patient de la theoria il s’agit de montrer, de faire voir quelque chose, de manifester ce qui pourtant est
déjà là de manière évidente. La theoria au sens grec, se distingue cependant de la perception spontanée
par ceci qu’elle permet de saisir la réalité avec une acuité et une rigueur tout à fait inhabituelles. Dans
cette perspective, il n’est pas encore question d’en faire usage pour assurer une maîtrise quelconque sur

2
le réel. En effet, la science des choses que l’on observe en premier lieu autour de soi puise
originairement sa source dans une disposition première (Grundstimmung) — l’étonnement — et de la
curiosité qui découle de cette disposition fondamentale. Autrement dit, c’est cette disposition
fondamentale de l’étonnement qui donne son impulsion et relance toute recherche véritablement
scientifique. C’est là ce que nous nommons encore « recherche fondamentale », exempte de tout intérêt
pratique a priori. Or, ce à quoi assiste Husserl avec la montée du nazisme, c’est à un phénomène tout à
fait contraire. Le rapport de subordination entre science et technique s’est déjà résolument inversé, car
la science est devenue d’entrée de jeu instrumentale, et assujettie aux diktats de l’industrie et de ses
besoins en ressources technologiques, à commencer par l’industrie de l’armement. Or, ce phénomène
est des plus surprenants dans la mesure où c’est la philosophie, et son idéal de compréhension
désintéressé, qui sont à l’origine de la science. Pour le dire très simplement, et ainsi que l’histoire des
sciences à ses débuts le démontre, la science d’Aristote, mais aussi celle des modernes, est d’abord le
prolongement naturel de la philosophie occidentale. Que l’on songe à Nicolas de Cues, à Descartes, à
Leibniz, ou plus près de nous à Einstein, Max Planck ou Heisenberg, ce fut toujours la theoria qui
permit de forger les idées directrices sur l’ordre de l’univers, et ce n’est qu’à partir d’elles qu’il fut
possible d’élaborer de nouveaux objets de savoir et les concepts qui leur sont appropriés.
Kant et les limites de la science
Ce phénomène qui consiste en ce que la philosophie est originairement la possibilité même de
forger des idées desquelles des concepts seront issus est ce que Kant nomme les idées directrices. Dans
l’univers de la physique de Newton, celle que Kant avait apprise, l’Idée princeps porte sur la nature
même du monde : à savoir qu’il n’est plus cette nature animée des Grecs, ni la natura médicatrix des
Stoïciens romains, ni même cette œuvre divine des médiévaux conçue pour l’habitation transitoire des
hommes, mais un ensemble mécanique complexe, entièrement en mouvement, et dont la logique est
essentiellement déchiffrable par l’algèbre. En l’absence de cette idée directrice, Newton n’aurait tout
simplement pas pu découvrir la loi de la gravitation, ni d’autres règles lui permettant d’expliquer la
trajectoire des astres. Or, Kant ce grand philosophe qui va marquer de son empreinte la fin du XVIIIe
siècle et l’entier du XIXe siècle jusqu’à nos jours, méditant l’œuvre de Newton, découvre que la science
repose sur des axiomes qui ne relèvent pas strictement de la connaissance, mais de la pensée pure. C’est
là leur dimension transcendantale, c’est-à-dire leur a priori qui excède toute expérience possible, et qui
consiste en définitive en une hypothèse philosophique portant sur l’architecture de l’univers la plus
raisonnable et la plus vraisemblable. Une fois ce fondement assuré, Kant s’empresse de préciser que la
science est contrainte de laisser celui-ci à l’arrière-plan de son activité pour convertir les phénomènes
perçus dans l’espace-temps en objets d’expérimentation rigoureuse, régie par des concepts, tels que la
causalité et la nécessité. D’une part, expose-t-il dans la Critique de la Raison pure, nous ne pouvons pas
saisir ces objets en faisant abstraction des intuitions a priori que sont l’espace et le temps. Autrement
dit, nous ne pouvons connaître ce qui est hors des limites et des données de l’expérience
1
sensible. Nous
(re)connaissons (erkennen) comme réels uniquement les phénomènes empiriques en tant qu’ils affectent
nos sens et qu’ils sont ordonnés par notre entendement, c’est-à-dire par la faculté qui produit des
concepts. Puisqu’ils sont tributaires de nos facultés, les objets de l’expérience ne sont donc jamais que
des phénomènes de la chose et non la chose en soi, telle qu’elle existe en indépendamment de nous. Or
cela signifie qu’un phénomène, tel que la science le construit, ne peut aucunement être réduit à lui
même, dans la mesure où il renvoie toujours à une chose en soi. Certes, ce renvoi est problématique
puisque la chose en soi nous est et nous demeure inconnue en sa constitution ultime
2
. La chose en soi
1
Pour connaître véritablement un objet, il faut penser le donné de l’intuition en son concept. C’est en
ce sens que la raison humaine et finie. Autrement dit, il n’y a pas d’intuition suprasensible pour
l’homme, une telle intuition étant réservée à une raison infinie.
2
A ce propos, Kant affirme : « En effet, si comme il convient, nous ne considérons les objets des sens
que comme des simples phénomènes, nous reconnaissons cependant par là aussi qu’ils ont comme
fondement une chose en soi, bien que nous ignorons comment elle est constituée en elle-même, et que
nous n’en connaissons que le phénomène, c’est-à-dire la façon dont nos sens sont affectés par cette
chose inconnue. » (E. Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science, Ed.
Vrin, Paris, pp. 88-89.)

3
se soustrait à toute connaissance comme à toute expérience, laquelle présuppose d’emblée son
l’insertion de cette chose dans l’espace et dans le temps, tels que notre sensibilité les configure. On ne
peut se constituer un objet sans les intuitions a priori que sont l’espace et le temps. Pour connaître un
objet scientifiquement, il nous faut donc recourir à ces deux intuitions a priori ainsi qu’aux concepts a
priori que sont les catégories de l’entendement (substance, causalité, réciprocité). De plus les premières
doivent être articulées par les secondes. Ce processus par lequel des concepts qui restent stables à
travers le temps subsument les données qui nous sont données dans l’espace et le temps, Kant le
nomme schématisme : la causalité dans le temps engendre la succession, la substance engendre la
permanence, la réciprocité engendre la simultanéité, etc. Or, ce schématisme est l’œuvre de la
subjectivité. Autrement dit, pour Kant, la science est, au moins pour l’essentiel de ses raisonnements,
une construction de nos facultés. Ce qu’elle saisit, ce sont des représentations des choses, non les
choses en elles-mêmes. C’est là ce qui en définit tout à la fois les limites et les conditions de possibilité.
Par conséquent, les objets connaissables n’existent pas pour nous hors de l’expérience, or de l’espace
et du temps et des concepts qui les schématisent. Ce schématisme s’avère donc également, selon Kant,
la racine qui tout à la fois limite la science et la rend possible. Toute science est limitée par ces a priori
que sont la sensibilité et la spontanéité propre à l’entendement chargée d’en produire les concepts
fondamentaux. C’est là ce que l’on nomme son « axiomatique ». Dès lors, la science n’entretient pas
avec la réalité un rapport que l’on puisse qualifier sans autre de réaliste. La preuve en est qu’elle ne nous
donne accès aux objets qu’elle élabore que dans le cadre d’un temps et à d’un espace d’emblée
quantifiable. Et la découverte du calcul infinitésimal va encore compliquer les choses. En effet, le calcul
infinitésimal, inventé par Leibniz, présuppose le raisonnement philosophique suivant : il n’existe pas de
quantité minimale, car tout peut être divisé à l’infini, même l’atome. Le point le plus millimétrique dans
l’espace et le millième de seconde peuvent également se diviser. En effet, selon Leibniz, le principe qui
gouverne la réalité c’est que les plus petites différences qui séparent les objets ou les molécules qui les
constituent sont toujours présentes, mais que le calcul infinitésimal permet précisément de saisir ces
différences sous la forme d’intégrales. La fameuse harmonie universelle, qui n’est autre que l’Idée
directrice de Leibniz, c’est-à-dire ce qui assure en définitive la cohérence foncière de l’univers et de
toutes les réalités qui le constitue n’est en définitive rien d’autre qu’une intégrale absolue que seule
l’intelligence divine peut appréhender, à la façon d’un gigantesque ordinateur. Autrement dit, les
monades que sont les objets et les êtres vivants dans leur individualité infinitésimale, aussi différentes
soient-elles les unes des autres, sont toutes réunies en une harmonie inter-monadique universelle.
Leibniz prétend que c’est précisément parce qu’il y a des différences harmoniques que cette unité
harmonique existe bien, quand bien même l’entendement humain ne peut la saisir.
Pour en revenir à Kant, qui avait lu Leibniz, il nous faut comprendre que le réel est toujours voilé.
C’est comme un palimpseste. Non que l’on ne puisse rien connaître que ce qui émane de nous. Mais
toute connaissance doit être consciente de ses limites. Car pour Kant, dont Husserl reprendra à sa
manière l’enseignement, ce qui nous permet de connaître n’est précisément rien d’autre que ce qui
limite notre connaissance.
Compte-rendu du 6 décembre 2012
1
/
3
100%