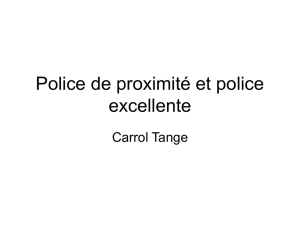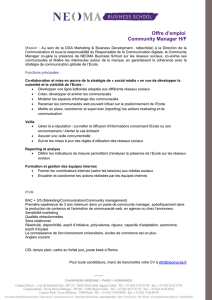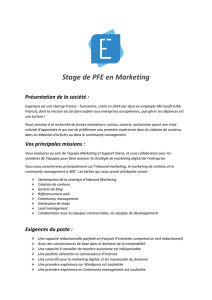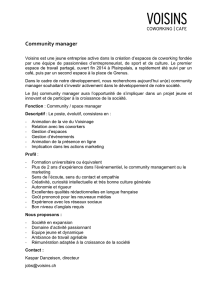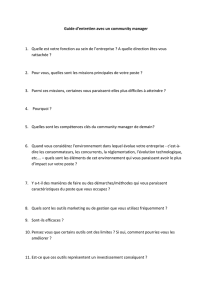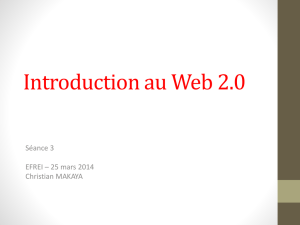1 - Police Municipale - Local Cops

- 1 -
FONCTION DE POLICE ORIENTEE VERS LA COMMUNAUTE
AVIS AU LECTEUR ................................................................................................................................. 2
RESUME relatif au MANAGEMENT .................................................................................................... 3
1 Le modèle de police traditionnel ...................................................................................................... 4
1.1 Caractéristiques 4
1.1.1 Une attitude réactive 4
1.1.2 Une approche symptomatique 5
1.1.3 L'application de la loi (et l'orientation vers les autorités) 6
1.1.4 La position isolée de la police 6
1.2 Champ d'application de la fonction de police traditionnelle 7
1.3 Echec du modèle de police traditionnel 7
2 Le modèle community policing ......................................................................................................... 9
2.1 Genèse du modèle 9
2.2 Définitions et descriptions du community policing 10
2.3 Piliers sur lesquels repose le community policing 12
2.4 Les sources belges ‘officielles’ 20
3 Les piliers de la fonction de police orientée vers la communauté ............................................... 23
3.1 Premier pilier: l’orientation externe 23
3.1.1 L’orientation externe se compose de deux (sous-)piliers: 23
3.1.2 La (les) communauté(s): un vaste concept 24
3.1.3 Besoins et attentes de la population 25
3.1.4 Déterminer les besoins et les attentes 27
3.2 Second pilier : l’orientation vers la résolution de problèmes 28
3.2.1 Le travail orienté vers la résolution de problèmes : une définition 28
3.2.2 Eclaircissement 28
3.2.3 Objectifs du travail orienté vers la résolution de problèmes 29
3.2.4 Problèmes: une description 29
3.2.5 Comment réaliser? 29
3.3 Troisième pilier: le partenariat 32
3.3.1 Pourquoi coopérer? 33
3.3.2 Les partenaires externes 34
3.3.3 Les partenaires internes 36
3.3.4 Les ‘7 indispensables’ 37
3.3.5 Principes de coopération 37
3.3.6 Coopérer : aussi avec les minorités 38
3.4 Quatrième pilier : ‘justification’ 38
3.5 Cinquième pilier: ‘empowerment’ ou ‘habilitation’ 40
4 Fonction de police orientée vers la communauté : suite ............................................................... 42
4.1 Fonction de police orientée vers la communauté : philosophie, stratégie, tactique ou ? … 42
4.2 La fonction de police orientée vers la communauté poursuit-elle d'autres buts? 44
4.3 COP ou POP? 45
4.4 Le community policing est-il ‘soft on crime’? 46
4.5 Théories sous-jacentes 47
4.6 Le community policing a-t-il déjà mené à des résultats? 49
4.7 Causes de la mise en œuvre défectueuse du community policing 53
4.8 La police ne peut y arriver seule ! 55
4.9 Note critique 56

- 2 -
AVIS AU LECTEUR
Le texte qui suit vise à fournir à la police locale un cadre conceptuel national concernant l'interprétation
du modèle policier ‘community policing’. Il s’agit d’ailleurs un modèle utilisé chez nos homologues
Belge. Suite aux décisions relatives au nouveau service de police intégré, structuré à deux niveaux, les
responsables politiques belges ont choisi de manière claire et nette ce modèle (fonction police de base)
pour la police locale. Il s’agit en fait du modèle de la police de proximité. Mais dans un contexe plus
large, cette fonction de proximité est très utilisé dans la Police Municipale et de moins en moins dans les
ville urbaine.
Je me suis attaché donc à vous faire découvrir ou tout simplement à vous rappeler en vous donnant des
traces, méthode pour mener à bien cette tâche.
Le ‘community policing’ est donc un modèle de police qui convient par excellence à l'interprétation de la
fonction de police de base exercée par la police municipale. Cette interprétation doit par définition se
faire au niveau local, c'est-à-dire être greffée sur la situation spécifique.
Le ‘community policing’ est cependant devenu une sorte de notion ‘fourre-tout’, au contenu confus et
aux objectifs vagues. Il s'est également de plus en plus transformé en ‘réservoir’ pour toute initiative
identique dans laquelle la population est impliquée d’une quelconque mesure.
Il semble dès lors nécessaire de faire un choix quant à l'interprétation de la notion et de mettre en place
une standardisation conceptuelle autour de cette interprétation. Il appartiendra à la police municipale de
poursuivre la traduction de ce cadre en des composantes structurelles, organisationnelles et
opérationnelles en fonction de la situation environnementale et spécifique au Corps. En ce qui
concerne ces trois éléments également, la deuxième partie du texte pose les principes essentiels, sans
toutefois imposer de contrainte.
Ce document s'adresse en premier lieu aux policiers municipaux, aux Maires. Les cadres supérieurs de
la police font également partie du public-cible.
Lorsqu’une base suffisamment large pour ce concept aura été atteinte, il sera ensuite développé en
compléments thématiques concrets, par exemple concernant les réunions de quartiers, l'approche
visant la résolution de problèmes ou les sondages réalisés auprès de la population, sous la forme de
manuels, de carnets de travail, de documentation, de dépliants, etc… Enfin, le matériel didactique (des
diverses formations) devra, dans un stade ultérieur, également être adapté.
En ce qui concerne le contenu du texte, un ‘avertissement’ est nécessaire.
Les policiers sont en général sensibles à toute forme de critique sur la manière dont ils ont travaillé dans
le passé. Ils se sentent attaqués, personnellement visés par la critique et ont le sentiment d'avoir
effectué du travail inutile ou mauvais. Le texte suivant n'est certainement pas rédigé dans ce sens, et
ce, pour deux raisons. Premièrement, la critique vise principalement le système (l'organisation) et non
les personnes. Deuxièmement, un modèle (de police) déterminé s'inscrit dans un cadre temporel
déterminé, et tous deux sont donc, par définition, évolutifs.

- 3 -
RESUME relatif au MANAGEMENT
Le modèle de police traditionnel se caractérise par : une attitude réactive (la police réagit aux incidents
après qu'ils se sont produits); une approche symptomatique (la police aborde les problèmes de sécurité
comme des symptômes distincts et ne se concentre pas sur les causes cachées de l'insécurité);
l'application de la loi (la police fait respecter la loi comme un but en soi et non comme un moyen de
favoriser la sécurité et la qualité de vie); la position isolée de la police (pas intégrée dans la société et
éloignée de la population).
La recherche scientifique a clairement démontré que le modèle de police traditionnel n'était pas efficace
dans la maîtrise de l'insécurité. La légitimité de la police a également fortement diminué en raison de la
détérioration des relations, en particulier avec les groupes minoritaires de la société, et la police a ainsi
souvent été la cause de troubles et d'émeutes urbaines.
Le modèle du ‘community policing’ se base sur une autre approche beaucoup plus large de la sécurité
et de la qualité de vie et découle de l'inefficacité et du manque de légitimité de la police. Il vise une
police intégrée dans la société, à la disposition du (des) citoyen(s) et qui cherche, avec les
communautés, des solutions qui se concentrent sur les circonstances locales causes d’insécurité.
Cinq piliers essentiels de la fonction de police orientée vers la communauté (interprétation du
‘community policing’) ont émergés d'une analyse approfondie de la littérature scientifique relative au
‘community policing’. Chacun de ces piliers constitue une condition essentielle au développement de la
fonction de police orienté vers la communauté. L’interaction entre tous ces piliers et leur renforcement
mutuel sont encore plus important que chaque pilier en soi.
L'orientation externe de la police (en tant qu’organisation) est un pilier de base absolu de la fonction de
police orientée vers la communauté. La police n'est pas face à la société, mais au centre de celle-ci;
elle en fait partie intégrante. Elle a en premier lieu une fonction sociale, c'est-à-dire qu'elle doit faire
respecter un ordre public qui n'est pas l'ordre de la dominance, mais celui de la tranquillité. La police se
trouve dans la société dont elle souhaite faire partie et dans laquelle elle ne peut agir efficacement que
grâce à son intégration : présence, permanence et échange. Elle connaît et comprend la situation et
l'évolution de la société. C'est justement grâce à cette intégration qu'elle a rapidement et totalement
pris conscience de ce qui ‘existe et importe’ quant à la sécurité et à la qualité de vie au sein de la
société; elle peut de ce fait réagir à temps et de manière appropriée, voire anticiper. Cette prise de
conscience se traduit également par une attitude de service axée sur les besoins et les attentes des
clients (potentiels) de la fonction de police.
Le pilier du travail visant la résolution des problèmes fait référence à l'identification et à l'analyse des
causes possibles de la criminalité et des conflits au sein de la (des) communauté(s). La police ne réagit
pas seulement à des problèmes après qu'ils se soient produits ou qu'ils lui aient été signalés, et n'attend
certainement pas qu'ils dégénèrent. Elle tente, par le biais d'un suivi, d'une identification et d'une
analyse continuels de la situation d'insécurité, d’identifier les problèmes à temps et si possible de les
anticiper. La police agit non seulement sur les manifestations de l'insécurité, parce qu'il ne s'agit
généralement que des symptômes de causes cachées ou sous-jacentes mais tente également, via une
analyse, d'identifier ces facteurs et de les influencer.
Le pilier du partenariat fait référence au fait que la police a conscience qu'elle n'est pas et ne peut pas
non plus être la seule responsable de la sécurité et de la qualité de vie. La coopération est nécessaire,
en particulier là où il s'agit de la prévention et de la recherche de solutions durables aux problèmes. La
sécurité et la qualité de vie sont l'affaire de tous, et une question d'intérêt et de responsabilité partagés :
‘copropriété’ de la sécurité. C'est pourquoi tous les acteurs, en premier lieu la population elle-même,
sont impliqués dans la sécurité et la qualité de vie : ‘coproduction’.

- 4 -
Depuis que l'on a pris conscience que la police ne peut pas veiller seule à la sécurité et à la qualité de
vie, des réseaux se sont constitués dans un souci de sécurité avec d'autres partenaires (comme la
commune, le ministère public, les institutions de soin, les sociétés de logement, les éducateurs et
animateurs de quartier, les activités socio-culturelles, les écoles, les entreprises et les citoyens), à partir
desquels la sécurité et la qualité de vie peuvent intégralement être abordés dans le quartier. La sécurité
devient de ce fait une approche en chaîne dans le cadre de laquelle chacun de ces réseaux constitue
un maillon dans une approche globale et intégrée. En particulier, les citoyens sont encouragés (pour
autant que ce soit nécessaire) à faire preuve d'autonomie dans le cadre de l'approche commune de
problèmes relatifs à la qualité de vie et à la sécurité dans leur propre environnement.
Le pilier de la justification requiert la mise en œuvre de mécanismes permettant à la police de justifier
les réponses formulées aux demandes et aux besoins des communautés qu'elle sert. Dans le modèle
de la fonction de police orientée vers la communauté, le principe du partenariat par lequel d'autres
acteurs sont également responsables de la sécurité et de la qualité de vie, découle logiquement du
devoir qu'a en ‘contrepartie’ la police de rendre des comptes à ces acteurs sur sa participation.
Le pilier de ‘l’empowerment’ (ndr : littéralement ‘délégation-gestion participative’) signifie qu'il faut créer des
possibilités tant pour les policiers que pour les divers groupes de la population d'aborder conjointement
les problèmes de sécurité et de qualité de vie, de fournir des services et d'instaurer la sécurité et la
sûreté. Ceci implique tant une démocratisation interne à la police qu'une émancipation des divers
groupes de population. L'ajout de ‘l'empowerment’ comme cinquième pilier est essentiel parce qu'il
s'agit d'un défi pour la vision instrumentale de la police dans le cadre de laquelle les policiers sont
réduits à être des exécutants purs et simples. ‘L'empowerment’ implique notamment que les policiers
réfléchissent de manière critique, avec leurs partenaires et la population, à leurs propres tâches et à la
manière dont elles sont exécutées.
La littérature scientifique d'évaluation, qui a vérifié si le nouveau modèle de police a été introduit avec
succès ou non et s’il a obtenu les effets visés, est modérément positive. Ce qui est toutefois très
frappant, c'est que le contenu du modèle ne présente pas de manquements graves, mais que sa mise
en œuvre échoue à chaque fois, en raison de la réticence manifestée au sein de l'organisation et d'un
manque de pression (politique) venant de l'extérieur. Pourtant, des mises en œuvre réussies prouvent
qu'il est possible de ‘plier du granit’ et de vaincre la capacité apparemment innée à résister à des
réorganisations radicales par une modification réfléchie, planifiée et soutenue de l'organisation.
1 modèle de police traditionnel
1.1 Caractéristiques1
Ledit modèle de police traditionnel se caractérise par :
Une attitude réactive;
Une approche symptomatique;
L’application de la loi
La position isolée de la police.
1.1.1 Une attitude réactive
Il s'agit de la réaction pure et simple à des problèmes de sécurité (incidents et/ou phénomènes) au
moment où ils sont signalés ou quand ils ont déjà atteint leur pleine ampleur.
1 Nous utilisons le terme de ‘modèle de police traditionnel’ en tant que dénomination commune pour ce que P. Ponsaers
distingue comme étant trois formes différentes de fonction de police : le modèle de police militaire bureaucratique, le modèle
de police ‘lawful policing’ et le ‘broad scope policing’. Ponsaers,P.

- 5 -
Dans cette approche, la police attend principalement les événements, et elle ne réagit qu'après la
manifestation d'incidents et/ou de phénomènes. Le qualificatif "réactif" donné à ce type de fonction de
police fait principalement référence à l'orientation primaire vers des interventions.
Cette attitude - surtout expectative - des services de police vis-à-vis des problèmes de sécurité peut être
retrouvée dans le nom de ‘fonction de police réactive’ ou ‘d'approche réactive’.
Dans le modèle traditionnel et réactif de la fonction de police, trois méthodes ou tactiques sont
centrales :
Le contrôle motorisé préventif comme moyen de dissuasion vis-à-vis d'auteurs
(potentiels);
L'intervention rapide comme réponse aux appels (urgents) de la population;
L'enquête judiciaire après qu'un délit ait été commis.
Entre-temps, il est un fait acquis que chacune de ces tactiques est, et reste, utile et nécessaire. C'est
certainement le cas pour la fonction d'aide temporaire à l'égard d'appels urgents. Mais il est
également certain que ces tactiques n'ont quasiment aucun impact sur l'évolution de l'insécurité en
général et sur celle de la criminalité en particulier
2
.
Lorsqu'on s'en est rendu compte – il y a des années –, les services de police se sont mis à accorder
une plus grande attention à la prévention. Il s'agissait principalement d'informer le public par des
conseils, de réduire les risques de devenir victime ou de limiter l'ampleur des dommages subis. L'effet
de ces efforts est cependant resté plutôt limité, surtout parce que cette forme de prévention pure et
simple a souvent été réalisée comme un effort isolé (séparément par un spécialiste et pas par chaque
policier dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes). Mais aussi parce qu’elle n'était pas intégrée ou
adaptée à d'autres efforts policiers et non policiers dans un ensemble complexe de mesures visant
l'approche des problèmes de sécurité.
1.1.2 Une approche symptomatique
Cette caractéristique fait référence à la seule réaction aux symptômes immédiatement visibles (les
manifestations externes sous la forme d'une atteinte à l'ordre public ou de délits) des problèmes et aux
faits après qu'ils se sont produits. Cela entraîne que l'on n’influe pas, ou seulement de manière
marginale, sur les causes plus profondes ou cachées de ces problèmes.
Ainsi par exemple, en arrêtant une installation musicale trop bruyante, le tapage nocturne
disparaît bien à ce moment-là, mais la nuisance permanente causée par un café mal
géré n'est pas encore résolue.
En arrêtant un voleur récidiviste, on empêche provisoirement d'autres vols d'être commis
par cette personne, mais le risque de vol dans un quartier reste peut-être aussi élevé en
raison du comportement imprudent des habitants et d'un manque de prévention au
niveau architectural
3
.
Cette réaction ne fait généralement pas non plus partie d'une approche cohérente : l'intervention est
traitée comme les autres interventions de même nature et pas dans son contexte spécifique.
L'intervention est considérée comme un incident isolé et pas dans le cadre d'une stratégie à l'égard de
tel type d'incident ou de phénomène.
Par exemple, une intervention après un appel pour un vol dans une voiture sur le parking
d'un grand complexe de cinéma est traitée de manière professionnelle et qualitative.
2
Kelling, G. & Pate, T. & Dieckman, D. & Brown, C. The Kansas City Preventive Patrol Experiment: A Summary Report. In:
Bayley, D. (Ed.), (1998), What Works in Policing. Oxford University Press. pp. 30-50. On peut également trouver un bon
résumé du faible impact du modèle traditionnel de lutte contre le crime dans: Van den Broeck, T. & Eliaerts, C. Community
policing. Organisatieveranderingen naar de basispolitiezorg bij de gemeentepolitie. Uitgeverij Politeia vzw, Brussel. (1994).
pp. 8-14.
3
Nous ne voulons par là en aucun cas susciter l'impression que les habitants sont coresponsables.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
1
/
57
100%