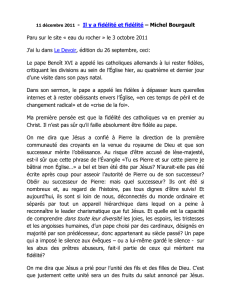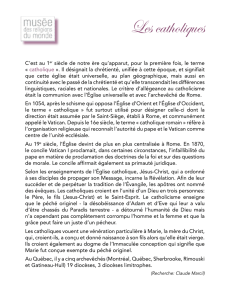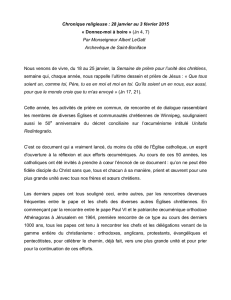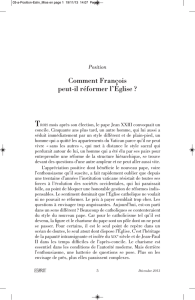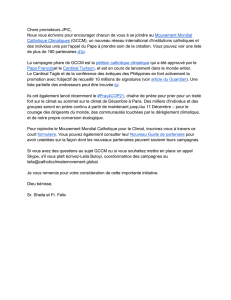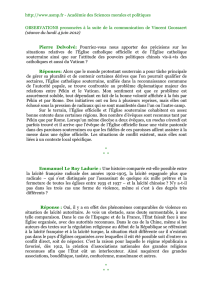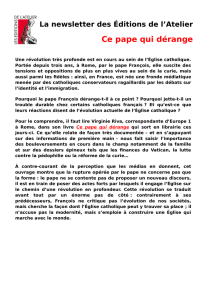Atelier laïcité - Gresh

1.5. Aux origines des controverses sur la laïcité
Apaiser la question religieuse pour poser la question sociale
Le monde Diplomatique, août 2003.
La nomination par le président Jacques Chirac d'une commission chargée de réfléchir
sur la laïcité dans la République, au moment même où l'Assemblée nationale se penche
sur le port de signes religieux à l'école, illustre la vigueur du débat qui traverse la société
française. Il y a un siècle, l'adoption de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de
l’État marquait une étape décisive du combat pour la laïcité. Les discussions de l'époque
permettent d'éclairer les enjeux actuels et de corriger quelques idées reçues.
Par Alain Gresh
« La séparation ? Vous n'êtes pas sérieux. Il faudra encore vingt ans. » Paris, printemps 1903. La
Chambre des députés vient d'élire une commission chargée de proposer une loi sur la séparation des
Églises et de l’État. Pourtant, Émile Combes, le président du Conseil, exprime ses doutes. Sous la
IIIe République, une commission n'est-elle pas le meilleur moyen d'enterrer un problème ? Pas cette
fois, car, deux ans plus tard, le 9 décembre 1905, la loi de séparation sera promulguée. Un siècle
après, qui se souvient des conditions dans lesquelles la laïcité s'est imposée en France ?
Après l'effondrement de l'empire de Napoléon III en 1870, l'écrasement de la Commune de Paris et
les échecs des tentatives de rétablissement de la monarchie, une majorité républicaine s'installe aux
commandes en 1879. Cela va permettre l'adoption d'une série de mesures en faveur de la laïcisation
: suppression du repos dominical obligatoire (1879), lutte contre les congrégations religieuses et
sécularisation des cimetières (1881), autorisation du divorce (1884) et surtout extension de
l'enseignement public menée par Jules Ferry. En 1882, l'école primaire devient gratuite et
l'instruction obligatoire, tandis que l'enseignement religieux est interdit dans les établissements
primaires d’État. Enfin, en 1886, l'enseignement est confié uniquement à un personnel laïque.
Comme le souligne Alain Boyer, « la laïcité est devenue un mot d'ordre qu'on ne peut
comprendre que par opposition au cléricalisme triomphant au XIXe siècle lorsque l’Église
(...) a cherché à diriger les États et à imposer une politique chrétienne
1
». Pour la majorité
républicaine, il ne s'agissait pas d'écraser les religions, mais de limiter le pouvoir de l’Église
catholique, alliée des royalistes, en s'appuyant au besoin sur d'autres confessions, notamment sur les
protestants...
Cette stratégie républicaine s'accompagne d'une volonté d'éviter toute guerre civile, de favoriser
l'évolution des esprits plutôt que la dureté de la loi, ainsi qu'en témoigne la célèbre « affaire des
crucifix ». Fallait-il enlever ces symboles religieux des écoles publiques à la rentrée 1882 ? Les
circulaires ministérielles appelèrent à appliquer la loi « dans l'esprit même où elle a été votée, dans
l'esprit des déclarations réitérées du gouvernement, non comme une loi de combat dont il faut
violemment enlever le succès, mais comme une des grandes lois organiques qui sont destinées à
vivre avec le pays, à entrer dans les mœurs et à faire partie de son patrimoine ». On trouvait encore
des crucifix dans les écoles publiques au lendemain de la seconde guerre mondiale...
La laïcisation de l'enseignement effectuée, fallait-il aller vers la séparation des Églises et de l’État,
que tous les partis républicains, des radicaux aux socialistes, avaient mis au cœur de leur
1
- Alain Boyer, Le Droit des religions en France, PUF, Paris, 1993.

programme ? Les républicains hésitent, d'autant qu'un nouveau pape, Léon XIII, élu en 1878,
adopte une attitude conciliante à l'égard du régime républicain. Elle se concrétise, en février 1892,
par l'encyclique « Au milieu des sollicitudes », qui suscite de vives oppositions au sein de la droite
catholique française. Pourtant, le texte de Léon XIII traduit l'évolution d'une partie de l'électorat -
ceux qu’Émile Littré nomme « les catholiques du suffrage universel » - et le désir de certains
catholiques et des monarchistes modérés d'unir leurs efforts avec les républicains modérés pour
combattre le nouveau péril, le socialisme.
Mais il est encore trop tôt pour surmonter le fossé qui divise « les deux France ». Deux facteurs
vont contribuer à durcir les positions : le renouveau des congrégations religieuses, notamment
féminines
2
, dévouées à un « souverain étranger », le pape ; l'affaire Dreyfus, qui s'accompagne
d'une offensive contre la République, relayée notamment par les Pères assomptionnistes à travers La
Croix, journal qui se proclame à l'époque « le plus anti-juif de France ».
Les élections de 1902 confirment et élargissent la majorité dont disposent les républicains alors que,
au premier tour, 200 000 voix à peine séparaient les deux blocs. Les candidats ont mobilisé sur la
question de l'avenir des ordres religieux, mais évité le débat sur la séparation. Dominé par les
radicaux, le Bloc républicain obtient 368 élus - dont 48 socialistes - et l'opposition 230. Émile
Combes, franc-maçon, devient chef du gouvernement. Cet ancien séminariste, « le petit père
Combes », connu pour ses positions anticléricales, ne dit pas un mot de la séparation dans sa
déclaration d'investiture. En revanche, il engage une lutte sans pitié contre les congrégations,
tordant au besoin l'esprit de la loi de 1901 sur les associations. Il fait rejeter les demandes
d'autorisation de la grande majorité des congrégations, ferme leurs écoles et finit par interdire
l'enseignement (y compris dans l'enseignement privé) à tous les membres des congrégations, qui
seront nombreux à s'expatrier.
La « vraie religion »
Quand la Chambre des députés décide, au printemps de 1903, de créer une commission sur la
séparation, Émile Combes, on l'a vu, ne cache pas son scepticisme. Il ne s'agit pas seulement
d'opportunisme ou de peur d'engager le pays dans une guerre civile. Le statu quo offre bien des
avantages auxquels une partie des républicains a du mal à renoncer.
Le concordat, signé entre le Saint-Siège et la France le 15 juillet 1801 sous l'impulsion du premier
consul Bonaparte, définissait les rapports entre l’Église catholique unie sous le contrôle du pape -
l’Église constitutionnelle, née de la Révolution, était dissoute - et la République. « Le gouvernement
de la République, affirme le texte, reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est
la religion de la grande majorité des citoyens français. » Cette « reconnaissance » marquait un
progrès majeur, entériné par le pape : le catholicisme n'était plus la religion d’État.
Lors du débat sur la séparation, en 1905, l'abbé Gayraud, qui souhaite l'ouverture d'une nouvelle
négociation avec le Saint-Siège, explique à la Chambre qu'il reste partisan de « l'union de la société
civile et de la société religieuse ». Et critique le concordat, où « l’Église est reconnue non comme la
vraie religion - ce qu'elle est à nos yeux - mais tout simplement comme la religion de la majorité
des Français ».
Le concordat ne fut promulgué que le 8 avril 1802. Entre-temps, Bonaparte faisait rédiger par son
conseiller Jean-Étienne Portalis les articles organiques. Ceux-ci, au nombre de 77, seront édictés
sans consultation avec Rome. La France mettait en place un système très efficace de contrôle
2
- Dans une longue étude sur l'essor des congrégations féminines religieuses au XIXe siècle, Claude
Langlois a montré qu'elles avaient permis aux femmes, dont le code civil affirmait l'infériorité,
d'accéder à des responsabilités en matière d'éducation et de soins hospitaliers. Les méandres de
l'histoire sont parfois surprenants... A méditer quand on évoque la question du foulard. Claude
Langlois, Le Catholicisme au féminin. Les Congrégations à supérieure générale, Le Cerf, Paris, 1984.

policier de l’Église catholique et plus largement des cultes reconnus. Ainsi, aucun concile
catholique national ne pouvait se réunir sans agrément du gouvernement ; les évêques devaient
résider dans leur diocèse et ne pouvaient en sortir qu'avec la permission du premier consul ; l'article
39 imposait même qu'il n'y ait « qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques
de France », etc. Julien de Narfon, chroniqueur catholique libéral, explique, lors du débat sur la
séparation, que le concordat a accentué la soumission de l’Église de France à une double tutelle,
celle de l’État et celle du Vatican.
Renoncer au concordat, et donc aux articles organiques, ne revient-il pas à abandonner le contrôle
de l’État sur l’Église ? Les radicaux hésitent. Ce sont des conflits avec le Vatican qui vont ébranler
« la paix concordataire » et forcer la majorité républicaine à la séparation. Julien de Narfon les
rappelle : « Le premier a été provoqué par la protestation de Pie X contre le voyage à Rome de M.
Loubet [président de la République], le second par la démission imposée par le pape des évêques de
Dijon et de Laval. L'un a abouti à une demi-rupture, l'autre à la rupture complète des relations
entre la France et le Vatican. »
Sur la première affaire, le pape voulait affirmer qu'il restait un souverain temporel et qu'il ne
reconnaissait pas l'annexion de Rome à l'Italie. Une note confidentielle, transmise par le Saint-Siège
à tous les gouvernements, sera rendue publique par L'Humanité, qui la tenait... du prince de
Monaco. Cette ingérence dans les affaires de la République provoqua un scandale à la Chambre qui,
par une majorité de 427 voix contre 96, approuva le rappel de l'ambassadeur français auprès du
pape.
La deuxième affaire aura des conséquences plus graves. Rome fait pression pour obtenir la
démission de deux évêques français mis en cause par leurs fidèles et par le clergé, sans doute pour
leur penchant républicain. C'est tout l'équilibre complexe de « nomination » des évêques qui est mis
en cause
3
. Le 30 juillet 1904, le gouvernement français rend publique sa décision de rompre les
relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Le concordat est désormais lettre morte…
Émile Combes, dans le fameux discours d'Auxerre de septembre 1904, se rallie à l'abolition du
concordat. Mais, mis en cause dans une affaire de fichage des officiers, il est contraint de
démissionner le 14 janvier 1905. Il est remplacé par Maurice Rouvier, un concordataire convaincu ;
c'est pourtant lui qui va présider à la séparation. Entre-temps, Émile Combes a déposé, le 10
novembre 1904, un projet de loi qui suscite de fortes oppositions, même parmi les protestants,
jusque-là amis et alliés des républicains.
Ils contestent notamment l'article 8, qui interdit aux associations formées pour l'exercice du culte de
s'unir en dehors des limites du département, clause qui vise avant tout l’Église catholique tout en
étant une ingérence dans l'organisation des autres Églises. Et aussi l'article 3, qui prévoit que les
biens mobiliers ou immobiliers préposés aux cultes antérieurement reconnus seront concédés,
« pour une période de dix ans », ce qui laissa planer l'idée chez nombre de catholiques que l'on
pourrait leur en retirer la gestion après... En fait, le projet Combes reflète une philosophie qui vise
non seulement à séparer l’Église de l’État, mais à briser l’Église catholique, à la subvertir de
l'intérieur tout en maintenant le contrôle de l’État.
Comme le résumera le pasteur Louis Lafon, directeur de La Vie nouvelle : « Il y a deux façons de
faire la séparation, ou plutôt, en la faisant, on peut poursuivre deux buts différents : ou bien vouloir
laïciser l’État, ou bien vouloir détruire la religion (...). La religion est affaire de conscience,
l'affaire de la conscience individuelle. L’État n'a qu'à s'abstenir complètement de toute
participation et de toute action dans le domaine religieux, et il a le droit et le devoir d'exiger en
retour des Églises qu'elles ne se mêlent pas de vouloir le dominer, de le façonner à leur gré. Je
3
- Sous le concordat, c'est l’État français qui nommait les évêques, l'institution canonique étant
réalisée, après, par le pape. Ce système survit en Alsace-Moselle, faisant du président de la République
le seul chef d’État du monde à nommer des évêques catholiques.

pense que, dans cette appréciation du rôle de l’État vis-à-vis des Églises, je suis en communion
d'idée avec tous les démocrates et un grand nombre de libres-penseurs eux-mêmes. Mais il en est
d'autres qui rêvent de détruire par la loi toute Église et toute religion. Ils nourrissent le rêve
criminel et insensé de tous les despotes, qui, toujours, ont voulu régner sur la conscience humaine
et se sont imaginé qu'ils en deviendraient les maîtres par la violence (...). La liberté d'association
doit être complète pour les catholiques, les protestants, les juifs, aussi bien que pour les libres-
penseurs et les francs-maçons. L'article 8 déjà fort ébranlé doit être jeté par terre tout entier. »
Il le sera. Si la mémoire collective a associé « le petit père Combes » à la séparation, rien n'est plus
éloigné de la vérité. Sous l'impulsion du socialiste Aristide Briand, rapporteur de la commission,
conseillé par le tribun Jean Jaurès, c'est un compromis qui va se dessiner, assurant à la fois la
séparation et la liberté des Églises de s'organiser comme elles l'entendent.
Deux articles ouvrent la loi de 1905. Article premier : « La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après
dans l'intérêt de l'ordre public. » Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun culte. (...) Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets [de l’État, des
départements et des communes] les dépenses relatives à des exercices d'aumônerie et
destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées,
collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »
S'imposent deux remarques. D'abord sur le terme « reconnaissance ». « Il ne signifie
nullement, précise Jean Boussinesq, que l’État nie l'existence de droit (privé) des Églises
comme corps constitués. Il doit être compris en se référant à la situation antérieure où il y
avait en France quatre cultes "reconnus" (catholique, luthérien, réformé, israélite). (...)
L'article 2 signifie donc qu'il n'y a plus d’Église privilégiée en droit et que, par conséquent,
toutes les Églises (présentes et à venir) sont juridiquement égales
4
. » Ainsi, il ne sera plus possible,
contrairement à des situations antérieures, que des évêques siègent de droit au Sénat ou dans les
conseils de l'instruction publique. En revanche, quelques dizaines d'années plus tard, l’État pourra,
sans transgresser la loi et sans choquer les esprits, nommer dans des commissions de réflexion -
comme celle sur l'éthique - des personnalités dont l'appartenance religieuse est connue et affirmée...
D'autre part, l’État met à la disposition des Églises, et notamment de la catholique, un immense parc
immobilier, qui sera de plus entretenu par lui : cela représente, c'est le moins qu'on puisse dire, une
aide directe aux cultes... D'autres modalités seront mises en place, au cours des décennies suivantes,
qui renforceront ces subventions. Au début des années 1920, les pouvoirs publics financeront la
construction de la mosquée de Paris. Rapporteur du projet de loi à la Chambre, Édouard Herriot,
laïque incontesté, expliquera : « Nous ne violons pas la loi de 1905, puisque nous faisons là pour
les musulmans ce qu'en 1905 on a fait pour les protestants ou les catholiques. »
Les deux premiers articles acquis, le débat parlementaire se concentre sur les associations
cultuelles. L'article 4 prévoyait que tous les établissements publics du culte seraient transférés à des
associations « qui se seront légalement formées pour l'exercice du culte ». Mais qui décidera que
ces associations sont réellement habilitées ? Que se passera-t-il si deux associations se disputent ?
La question préoccupe l’Église catholique, d'autant que, parmi les radicaux, beaucoup pensent que
l'occasion est trop belle pour subvertir l’Église de l'intérieur. La méfiance est telle que certains
catholiques soupçonnent les francs-maçons de vouloir noyauter ces associations pour les soustraire
à l'emprise des évêques.
Une œuvre « de raison et de prudence »
4
- Jean Boussinesq, La Laïcité française, Seuil, Paris, 1994. Ce petit mémento juridique est la
meilleure introduction aux lois qui régissent la laïcité.

Chacun des deux camps prête à l'autre les pires intentions. Parmi les républicains aussi se heurtent
différentes philosophies de la laïcité. Le rapporteur de la commission, Aristide Briand, soutenu par
Jean Jaurès, a précisé la sienne. Le projet de la commission, explique-t-il, « n'est pas une œuvre de
passion, de représailles, de haine, mais de raison, de justice et de prudence combinées (...). On y
chercherait vainement la moindre trace d'une arrière-pensée de persécution contre la religion
catholique ». C'est pourquoi il propose d'ajouter un bout de phrase à l'article 4 : les associations
cultuelles devront se conformer « aux règles d'organisation générale du culte dont elles se
proposent d'assurer l'exercice ». Autrement dit, une association qui se crée pour le culte catholique
devra reconnaître les règles internes de celle-ci, notamment la primauté du pape. Et, s'il y a conflit,
les tribunaux civils trancheront
5
... C'est une levée de boucliers dans le camp républicain (lire
« Coupera-t-on les cathédrales en deux ? »). Finalement le vote de l'amendement proposant de
supprimer l'ajout fait par la commission sera rejeté ce même jour par 374 voix contre et 200 pour.
La séparation est faite, dira Jaurès...
Pourquoi les socialistes poussent-ils dans le sens d'un accommodement ? Jean Jaurès s'en était
ouvert dans un article de La Dépêche, le 15 août 1904 : « Il est temps que ce grand, mais obsédant
problème des rapports de l’Église et de l’État soit enfin résolu pour que la démocratie puisse se
donner tout entière à l'œuvre immense et difficile de réforme sociale et de solidarité humaine que le
prolétariat exige. » Il faut apaiser la question religieuse pour poser la question sociale, celle des
grandes réformes en discussion, que les radicaux et les républicains modérés aimeraient repousser :
impôt sur le revenu ou retraites ouvrières...
De cette loi de 1905, du passionnant débat à la Chambre et au Sénat - dont la qualité amène à revoir
un certain nombre de jugements sommaires sur la IIIe République -, la mémoire collective a gardé
quelques images floues, notamment celle d'un affrontement entre « deux France », dont le « drame
des inventaires » avait constitué un des points d'orgue : des policiers forçant la porte des églises.
Au départ, un amendement anodin de la loi, indispensable : puisqu'il y avait un transfert de biens
aux nouvelles associations cultuelles, il fallait procéder à leur inventaire. Mais, dans une instruction
administrative, se glisse une petite phrase qui exige des curés, pour que les inventaires soient
globaux, « l'ouverture des tabernacles », le saint des saints, là où est déposé le ciboire. Ce sont les
nationalistes, ceux notamment de l'Action française, qui joueront un rôle essentiel dans les
« résistances » aux interventions de la police. Ils seront relayés dans quelques départements par des
populations inquiètes et désinformées, traumatisées par les combats du « petit père Combes » contre
les congrégations. Le nombre d'incidents graves est d'autant plus limité que, dès le 16 mars, une
circulaire confidentielle appelle à suspendre les inventaires là où s'organise la résistance. En mai
1906, 93 % des inventaires sont achevés, mais la France gardera la mémoire des quelques
« bavures ».
Le récit des résistances, gonflé par la presse catholique et par les rumeurs, encourage le Saint-Siège
à l'intransigeance, d'autant qu'un pape intraitable, Pie X, a remplacé Léon XIII, décédé le 20 juillet
1903. Le nouveau pape craint que la séparation n'affecte son prestige et serve de « mauvais
exemple » ailleurs, notamment en Espagne. Dans une première encyclique Vehementer nos, datée
du 11 février 1906, il condamne le principe même de la séparation, déplore l'abolition unilatérale du
concordat et la mise en cause par la loi, selon lui, d'un précepte fondamental de l’Église qui serait
« par essence une société inégale, c'est-à-dire une société comprenant deux catégories de
personnes, les Pasteurs et le troupeau ». C'est le 10 août 1906, dans l'encyclique Gravissimo officii,
que le pape ordonne aux catholiques français, plutôt favorables à un compromis sur ce point, de ne
pas créer d'associations cultuelles.
Cette obstruction aurait pu amener le gouvernement à appliquer la loi dans toute sa rigueur, à en
profiter pour porter de nouveaux coups à l’Église catholique. Il n'en fut rien. Il mit en place des
dispositions transitoires visant à assurer que la gestion des lieux de culte catholiques soit laissée
5
- Dans le texte définitif, les conflits devront être portés devant le Conseil d’État.
 6
6
1
/
6
100%