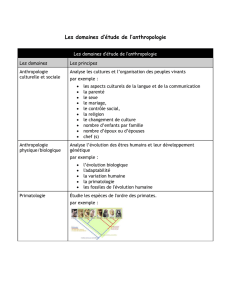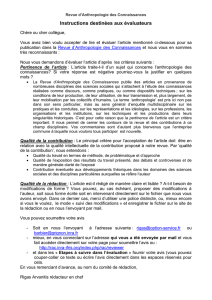Anthropologie urbaine

1
Anthropologie urbaine : entre espace et société
L’anthropologie urbaine a éclaté, comme les autres domaines, anthropologie
politique, économique, religieuse, juridique, de la parenté. Je veux dire que son
objet original, la ville n’est plus et de loin l’objet principal des recherches
aujourd’hui en anthropologie urbaine mais elle n’en constitue que le cadre.
Un autre point : Les domaines de l’anthropologie restent attachés à des « aires
culturelles ». Dans le temps c’étaient les colonies qui déterminaient les terrains
de choix des anthropologues des diverses nationalités sauf pour l’anthropologie
at home où les problèmes sociaux prirent la relève. Aujourd’hui c’est encore
largement le cas. C’est pourquoi l’anthropologie urbaine est un thème développé
avant tout aux Etats-Unis et en grande Bretagne (avec l’exception de Balandier
en Afrique déjà mentionnée) avec les thèmes centraux de l’immigration et des
minorités ethniques et raciales. La globalisation intéresse en premier lieu des
déracinés comme Appaduraï etc
Par ailleurs, qu’on le veuille ou non, l’anthropologie est encore fortement
marquée par la langue d’expression des ses auteurs et par leurs références
culturelles « nationales ». L’anthropologie anglo-saxonne fait peu mention des
auteurs francophones et inversement. Une étude sur le nombre et la date des
ouvrages traduits soit en français soit en anglais (pour ne prendre que ces deux
références majeures) nous donnerait une bonne idée de phénomène. C’est-à-dire
que la date de la traduction marque l’importance accordée aux ouvrages.
Il est frappant de voir des auteurs français se poser la question de savoir si la
France est en retard sur la recherche anglo-saxonne. Je prends l’exemple de
l’ouvrage classique d’un anthropologue américain Ulf Hannerz dont l’ouvrage
« Explorer la ville » a été marquant dans les années 80. Dans l’introduction de la
version française qui date de 1983, le traducteur Joseph écrit p. 7 :
« Le nombre de travaux d’anthropologie urbaine que l’ouvrage d’Ulf Hannerz
présente et discute est impressionnant. Faut-il faire le compte de tous ceux que
le public français ignore ? de ceux qui ne sont pas traduits et de ceux qui sont
quasiment absents des débats de la recherche urbaine en France. Comment le
résultat obtenu sera-t-il interprété : comme un signe de provincialisme
théorique ou comme une absence d’intérêt pour des problématiques qui ont fait
l’histoire de l’anthropologie anglo-saxonne ? »
Vous ne trouverez pas le nom de Hannerz dans le dictionnaire des
anthropologues ni dans les notions clefs. Mais un court article dans le
dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie (pour une fois plus complet)

2
Ulf Hannerz (Suède, 1942). Il a dirigé le département d'anthropologie sociale de l'université de
Stockholm, après avoir été successivement enseignant et chercheur associé à l’université de
Pittsburgh et à l’université de Manchester. Il a travaillé au Nigeria et a consacré une monographie à
la ville de Kafauchan. Depuis ses premières publications en 1967, Ulf Hannerz s’est intéressé aux
problèmes méthodologiques en anthropologie urbaine. Il a notamment publié en 1969 Soulside
consacré au ghetto noir de Washington.
Certains domaines sont nettement plus développés dans certaines « aires
culturelles » et c’est le cas de l’anthropologie urbaine, dans le monde anglo-
saxon. Anne Raulin, auteur du manuel d’anthropologie urbaine (Colin,
2001,2007) et professeur au Laboratoire d’anthropologie urbaine à Paris a
d’ailleurs fait sa thèse aux Etats-Unis ; mais son approche reste française
(historique), du moins dans la première partie puis sociologique.
1.- Anthropologie de la ville (histoire des sociétés urbaines) et
anthropologie en ville (la crise de l’anthropologie exotique et rurale et le
mariage avec la sociologie)
Il est devenu classique d’opposer l’anthropologie de la ville à l’anthropologie en
ville. La première, l’anthropologie de la ville est ce que Anne Raulin présente
dans les deux premières parties de son livre : l’histoire et la naissance des villes
d’une part, et ensuite un essai de définition de ce qu’est la ville et l’urbain. A ce
courant se rattachent les urbanistes, les architectes, les historiens (Mumford sur
l’origine ou la naissance de la ville) (Françoise Choay : L’urbanisme, utopies et
réalités, Seuil, 1965)
L’anthropologie en ville en revanche se penche sur des questions sociales
propres à la ville mais sans analyser la ville en tant qu’objet. Ce qui importe ici
c’est le citadin, son appartenance familiale, ethnique, sociale, son quartier, sa
perception et son occupation de l’espace. L’anthropologie sociale rejoint ici la
sociologie
2.- La ville comme représentation/symbole
Il est possible aussi de considérer la ville comme une représentation sociale,
comme l’expression d’un imaginaire collectif (considéré comme représentatif
d’une conception politique de la ville). Ici interviendraient les conceptions de la
ville en fonction d’une idéologie ou de principes directeurs, conscients ou
non. Je m’explique : la ville peut donner lieu à un décryptage symbolique.
L’organisation spatiale, notamment la présence de bâtiments ou de monuments
symboliques publics (institutions de l’Etat, Temples etc) permet de lire les
« valeurs » d’une ville. Entre urbanisation consciente (planifiée par l’Etat) et
marquage sociaux changeants des quartiers, il est possible de reconstituer une

3
« idéologie » de la ville, dans n’importe quelle partie du globe et contexte
historico-politique. Cité grecque, cités utopiques (Cabet, Fourrier, mais
également cité médiévale, de la Renaissance, cité des Lumières, cité bourgeoise
et industrielle ; Plus récemment les anthropologues se son penchés sur les villes
dans l’ancien espace soviétique (avec leur type d’urbanisation), les villes
symbolisant la force de l’économie (Hong Kong) économiques etc voire sur les
villes comme illustration des relations interculturelles (Giordano)
3.- La ville comme organisation sociale et culturelle de l’espace
Proche de cette conception imaginaire et symbolique, on pourra trouver dans
l’analyse de la ville une projection sociale en fonction de l’occupation des divers
lieux : centre et périphérie, quartiers nobles et quartiers chics, banlieues
résidentielles et banlieues d’immigrés. Ici l’accent est sociologique voire
politique : l’école marxiste française trouve sa place ici avec les travaux de
Lefèvre (Le droit à la ville, 1968), les premiers travaux de Castells (La question
urbaine, 1972) entre autres: on veut lire dans les villes la lutte des classes et
l’exclusion des prolétaires au profit des classes dominantes la marginalisation
des immigrés etc.)
On peut y inclure aussi des études sociologiques quasi phénoménologique
indirectement liées à la ville comme « l’invention du quotidien » de Michel de
Certeau (chapitre VII Marche dans la ville).
Ce thème a également retenu l’attention de l’anthropologie culturelle et de
l’éthologie : l’espace étant perçu à travers des schèmes biologiques et culturels il
faut tenir compte de ceux-ci dans les projets d’urbanisation ou même de
constructions de logements et de bâtiments publics. Des auteurs comme E.T.
Hall dans un livre intitulé « La dimension cachée », s’intéresse à la diversité des
perceptions de l’espace et à l’aspect culturellement relatif de la proximité
(distance qu’observent les différentes « cultures » dans les rapports sociaux,
tolérance à la promiscuité et effet de celle-ci etc.) Dans un chapitre consacré à
villes et cultures il interprète en termes culturels les oppositions que les
sociologues interprètent en termes de classes sociales (par exemple les Noirs
américains). De même il interprète les problèmes « sociaux » urbains en termes
de maladies psychosociales dues au déracinement des nouveaux habitants qui ne
trouvent plus leurs repères spatiaux (surpeuplement, stress, empilement vertical
etc)

4
4.- La ville comme lieu d’observation anthropologique : la naissance de
l’anthropologie urbaine
Jusqu’ici cependant nous n’avons pas affaire à une discipline bien distincte : il
s’agit de faire l’histoire des villes, un inventaire de leur symbolisme, une
sociologie (politique), éventuellement culturaliste de leurs espaces.
Pour que naisse véritablement l’anthropologie urbaine, il a fallu que la ville soit
prise non plus comme objet mais comme terrain : donc une anthropologie dans
la ville. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer avec Balandier notamment, le fait que
la ville apparaît comme le lieu du changement et stimule les anthropologues à
pratiquer l’anthropologie du changement social plutôt que celle de sociétés ou
d’ethnies que l’on pensait figées et hermétiques.
On peut considérer l’anthropologie urbaine aussi bien comme un « progrès » une
ouverture vers de nouveaux terrains anthropologiques que comme un refuge
obligé, un repli, pour ceux qui voyaient disparaître leur terrain rural ou exotique.
En effet, l’anthropologie urbaine n’est pas ou n’est plus l’opposé de
l’anthropologie rurale, comme la société primitive était l’opposé de la société
civilisée ou moderne. Ce qui importe c’est de voir quels sont les objets qui
retiennent l’attention des anthropologues urbains : la plupart du temps ce sont
des groupes marginaux, défavorisés, minorités ethniques, délinquants. On peut
rattacher ce tournant sociologique, voire humanitaire, à deux attitudes, à mon
avis : premièrement la récupération de l’exotisme abandonné – et ce sujet
mériterait un long développement sur les relations entre anthropologie,
développement et travail humanitaire car il fait apparaître un nouveau Grand
Partage entre nous et les autres, sur un mode certes post-colonial, mais où de
nombreuses idées, présentes dans la pensée coloniale, comme précisément celle
du développement, ressurgissent. Mais, ironie du sort, l’anthropologie urbaine
illustre également le transfert en Occident des problèmes attribués jusque-là au
Tiers Monde : mégapoles insalubres, bidons-villes, chômage, délinquance,
corruption etc…
Quant à l’anthropologie de l’espace, elle est évidemment liée aussi à
l’anthropologie urbaine mais elle déborde celle-ci : de nouvelles études
(anglophones) sont ainsi consacrées à l’espace et au lieu « Space and Place » tel
ce Reader qui porte ce nom : the anthropology of space and place avec les
thèmes classiques désormais de centre-périphérie, espace et genre, espaces
contestés, espaces transnationaux etc…

5
5.-Revenons au champ classique de l’anthropologie urbaine et de son
histoire, en isolant 3 volets : l’école de Chicago, l’école de Manchester et
l’école post-moderne ou de la communication et des réseaux à laquelle est
attaché le nom de M. Castells
L’école de Chicago
Elle doit son nom simplement au fait que des sociologues de cette ville ont
été les premiers, dans les 30 premières années du 20e siècle à faire des études
dans le milieu urbain et à considérer ce milieu comme un système ou un
organisme avec sa propre logique (fonctionnalisme) constituant un milieu
(écologie urbaine : milieu déterminant), empruntant (une fois de plus) un
modèle aux sciences naturelles (pp. 70 ss. Raulin/Hannerz : 36-83). Ces
chercheurs ne sont pas passibles de la critique que l’on peut faire aux
anthropologues exotiques repentis car ils ont commencé leurs recherches
bien avant la décolonisation. Ainsi bien avant l’anthropologie dynamique de
Balandier, les sociologues de Chicago considèrent la ville comme le lieu du
changement A noter que la ville de Chicago est une des premières à connaître
aux Etats-Unis des manifestations de rue, des revendications sociales et que
la recherche se concentre sur les effets pervers de la société industrielle.
Les noms de R. Park et W. Thomas sont attachés à cette école. Les objets de
leurs études vont des fumeries d’opium aux maisons de jeux, avec en arrière
fond la recherche sur les relations inter-raciales comme on dit aux USA ou
des maux sociaux comme l’alcoolisme etc. Ils procèdent à des analyses
microsociales dans les quartiers des villes.
La révolution méthodologique consiste à utiliser des documents produits par
la population concernée : notes, documents, autobiographies ou rapports de
personnes en contact avec cette population (médecins, travailleurs sociaux).
Le goupe cible est généralement les communautés d’immigrés mais aussi des
corps de profession (H p. 43) En ce qui concerne la ville de Chicago c’est E.
Burgess qui développera le fameux schéma reproduit partout (Raulin p. 73)
qui fait apparaître des aires concentriques.
Une autre figure classique de cette école est le Hobo de N. Anderson
(1923) : il s’agit d’un travailleur migrant, né aux Etats-Unis mais qui se
déplace dans tout le pays (symbole repris souvent dans la littérature ou le
cinéma). Ici c’est bien évidemment la mobilité le nomadisme qui compte et
qui est étudiée mais au moyen de l’observation participante. Lié au hobo les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%