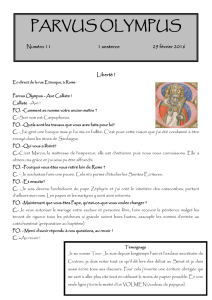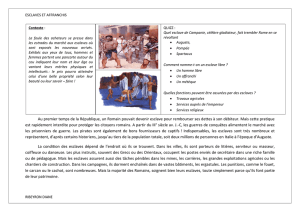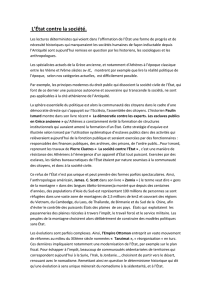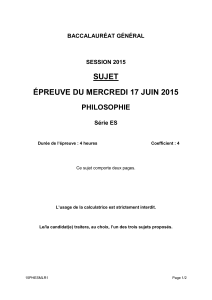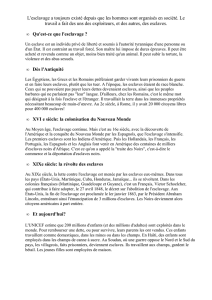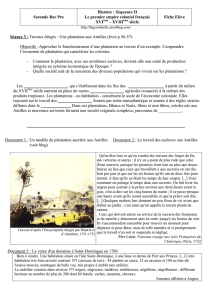La place des femmes dans la division du travail servile

Congrès Marx International V – Section Etudes féministes Atelier 7: Classes, sexe et
« race » dans les Caraibes– Paris-Sorbonne et Nanterre – 3/6 octobre 2007
Caroline OUDIN-BASTIDE
Docteur en histoire et civilisations de l’EHESS
Membre associé du CRPLC (Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe)
LA PLACE DES FEMMES DANS LA DIVISION
DU TRAVAIL SERVILE
(Guadeloupe, Martinique, XVIIe-XIXe siècles)
L’esclavage, selon Claude Meillassoux, engendre une désocialisation conduisant à une
désexualisation qui se manifeste notamment par une indifférenciation des tâches et des
prérogatives dévolues aux individus des deux sexes. Peut-on considérer qu’une telle
désexualisation caractérise la division du travail servile dans la société esclavagiste des Iles du
Vent françaises ?
Je vais tenter de répondre à cette question en limitant le champ de mon analyse au seul
travail effectué au profit du maître sur l’habitation sucrière, lieu principal de l’exploitation
esclavagiste dans les îles de la Caraïbe. Cette limitation de mon propos n’est pas sans
inconvénients dans la mesure où elle m’amène à faire l’impasse sur certaines activités (travail
dans les autres types de plantation mais aussi dans les travaux publics, le commerce etc.), sur
la diversité des statuts serviles (certains esclaves, dont des femmes, travaillent hors de la
plantation en tant que « nègres à loyer ») mais également sur le travail pour soi effectué par
les esclaves pendant les heures « libres » de la journée, le dimanche mais aussi, de plus en
plus fréquemment au fil du temps, le samedi (travail pour soi que je définis comme travail
auto-organisé par l’individu ou par le groupe familial et dont les fruits sont auto-consommés
ou échangés sur le marché dans le but d’acquérir d’autres biens).
Le travail pour le maître sur la plantation peut être divisé en deux catégories : le travail
productif et le travail improductif. Le caractère productif du travail n’est en rien déterminé,
selon Marx, par son contenu – production de biens matériels ou immatériels – mais par la
place du travailleur dans le système productif : seul « le travailleur qui rend une plus-value au
capitaliste » doit être réputé productif. Après avoir analysé la place des femmes dans la
division du travail productif et improductif sur la plantation, nous montrerons que, dans une
société dominée par le « préjugé de couleur », leur position, comme celle des hommes
d’ailleurs mais de façon différente, est fortement corrélée d’une part à leur origine (africaine
ou créole), d’autre part à leur groupe racisé d’appartenance (nègre ou sang-mêlé).
Le travail productif sur la plantation
Dans toutes les colonies esclavagistes d’Amérique, l’atelier (c’est-à-dire l’ensemble
des esclaves fournissant le travail agricole et manufacturier sur l’habitation) est divisé en deux
ateliers (ou bandes), le grand atelier, chargé des gros ouvrages, étant formé des hommes et
femmes les plus robustes, tandis que le petit atelier, auquel sont dévolues les tâches moins
fatigantes, est composé des enfants (entre onze et seize ans), des esclaves âgés, des femmes
enceintes ou nourrices, des convalescents. L’appartenance au petit atelier peut alors revêtir un
caractère dépréciatif : Poyen Sainte-Marie, qui préconise l’intégration des « nouveaux »,
c’est-à-dire des esclaves récemment déportés d’Afrique, dans le petit atelier afin de les
habituer au travail, soutient d’ailleurs qu’ « il faut, pour ainsi dire, se faire prier par le nègre

Congrès Marx International V – Section Etudes féministes Atelier 7: Classes, sexe et
« race » dans les Caraibes– Paris-Sorbonne et Nanterre – 3/6 octobre 2007
Africain pour lui accorder la permission d’entrer dans le grand atelier ». La dévalorisation des
tâches dévolues au petit atelier paraît être le corollaire du prestige attaché par les « nègres de
houe » à la force et à la résistance physiques, prestige qui semble conférer à l’individu la
reconnaissance de l’ensemble du groupe, et même une distinction en son sein. Le grand atelier
réunit au reste la plus grande partie des esclaves dits « nègres de terre » ou « nègres de houe ».
Nulle trace ici d’une division sexuelle du travail : ce sont « les forces » attribuées aux
individus pris individuellement, qui fondent la distribution des tâches agricoles. Ainsi, lors de
la récolte, la répartition du travail entre coupeurs/amarrreurs – qui sera très nettement sexuée
au XXe siècle – ne relève-t-elle que de la force physique : « Les nègres et les négresses, décrit
Granier de Cassagnac, sont munis d’un coutelas bien affilé, de la longueur et de la forme d’un
sabre d’infanterie, seulement tout droit. […] Une autre bande d’esclaves suit les premiers,
ramasse les cannes abattues, et les lie en petits fagots de six à huit bâtons, avec un brin de
paille. »
A la fin de la servitude les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les
rangs des « nègres de houe » et les planteurs prétendent les y maintenir le plus longtemps
possible. Ainsi le conseil colonial de la Guadeloupe s’élève-t-il, en 1846, contre un projet de
décret les dispensant du travail du grand atelier à partir de cinquante-cinq ans, expliquant que
leur durée de vie – soit que le climat ait sur elles des effets moins funestes, soit « que les
habitudes d’une vie moins désordonnée entraînent pour elles une moins grande dépense de
facultés » – est plus longue que celle des hommes et que leurs forces sont toujours
proportionnellement plus grandes que celles d’un homme du même âge.
Pendant la période de la « roulaison », c’est-à-dire de la récolte, les membres de
l’atelier sont affectés, à tour de rôle, par quart, au travail manufacturier de transformation de
la canne en sucre. Au contraire des tâches agricoles, ces tâches manufacturières sont dévolues
aux hommes, à l’exception du service du moulin, entièrement assuré par les femmes si l’on en
croit le père Labat au XVIIe siècle, Ducœurjoly au XVIIIe, Félix Longin ou Roseval au
XIXe. Le père Labat explique d’ailleurs qu’il affecte à cette tâche, à titre de punition, les
hommes « lâches et paresseux » : « Il n’y avoit point de chagrin pareil au leur, ni de prieres et
de promesses qu’ils ne me fissent, pour être ôtez de ce travail qui les couvroit de honte »,
explique-t-il. La spécialisation de cet emploi n’a de fait rien eu d’absolu : en 1790 Dutrône-
Lacouture, auteur d’un traité sur la production sucrière, précise que l’on joint aux négresses
qui faisaient le service du moulin les nègres faibles et peu intelligents. Le père Labat
préconise l’affectation de femmes à l’emploi d’ouvrier rhumier ou vinaigrier, c’est-à-dire
d’ouvrier chargé de la fabrication de l’eau-de-vie appelée « taffia » ou « guildive », « parce
qu’on suppose, dit-il, qu’une femme est moins sujette à boire qu’un homme ». Bien qu’il
s’agisse d’un emploi peu qualifié – il ne nécessite qu’un court apprentissage – et qui
n’entraîne pas de position de commandement le rhumier travaillant généralement seul, ce
conseil a été très inégalement suivi : la présence de deux distillatrices est certes relevée sur
l’habitation Rochechouart à la Martinique mais les neuf vinaigriers répertoriés par N.
Vanony-Frisch à la fin de l’Ancien Régime à la Guadeloupe sont par contre tous des hommes.
Si le travail manufacturier sur la plantation n’est pas sexué de façon rigide, il n’en reste pas
moins que les tâches auxquelles les femmes peuvent être affectées sont des tâches peu
valorisées parce qu’elles exigent tout à la fois peu de force physique et peu de qualification.
L’indistinction sexuelle des tâches disparaît d’ailleurs totalement lorsqu’on analyse la
division verticale du travail technique. Certains textes attestent certes de l’existence de
femmes, « conductrices » ou « commandeuses » à la tête du petit atelier. La présence d’une
conductrice à la tête du petit atelier est ainsi mentionnée dans le projet d’établissement d'une
sucrerie en brut de la partie nord de Saint-Domingue en 1788 comme sa participation à la
récolte à la tête des « amarreurs ». Poyen Sainte-Marie, à la fin de l’Ancien régime, juge les
femmes plus propres que les hommes à occuper cet emploi « tant par la douceur qui est

Congrès Marx International V – Section Etudes féministes Atelier 7: Classes, sexe et
« race » dans les Caraibes– Paris-Sorbonne et Nanterre – 3/6 octobre 2007
l’apanage de leur sexe, que parce qu’elles entendent mieux les soins encore nécessaires aux
jeunes esclaves qui composent cet atelier ». En 1840, le gouverneur de la Martinique affirme
que les travaux des enfants sont dirigés par une « commandeuse » Si la direction du petit
atelier fut effectivement souvent assurée par des femmes, elles ne semblent pas avoir eu
l’apanage de cette fonction, au reste si peu prestigieuse que bien peu d’observateurs en firent
état. Seuls les commandeurs (à la fois contremaîtres et agents de la répression dominicale) et
les raffineurs (qui supervisaient la fabrication du sucre, activité supposant une vraie formation
professionnelle) ont disposé d’un réel pouvoir dans la division verticale du travail.
La production d’un certain nombre de biens et services afférents à la production
sucrière entraîne l’existence sur l’habitation d’une main-d’œuvre plus ou moins qualifiée
bénéficiant d’une relative autonomie : emplois d’ouvriers tonneliers, charrons, menuisiers,
maçons, emplois de muletiers, de cabrouettiers etc. Tous sont occupés par des hommes à
l’exception de celui de l’ « hospitalière », chargée de soigner, sous la direction du chirurgien
ou du médecin de l’habitation, les malades alités dans « l’hôpital » de l’habitation. Il s’agit de
femmes généralement âgées auxquelles le maître, le géreur ou l’économe a voulu confier un
emploi relativement privilégié. Leurs fonctions ne constituent pas, A. Gautier l’affirme avec
raison, « une alternative aux champs » mais plutôt « une porte de sortie honorable pour celles
dont l’utilité n’y était plus manifeste ». Sans qualification professionnelle particulière, elles
jouent d’ailleurs souvent un rôle répressif, d’une part en renvoyant les esclaves jugés
simulateurs au travail, d’autre part en maintenant à la barre les esclaves considérés comme
rebelles ou paresseux, l’hôpital jouant fréquemment le rôle de prison sur l’habitation. Elles
n’étaient en fait bien souvent, si l’on en croit F. Longin qui écrit à la fin de la période
esclavagiste, que de « vieilles négresses sans pitié, à qui le despote [avait confié] une partie de
son autorité ». On peut considérer qu’elles fournissent un travail productif dans la mesure où
elles contribuent, en tant que soignantes et en tant qu’agents de répression, au maintien des
esclaves au travail.
Si le travail des « nègres de houe » – catégorie qui regroupe la plus grande partie des
esclaves et où les femmes sont majoritaires au XIXe siècle – est effectivement désexualisé,
cette désexualisation disparaît donc, au profit des hommes, dès que l’on considère les
fonctions productives distinguées par le maître, fonctions qui apportent des avantages tant
matériels que sociaux, le plus important étant, me semble-t-il, le fait d’échapper à ce que
j’appelle la violence-stimulation, c’est-à-dire à la violence exercée par le commandeur
pendant le travail pour obliger l’esclave à augmenter sa productivité, violence qui assimile
l’être humain à la bête de somme. Si tout esclave peut être victime de la violence-châtiment
lorsqu’il a commis ce que son maître estime être une faute, seuls les « nègres de houe » et
certains esclaves marins – à l’instar d’ailleurs des galériens antiques – travaillent
constamment au rythme du sifflement et sous la menace du fouet.
Le travail improductif sur la plantation
Une partie non négligeable de la population servile des habitations est « détournée »,
pour employer le vocabulaire des administrateurs et de certains colons, du travail productif :
les grands planteurs vivent en effet entourés d’une nuée de domestiques, improductifs au sens
de Marx.
A la fin du XVIIIe siècle Moreau de Saint-Méry constatait déjà qu’il était de la
dignité d’un homme riche d’avoir quatre fois plus de domestiques qu’il lui en fallait et que les
dames créoles avaient un talent particulier à s’environner d’un cohorte de femmes.
Domesticité nombreuse – elle représentait 10 à 15 % de la population esclave dans la seconde
partie du XVIIIe siècle selon certains auteurs – qui participait grandement de la réputation
d’opulence de la société coloniale.

Congrès Marx International V – Section Etudes féministes Atelier 7: Classes, sexe et
« race » dans les Caraibes– Paris-Sorbonne et Nanterre – 3/6 octobre 2007
A la fin de la période esclavagiste la situation n’a guère changé : en 1844 le procureur
général de la Guadeloupe observe qu’il faut un valet pour servir ou garder chaque membre de
la famille créole, père, mère et enfants et qu’il en faut d’autres à chacun des besoins généraux
de cette famille. La dame créole, femme ou fille de grand planteur, ne sort jamais sans être
environnée d’un incroyable état-major de servantes qui ne la quitte d’ailleurs ni jour ni nuit ;
l’enfant lui-même ne saurait se déplacer sans être accompagné d’au moins deux servantes.
Les domestiques sont en effet partie prenante de la consommation ostentatoire, source
essentielle de prestige dans la société coloniale.
Parmi le grand nombre de valets et de servantes entourant les colons et surtout leurs
femmes, tous ne restent pas attachés à la maison du maître. Les domestiques forment en effet,
au moins pour certains d’entre eux, selon l’expression de P. Kolchin, moins « une élite qu’un
contingent générationnel ». Selon l’étude statistique portant sur 8820 esclaves de la
Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime menée par Nicole Vanony-Frisch, l’âge médian de
l’ensemble des domestiques est de vingt-cinq ans, celui des valets de dix-neuf seulement.
Nombre de jolies servantes mais surtout de jeunes valets employés un temps dans la maison
des maîtres sont en fait renvoyés au travail productif, les plus favorisés d’entre eux en tant
qu’apprentis ouvriers. Il est pourtant généralement admis, au XVIIIe comme au XIXe siècle,
qu’une longue pratique d’un emploi domestique, et à plus forte raison le fait d’être né de
parents domestiques et de n’avoir connu que cet état, rend l’esclave incapable de tout travail
agricole. Le renvoi au « jardin » – c’est-à-dire au travail agricole – est d’ailleurs considéré
comme la pire des punitions par les maîtres : des cuisiniers et des cuisinières, des femmes et
des valets de chambre, des domestiques de tout âge, « habitués uniquement au travail
ordinairement assez doux qui se fait dans les maisons, et qui n’en ont jamais fait de très-
pénible », sont journellement, selon Rouvellat de Cussac, « sans l’avoir prévu, envoyés à la
campagne pour y piocher la terre sous le terrible fouet du commandeur ». Ce passage de l’état
de domestique à celui de « nègre de houe » est vécu d’autant plus dramatiquement qu’il ravale
l’individu à l’état de bête de somme stimulée par les coups ou même seulement par le
sifflement du fouet.
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les domestiques (elles
constituent, selon Nicole Vanony-frisch environ 55% de la domesticité). La sexualisation du
travail domestique est la même qu’en France. Certains domestiques produisant des biens
matériels (cuisine, confiserie et pâtisserie, couture parfois) peuvent en tirer des avantages
matériels sur et hors de l’habitation. Sur les quarante cuisiniers répertoriés sur les listes
notariales étudiées par N. Vanony-Frisch, trente-sept sont des hommes. Si de nombreuses
femmes qualifiées de « servantes » faisaient certainement la cuisine sur les habitations, le
prestige attaché à cette fonction semble profiter principalement à des hommes dont la valeur
marchande peut être extrêmement élevée. Réputés « un peu habiles », ils peuvent bien
souvent travailler, selon un rapport de 1842, « pour d’autres personnes que leurs maîtres et du
consentement de ceux-ci » et se constituer ainsi un pécule. Un rapport de 1842 cite l’exemple
d’un cuisinier qui prépare la plupart des grands dîners dans la commune du Vauclin et qui a
acquis ainsi « une espèce de fortune ». Son maître lui a laissé la liberté par testament et il
vient d’acheter pour quinze cents francs comptant, afin de l’affranchir, une femme avec qui il
a une liaison. Nul exemple de ce type n’est donné concernant les couturières qui subissent
d’ailleurs la très forte concurrence des femmes libres de couleur lorsqu’il s’agit de travaux
délicats.
Le travail des domestiques attachés à la personne des maîtres (parmi lesquels les
femmes sont nombreuses) est décrit comme extrêmement inefficace, leur nombre excessif
entraînant une indolence extrême et une division du travail aberrante : « Si madame est
étendue sur un sofa, et que son mouchoir soit tombé à ses côtés, observe Roseval en 1842, elle
appelle une servante, qui en appelle une autre, et l’ordre passe de bouche en bouche jusqu’à

Congrès Marx International V – Section Etudes féministes Atelier 7: Classes, sexe et
« race » dans les Caraibes– Paris-Sorbonne et Nanterre – 3/6 octobre 2007
ce qu’on trouve la femme dont la fonction spéciale est de servir en cette circonstance. Cette
subdivision du travail, accompagné d’une extrême lenteur, soumet la créole exigeante à une
torture de tous les instants. » Au lieu de constituer le « travailleur collectif », la division du
travail exclut ici totalement la coopération. Loin de rationaliser l’activité, la spécialisation de
l’esclave – si l’on peut utiliser ici un tel terme – n’introduit que de l’inefficacité.
Les femmes sont indéniablement majoritaires parmi ce qu’on peut appeler les esclaves
intimes. Certains maîtres, même mariés, s’organisent de petits « harems » – le terme est
utilisé, à la fin de la période esclavagiste, par Rouvellat de Cussac et l’abbé Dugoujon, tous
deux abolitionnistes – formés de servantes plus au moins désœuvrées. La plupart des
célibataires choisissent une « ménagère », à la fois concubine (et souvent mère d’un ou
plusieurs enfants du maître) et femme de charge de la maison, ce qui peut l’amener à exercer
un réel pouvoir sur la domesticité. Cette fonction est cependant fréquemment occupée par une
femme libre de couleur, le remplacement de l’esclave par la femme libre constituant d’ailleurs
un signe extérieur de richesse pour le maître. Les jugements portés sur ces ménagères libres
sont d’ailleurs contradictoires : Ducoeurjoly qui publie au début du assimile la ménagère à
une courtisane qui reste attachée à son amant le temps de le ruiner ; le baron de Wimpffen qui
décrit Saint-Domingue à la fin de l’Ancien Régime affirme pour sa part que les ménagères
« ont de l’intelligence dans l’économie du ménage, assez de sensibilité morale pour s’attacher
invariablement à un homme et une grande bonté de cœur », jugement corroboré en ce qui
concerne la Guadeloupe par Boyer-Peyreleau en 1835. La ménagère est au reste renvoyée si le
maître choisit de se marier : elle bénéficiera alors, dans les meilleurs des cas, si elle est
esclave, d’un affranchissement ou du statut d’esclave à loyer en ville (qui a l’avantage de
l’éloigner de la vue de l’épouse).
D’autres femmes domestiques nouent avec leurs maître et/ou maîtresse des liens
affectifs privilégiés. C’est le cas des nourrices qui bénéficient fréquemment, lorsque les
enfants qu’elles ont nourris atteignent l’âge adulte, d’un affranchissement souvent assorti du
versement d’une pension ou du don d’une petite terre ; affranchis ou esclaves elles restent
dans de nombreux cas attachées au service de leur maîtresse en tant que servantes mais aussi
de confidentes. Ce rôle de confidents peut être également rempli par les esclaves qui ont été
les petits « gardiens » de leur maître ou maîtresse au cours de leur enfance : tout enfant de
bonne famille créole possède en effet individuellement un esclave du même âge et du même
sexe que lui, enfant choisi dans son entourage ou acheté sur un caprice. Quand on donne en
Europe, explique l’écrivain créole Xavier Eyma au XIXe siècle, des poupées et des jouets aux
enfants, « en Amérique on leur fait cadeau d’un petit esclave, espèce de poupée d’ailleurs,
véritable jouet ».
Toute femme blanche (jeune fille ou mariée) passe une grande partie de son temps (y
compris les repas, pris dans sa chambre, loin des regards) avec une favorite désignée sous le
terme de « cocotte ». La cocotte est une sorte de dame de compagnie chargée de divertir la
maîtresse oisive, de la tenir au courant des potins. Elle peut être sa propre nourrice, celle de
ses enfants, la gardeuse de son enfance devenue femme de chambre ou une servante
particulièrement appréciée. Cette fonction est au reste, comme celle de « ménagère » auprès
des hommes, fréquemment occupée par des femmes libres de couleur, souvent choisis parmi
les femmes qui entretiennent une liaison avec un proche de la famille, un frère par exemple.
Nourrices et cocottes sont d’ailleurs souvent dénoncées comme des agents actifs de
corruption des femmes blanches, d’une part parce qu’elles facilitent et dissimulent leurs
liaisons amoureuses, d’autre part – certains textes le disent à mots à peine couverts – parce
qu’elles entreteniennent avec elles des liaisons homosexuelles.
Si les esclaves domestiques bénéficient indéniablement de meilleures conditions
matérielles de vie que les esclaves de l’atelier, leur assujettissement au maître ou à la
 6
6
 7
7
1
/
7
100%