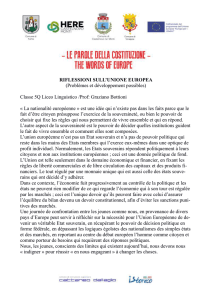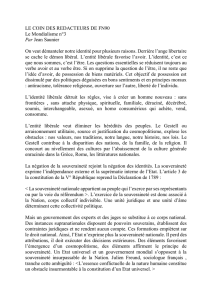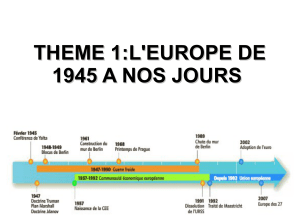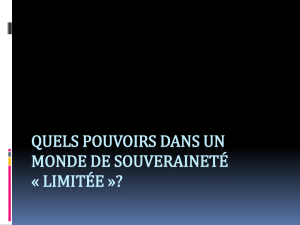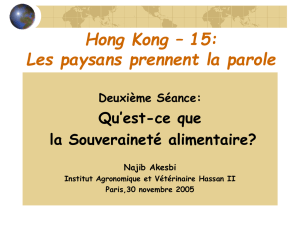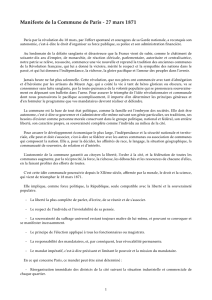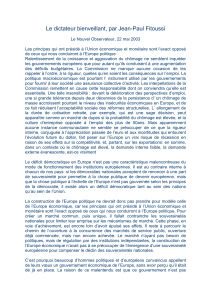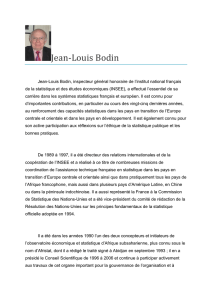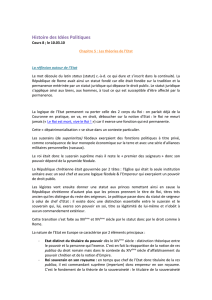T. Berns, Quel modèle théologique pour le politique chez Bodin

1
Quel modèle théologique pour le politique chez Bodin ?
A paraître in : Les origines théologico-politiques de l’humanisme européen, Bruxelles, Ousia.
Thomas Berns
Chargé de recherches au FNRS
Université Libre de Bruxelles
Centre de Philosophie du Droit
Sans nier pour autant l’importance de la rupture moderne, l’enracinement de ses principaux
acquis (sujet, contrat, droit naturel…) dans la pensée médiévale et renaissante a déjà été
souvent mis en évidence. A ce titre, plus personne ne doute du chemin qui nous permet de
remonter de l’individualisme juridico-politique propre au libéralisme classique jusqu’à une
première salve individuatrice qu’on trouve dans le nominalisme occamien. Je souhaiterais
proposer le même genre de trajet en me concentrant sur l’emploi, purement instrumental, de
certains raisonnement propres à la scolastique tardive, qui aurait permis l’émergence de la
théorie de la souveraineté telle qu’on la trouve chez Jean Bodin ; cette théorie étant souvent
considérée comme un de ces miracles, une de ces créations ex nihilo, qui font véritablement
l’histoire de la philosophie.
Jean Bodin lui-même revendique d’ailleurs le caractère inventif de sa démarche : l’objet du
chapitre 8 du premier livre des Six livres de la République est de « former » la définition de la
souveraineté, « par ce qu’il n’y a ni jurisconsulte, ni philosophe politique, qui l’ait definie »
alors que, nous dit Bodin : « j’açoit que c’est le point principal, et le plus necessaire d’estre
entendu au traitté de la Republique »
1
. La rupture bodinienne ne se comprend que comme
relevant à la fois de la découverte d’un objet qu’il affirme comme essentiel (« le point
principal ») et de la mise en place de sa définition
2
.
Le but de cet article n’est pas de remettre en question cette innovation bodinienne, mais a) de
me concentrer sur l’élaboration instrumentale d’une telle rupture philosophique, b) par cette
démarche instrumentale de pouvoir revenir sur cette part cachée –inavouable ?- de l’histoire
de l’Etat de droit par laquelle on se rend compte qu’il y a eu de l’Etat, dans un sens déjà
moderne, avant les droits, autrement dit que souveraineté et légitimité sont nées sans qu’il n’y
ait encore de sujet de droit et peut-être alors même qu’il ne pouvait plus y avoir plus de
citoyen (dans le sens, par exemple, de l’humanisme civique), c) de tenter en conséquence de
penser, hors de la question du sujet de droit, le lien essentiel qui unit l’émergence de l’Etat, et
du droit entendu comme production nécessaire de celui-ci dans la finitude, avec le caractère
absolu de la puissance de Dieu et la conséquente contingence du monde. Bref il s’agira de
suivre l’usage, et son effet, de la distinction entre l’absoluta potentia Dei et l’ordinaria
potentia Dei dans la pensée politique de Bodin, et en particulier dans sa définition de la
1
Je me réfère à la reproduction de l’édition de Lyon de 1593 : Jean Bodin, Les six livres de la République,
(Fayard, Corpus des œuvres de philosophie de langue française, 6 vol, 1986), Livre I, Chapitre 8, p.179
(désormais abrégé sous la forme suivante : Rép. I, 8 , p.179).
2
L’emploi par Bodin de la pensée juridique médiévale est incontestable. Mais le fait d’avoir exporté ces
préceptes juridiques vers ce qu’il appelle lui-même la « philosophie politique » pour en affronter les « mystères »
(Rép., Préface, p.11) n’en reste pas moins novateur.

2
souveraineté, pour analyser dans quelle mesure du théologique intervient dans le divorce du
politique et du théologique.
1) Théologie et philosophie de la nature : la puissance absolue de Dieu.
Il faut avant tout prendre très sobrement acte de la présence de l’argument de la puissance
absolue de Dieu, dans son rapport à la contingence du monde, dans la philosophie de l’histoire
et de la nature bodinienne.
Loin de l’organisation optimiste, rationnelle et individualiste de la Renaissance que nous
décrit Burckhardt, la conception du monde de Bodin affirme sans détour l’existence du
merveilleux, de l’inexplicable et des démons. A ce titre, il s’oppose principalement et
explicitement à Aristote, par la réfutation de toute possible constance et immobilité des lois
naturelles : son ouvrage De la demonomanie des sorciers prend en compte et affirme la réalité
de ce qui est « outre le cours ordinaire de nature » : « il faut donc confesser que cela nous est
clos, et qu’il n’y a que Dieu qui en dispose à sa discretion »
3
. Tout cet ouvrage vise à
maintenir le libre-arbitre de Dieu contre un déterminisme aristotélicien que Bodin, déjà dans
la Methodus, refusait en ce qu’il signifiait la réduction de Dieu à une cause physique : « Quel
scandale philosophique, que de concevoir entre une cause efficiente infinie et un effet fini une
union si intime que l’existence de l’un doive entraîner nécessairement l’existence de l’autre !
Car Aristote raisonne sur le monde et sur Dieu comme il l’a fait ailleurs sur la chaleur et sur le
feu… »
4
. Un tel déterminisme donnerait lieu à l’absurdité d’attribuer à l’homme « une
volonté libre et de la refuser à Dieu »
5
, « ce Dieu qu’il [Aristote] a attaché au monde comme
une éponge à un rocher »
6
.
De la même manière, dans Le théâtre de la nature , le dernier ouvrage de Bodin, rédigé vers
1595-1596, il est proclamé, explicitement contre Aristote, que « rien n’empesche qu’une
cause soit volontaire et aussi contingente »
7
, et ce, avant de s’opposer longuement à l’idée de
l’éternité du monde
8
.
Ces multiples arguments contre la constance des lois naturelles, sur le caractère périssable du
monde et sur la présence du merveilleux et des démons foisonnent dans l’ensemble de
l’œuvre de Bodin
9
. Tous reposent très précisément sur l’idée de la potentia absoluta Dei et la
conséquente contingence du monde. Dans l’Heptaplomeres, écrit vers 1593, nous lisons: « la
Premiere Cause n’est forcée par aucune necessité pour agir, […] elle gouverne touttes choses
avec tant de liberté qu’elle peut, quand il luy plaist, reprimer les emportements des hommes et
des brutes, reigler les corps inanimez, empescher les feux de bruler, bouleverser tout l’univers
et le restablir après à sa fantaisie ».
10
3
De la demonomanie des sorciers, I, vii, p. 53-54 (Paris, 1587, reprint en 1979).
4
La méthode de l’histoire, trad. P. Mesnard, in : Jean Bodin, Œuvres philosophiques, Paris, 1951, p.436 (texte
latin, p.232).
5
Ibid., p.432 (texte latin, p.229).
6
Ibid., p.436 (texte latin, p.232).
7
Le théâtre de la nature universelle, I, iii, p.20 (Lyon, 1597).
8
Ibid., I, iv, p. 37 et svtes.
9
Pour un tableau précis de l’anti-aristotélisme de Bodin, cfr. M. Isnardi Parente, « Le volontarisme de Bodin :
Maïmonide ou Duns Scot » in : Jean Bodin. Actes du Colloque international Jean Bodin à Munich, éd. Par H.
Denzer, Munich, 1973, p.39-51.
10
Colloque entre sept savans, trad. anomyme du Colloquium heptaplomeres, Genève, 1984, p.33.

3
Notons déjà, avant d’en venir à la question de la souveraineté politique, que le trajet de la
puissance absolue de Dieu à celle du prince ne se conçoit pas seulement dans le sens où nous
la suivons, de Dieu vers le Prince, puisque Bodin se base aussi sur le politique (l’impossible
concorde entre deux magistrats égaux) pour réfuter par exemple le dualisme manichéen et la
coexistence de deux infinis
11
, et emploie souvent une argumentation juridique pour définir la
condition de souveraineté de Dieu
12
. Ce mouvement d’aller retour du théologique au
politique, alors même que c’est aussi le moment de leur divorce que nous pouvons cerner
dans le texte bodinien, nous laisse déjà pressentir la valeur instrumentale de l’emploi de
l’argument de la puissance absolue.
2) Philosophie politique : la puissance absolue du souverain.
Bodin, dans ses développements du concept de souveraineté, reconnaît très classiquement
avoir « posé » le prince « comme l’image de Dieu »
13
. J’entends suivre ce passage de Dieu au
prince, dans le cas de la définition de la souveraineté. Le chapitre 8 du Livre I des Six livres
de la République débute par cette définition: «la souveraineté est la puissance absoluë et
perpetuelle d’une Republique » . L’objet de ce chapitre 8 est de « former » cette définition, en
opposant la perpétuité de la souveraineté à l’idée que le prince puisse n’en être que
« depositaire » (Rép. I, 8, p .179-180), et surtout en opposant son caractère absolu à toute
possibilité de partage (refus de toute constitution mixte).
Se référant à Innocent IV, Bodin affirme que la « puissance absolue […] n’est autre chose que
deroger au droit ordinaire », précisant que ce n’est donc pas une dérogation « aux loix divines
et naturelles » (Rép. I, 8, p.193). Nous nous inscrivons ici dans l’histoire longue de la
distinction entre puissance absolue et puissance ordinaire qui fit l’objet d’un chassé-croisé
constant durant le Moyen-Age entre théologie et droit, et dont la Distinction 44 de l’Ordinatio
de Duns Scot représentait un des moments clés en ce qu’il généralise à tous les êtres doués
d’intellect et de volonté la dualité mentionnée entre puissance absolue et puissance ordinaire,
et en ce qu’il lui intègre l’opposition juridique entre fait et droit : « Dans tout ce qui agit par
un intellect et une volonté, et qui peut agir de manière conforme à la loi droite, sans pour
autant agir nécessairement de manière conforme à la loi droite, il faut distinguer la puissance
ordonnée de la puissance absolue. […] cet agent peut agir conformément à cette loi droite, et
dans ce cas, il agit selon une puissance ordonnée[…], mais il peut agir hors de la loi ou contre
elle, et en cela, c’est une puissance absolue, qui excède la puissance ordonnée. Et pour cette
raison, non seulement en Dieu, mais en tout agent libre […] il faut distinguer entre une
puissance ordonnée et une puissance absolue. C’est pourquoi les juristes disent que quelqu’un
peut agir de fait –c’est-à-dire d’après sa puissance absolue- ou bien de droit –c’est-à-dire
d’après une puissance ordonnée selon le droit. »
14
La principale conséquence de ce texte
fondamental étant non seulement la juridicisation de tout ordre librement choisi, mais surtout
11
Le théâtre de la nature universelle, Op. cit., I, vi, p.69-70 : deux infinis contraires « troubleroyent
assiduellement par contraires puissances tout l’accord & harmonie du monde, & s’il n’y auroit rien de plus haut
ou de plus puissant, qui peust par sa Maiesté reprimer & renger deux contraires principes, qui seroyent entr’eux
comme deux egaux magistrats », « veu mesme qu’aux monarchies les plus modérées les magistrats ne peuvent
garder repos ni concorde entre-eux ».
12
Cfr. M. Isnardi Parente, Op. Cit.; p.39 et 40.
13
Rép. I, 10, p.299, cfr. aussi, parmi bien d’autres passages, Rép. I, 8, p. 228.
14
Cité sur base de la traduction d’O. Boulnois dans le recueil de textes La puissance et son ombre, de Pierre
Lombard à Luther, Aubier (Paris, 1994), p.280.

4
sa radicale contingence (puisque la puissance absolue excède toujours la puissance
ordinaire).
15
Mais il est primordial de concevoir la relation analogique à Dieu comme apportant elle aussi
ses limites à la puissance absolue du prince (et ce, hors de l’idée peu opérante que les lois
divines représentent aussi une limitation au pouvoir du souverain, puisqu’il est évident que
cela relève de sa parfaite discrétion) : en effet, d’une manière générale, l’affirmation en tant
que telle de la distinction de la puissance absolue et de la puissance ordonnée, dans le champ
théologique comme dans le champ juridique médiéval et pré-moderne, laisse toujours
entendre l’idée d’un lien ‘libéral’, mais encore seulement consenti, entre l’absolu et
l’ordinaire
16
; et c’est de la sorte qu’il faut concevoir le lien, qui deviendra ensuite toujours
plus légitimant, du pacte à la théorie de la souveraineté.
C’est aussi à travers cette relation analogique que peut se comprendre le fait que le souverain,
quoique au-dessus de ses propres lois, ne puisse librement révoquer ses conventions, serments
ou promesses, qui relèvent du droit naturel, et que Bodin distingue donc nettement, même si
sans grande cohérence, des édits ou lois (cfr. par exemple Rép. I, 8, p.194 et 218) : «veu que
Dieu mesme, comme dit le maistre des sentences
17
, est tenu de sa promesse » (Rép. I, 8,
p.219). Cette référence au Maître des Sentences, à savoir Pierre Lombard, nous ramène donc
une fois de plus au débat sur la puissance absolue de Dieu. Toutefois, pour prometteuse que
puisse paraître la distinction entre convention et loi, elle reste une nouvelle fois peu opérante
dans la mesure où le souverain ne peut être empêché d’agir, ni poursuivi, ni bien sûr
condamné.
Qu’en est-il alors de cet usage, pris dans son sens le plus instrumental et opératoire, du
modèle théologique par le politique ? La question est ici de savoir ce que le modèle
théologique, non pas comme ordre naturel mais comme technique argumentative, offre au
politique.
Le modèle théologique permet à Bodin de développer un concept, celui de souveraineté, que
lui-même déclare nouveau, à l’aide d’une logique qui lui serait propre, en ce qu’elle est propre
à la puissance absolue. En effet, l’analyse du concept de souveraineté, par « raison
nécessaire » (Rép. I, 8, p.192), c’est-à-dire à l’aide de l’argument de la puissance absolue,
offrira à la souveraineté les moyens mêmes dont elle a besoin pour s’assumer dans son
caractère exceptionnel: dès lors, la seule limitation à la souveraineté qui soit tenable (et ainsi
définissante et constitutive) pour la souveraineté est de lui interdire toute auto-limitation, ou
encore d’interdire sa propre aliénation, c’est-à-dire l’aliénation du royaume… un royaume qui
devient ainsi un domaine public, dont l’aliénation est interdite au nom d’un refus de la
contradiction, et non pas au nom d’une distinction du privé et du public. De la même manière,
il s’agit d’interdire à la souveraineté son propre partage, d’où, essentiellement, le refus de
Bodin de toute forme de constitution mixte, etc. Au niveau politique comme au niveau
15
Quant à cette juridicisation de l’ordre, librement choisi par Dieu, et subi par les hommes, il faut noter ici
l’inversion produite par Duns Scot dans la relation entre les deux paires mentionnées : le droit (entendu dans un
sens non pas juridique mais définitoire : être en droit…) relève traditionnellement, et ce sera encore très clair
chez Occam, de la puissance absolue.
16
A ce sujet je renvoie au texte essentiel de F. Oakley, Omnipotence, Covenant, and Order, Ithaca, Cornell
Univ . Press, 1984.
17
C’est-à-dire Pierre Lombard, et non Duns Scot comme l’avance E. Randi (« Lex est in potestate agentis – Note
per una storia della idea scotista di potentia absoluta », in : Sopra la volta del mondo : omnipotenza e potenza
assoluta di Dio tra Medioevo e età moderna, éd. A. Vettese, Bergamo, 1986, p.130).

5
théologique, un des possibles « passages » de la puissance absolue du souverain ou de Dieu à
la puissance ordonnée s’esquisse à l’aide de la difficile relation de la puissance absolue au
principe de non-contradiction.
18
L’absolue puissance du souverain –par exemple l’absolue liberté de donner la loi sans
consentement de qui que ce soit- est donc logiquement toujours développée par Bodin comme
absence de contrainte, ou encore comme liberté négative : la liberté souveraine et absolue de
légiférer se conçoit par « raison nécessaire », comme une liberté ou autonomie vis-à-vis de
toute législation ; et ce, jusqu’à ce que la loi équivaille, toujours logiquement, au « plaisir » ou
à la volonté du prince : le prince n’est pas tenu par les lois de ses prédécesseurs, ni par les
siennes propres, puisqu’il est « impossible par nature de se donner loy » à soi-même (Rép. I,
8, p.192 et 213). Même si les lois du souverain, qui sont bien sûr par nature « revocables »
(Rép. I, 8, p.211) sont « fondees en bonnes et vives raisons », néanmoins, « elles ne dependent
que de sa pure et franche volonté » (Rép. I, 8, p.192). De très nombreux passages de la
République vont dans ce sens, afin de justifier le refus par Bodin de tout partage de la
souveraineté, de toute soumission de celle-ci à des lois positives, dont la puissance est dès lors
directement corrélative à la volonté du souverain : « encore est-il plus estrange, que plusieurs
pensent que le Prince est suject à ses lois, c’est à dire suject à sa volonté, de laquelle
dependent les loix civiles qu’il fait, chose du tout impossible par nature ».
19
Le volontarisme
et la contingence de l’ordre de la loi semblent bel et bien inévitables.
L’anglais rend mieux que le français le fait que la liberté souveraine et absolue de légiférer ne
se conçoive que comme une liberté de toute législation, de manière à reprendre en fait les
deux sens latin de absolvere : rendre parfait, d’une part, et d’autre part, d’une façon plus
moderne qui se dessine ici dans le politique à l’aide d’un modèle théologique: délier, dégager,
affranchir… Citons donc Ullrich Langer, dans ses analyses très inspirantes de la présence
d’arguments issus de la scolastique et du nominalisme dans la littérature seiziémiste : « the
sovereign is only truly free to legislate if he is free from legislation ».
20
Mais l’importance de la loi dans la pensée de Bodin ne s’épuise pas dans cette seule
conception de la puissance souveraine comme dérogation à la loi, telle qu’elle ressort de
manière exemplaire des analyses de Carl Schmitt, selon lequel la naissance du status moderne
et global se résume dans le fait que le prince fut legibus solutus, par opposition au principe de
la légitimité du statu quo de la féodalité (cette relation d’opposition devenant dès lors à elle
seule définissante de la souveraineté moderne) : « ce sont toujours des notions comme
annuler, casser, déroger, dispenser et supprimer des lois et des droits existants que manie
Bodin » et par lesquelles se manifeste la souveraineté, une souveraineté qui subsiste donc
comme simple concept-limite, comme l’originaire du droit nécessairement extérieur au
droit
21
. Or, n’est-ce pas plutôt un certain besoin de droit propre à la souveraineté politique
moderne qu’il s’agit de penser ?
Car, c’est aussi des suites de ce raisonnement mu par l’argument de la puissance absolue, et
non pas certes suite à l’inscription de l’ordre du souverain dans un ordre divin ou naturel qui
18
La constitution mixte peut donc être écartée au nom d’une même logique que Dieu exclut la possibilité d’un
double infini tel que le suppose le manichéisme (cfr. l’exemple mentionné ci-dessus).
19
Livre VI, chap. 4, p.183.
20
U. Langer, Divine and poetic freedom in the Renaissance : nominalist theology and literature in France and
Italy, Princeton University Press, 1990, p.159.
21
C ; Schmitt, Théorie de la constitution, PUF, Paris, 1989, p.182. Cfr. aussi Les trois types de pensée juridique
(Paris, 1995), La théologie politique (Paris, 1988) ou encore, La notion de politique… (Paris, 1992).
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%