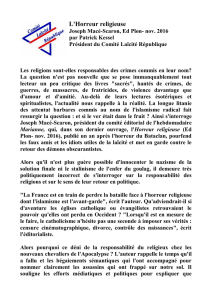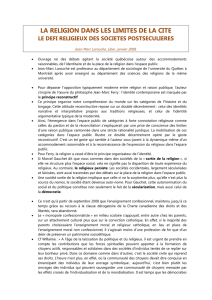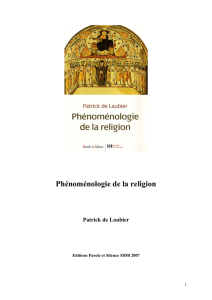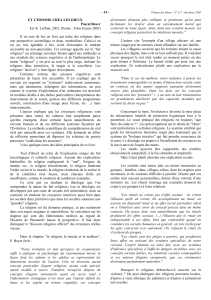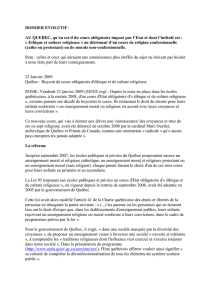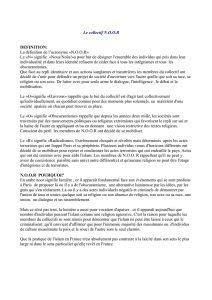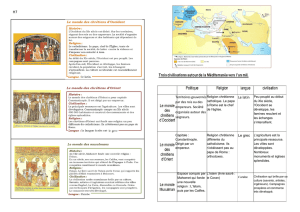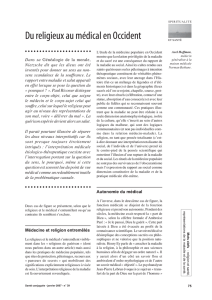Document

Abril-agosto, 2008. Nos. 4 y 5.
ISSN-1870-7289
Derechos Reservados UAEH
Culture occidentale et anthropologie religieuse
Daniel Dubuisson
Directeur de recherche au CNRS (Lille, France)
Si l’on s’en tient simplement aux titres d’innombrables ouvrages et manuels, il
semblerait évident que partout et à toutes les époques des « religions » ont
existé, que l’homme partout et toujours fut « religieux ». Ainsi parle-t-on des
« religions » antiques, africaines, indiennes, préhistoriques, précolombiennes,
monothéistes, etc., comme de phénomènes évidents et indiscutables. Derrière
cette affirmation relative à l’universalité du phénomène religieux se cache
pourtant une question considérable que ces ouvrages le plus souvent se
gardent bien d’aborder : À quelle instance doit-on attribuer cette omniprésence
et cette permanence ? Faut-il admettre que toutes les sociétés, quelles que
soient leur taille et leur organisation, produiraient mécaniquement du
« religieux » ? Ou que c’est au contraire en l’homme, dans quelque obscure
disposition innée, que se trouverait le ressort originel. Bien qu’elles laissent
entier le double mystère relatif à l’origine et à la nature ultime du « religieux »,
ce sont là néanmoins les deux réponses les plus fréquemment mentionnées.
Dans les pages qui suivent, nous ne tenterons de justifier ni l’une ni l’autre,

puisque c’est le principe même de l’universalité du « religieux » que nous
remettrons en cause
1
. Autrement dit, nous voudrions montrer non seulement
que cette épithète conventionnelle et familière n’explique pas grand chose,
mais qu’en plus elle contribue à confiner la réflexion dans une controverse dont
les termes n’ont véritablement de sens qu’au sein de l’histoire de la culture
occidentale.
Un hapax indigène
Comme toute assertion qui repose en définitive sur une tautologie (est
« religieux » tout phénomène ou objet qu’une approche « religieuse » considère
comme « religieux » !), c’est-à-dire qui caractérise une chose par cela même
qu’il faudrait préalablement définir, celle-ci joue à fond sur l’un de nos plus
invétérés préjugés : Chacun de nous croit savoir, au moins intuitivement, ce
qu’est un fait « religieux », puisque, pour nous, la « religion » par excellence, le
christianisme, représente à la fois une chose familière et comme la charpente
centrale de notre culture indigène, celle-là même qui nous a intellectuellement
formés. Aussi cherche-t-on rarement à savoir ce que cet adjectif désigne
exactement « en dernière instance », si cette attribution est universellement
pertinente, ni si un autre terme ne posséderait pas ici ou là une valeur
explicative plus exacte et plus grande. Puisque tout le monde l’utilise et, parmi
ce « tout le monde », les gens les mieux informés, nous attribuons
spontanément une valeur de vérité à cette épithète. Intellectuellement parlant, il
est très difficile de transformer cette proximité foncière, constitutive de nous-
même, afin de placer les objets qu’elle concerne sous un autre éclairage et
selon un autre point de vue. Ces objets familiers (des faits ou des textes dits
« religieux ») ne présentent à nos yeux aucune étrangeté, alors que celle-ci
nous frappe immédiatement quand nous considérons des objets venus
d’ailleurs. « Faits religieux » (et peu importe que nous soyons athées
2
ou
1
On trouvera les développements correspondants à cette thèse dans notre livre L’Occident et la religion
Mythe, science et idéologie, éd. Complexe, Bruxelles, 1998, p. 209-265 (trad. anglaise à paraître en 2003
chez Johns Hopkins University Press sous le titre The Western Construction of religion Myths,
Knowledge and ideology).
2
Les athées « occidentaux » nient l’existence de(s) dieu(x), non celle des aspirations et des créations
« religieuses » de l’homme !

croyants) est pour nous un bibelot familier qui trouve naturellement sa place sur
les étagères de « notre » monde. Et si, par exemple, un Chinois venait nous
dire (dans sa langue que nous aurions apprise pour l’occasion) : « Ces textes
que vous appelez « religieux » sont à rattacher approximativement au genre
des encyclopédies merveilleuses, des spéculations fantastiques ou des fictions
métaphysiques », nous en conclurions sans doute que ce Chinois-là est un
personnage ignare et insolent. L’attribution de cette épithète vaut ici définition et
même transfiguration ; elle exhausse l’objet culturel pour le métamorphoser en
objet « religieux », ce qui revient à le faire sortir du domaine ordinaire des
objets triviaux que la science est capable d’étudier sans prendre de précautions
particulières.
Si l’adjectif « religieux » permet à la rigueur de classer sous une rubrique
conventionnelle un certain nombre d’objets ou de faits familiers, mais est
incapable par lui-même de nous éclairer sur la nature de leurs éléments
constitutifs, leurs lois de composition ou de nous expliciter leurs fonctions
précises, c’est parce qu’il n’est porteur d’aucun programme analytique ou
critique particulier. Autre manière de rappeler que le substantif « religion » et
l’idée correspondante sont une création de la seule « religion » chrétienne, non
le résultat d’une enquête anthropologique comparative. Or cette création a
précédé de plusieurs siècles la naissance de l’Histoire des religions. Par
conséquent, là où la civilisation chrétienne et, avec lui, la doxa disent : « Ce fait
est un fait religieux », l’historien et l’ethnologue doivent répondre que
« religieux » est d’abord une dénomination indigène servant à désigner, dans le
cadre de cette civilisation, ce que cette dernière considère comme « religieux »
conformément à ses dogmes. Ce terme ne possède donc cette pleine valeur
dénotative que là, dans ce contexte précis. En dehors de ce cadre restreint, sa
valeur heuristique est faible, sans parler des multiples malentendus qu’il suscite
ou entretient. Il n’introduit par exemple aucune distance, critique ou autre, entre
l’objet qu’il désigne et ce qu’il signifie lui-même. Au contraire, il écrase cette
distance afin, semble-t-il, de suspendre tout souci d’investigation. Affirmer qu’un
texte ou un événement est « religieux » équivaut à une pseudo-description, qui
calme sans doute notre aversion ou notre anxiété devant tout fait humain qui
serait impensable à force d’être différent ou monstrueux (ainsi comprenons-

nous l’anthropophagie lorsque nous lui attribuons des motifs « religieux », lors
d’un sacrifice par exemple ; alors que partout ailleurs elle nous semble bestiale
et inhumaine), mais qui, globalement, ne nous dit rien d’autre ou de plus précis
que ce que la tradition chrétienne entend par ce terme. En le reprenant à son
compte, la science s’interdit de penser plus ou mieux que ce que la théologie
chrétienne et le sens commun, influencé par elle, ont pu dire avant elle. Tout au
plus a-t-elle pu trouver au « religieux » des causes ou des fonctions triviales
(sociologiques ou psychologiques) ; ce qui, paradoxalement, a pu contribuer à
lui conférer une caution supplémentaire : si le « religieux » dépend de causes
immanentes, comme le marxisme et le freudisme l’affirment, c’est qu’il existe au
moins de cette manière. Et s’il existe pour cette raison, rien n’interdit de penser
qu’il existe également sous une forme supérieure qui échappe, elle, à ces
explications réductionnistes. Ainsi les explications matérialistes et athées,
engagées dans leurs polémiques antireligieuses, rendent-elles souvent un
grand service aux thuriféraires de l’existence d’un homo religiosus intemporel.
Un destin exceptionnel et incomparable
Pour tenter de comprendre ce paradoxe (comment une notion culturelle
indigène a-t-elle pu acquérir le statut d’objet anthropologique et, dans le sillage
de l’Histoire moderne des religions, une valeur descriptive, sinon explicative,
universelle ?), il faut donc redire que la notion de « religion » est une création
originale du christianisme. Avec une acception semblable ou simplement
voisine, elle n’existe nulle part ailleurs, dans aucune autre civilisation. Ni les
Chinois, ni les plus vieux Indo-européens
3
ni même les Grecs ne disposaient,
dans leur langue, d’un terme synonyme ou même simplement périphrastique
désignant le même ordre de phénomènes (le mot « religion », lorsqu’il apparaît
dans une traduction française du Nouveau Testament, ne doit pas faire illusion,
puisqu’il n’est que la traduction abusive de deux termes grecs signifiant
respectivement quelque chose comme « piété » et « culte »). Et si la notion ou
l’idée n’existait pas dans ces cultures païennes, c’est que la chose n’existait
3
Cf. Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, vol. II, Paris, éd. de Minuit,
1969, p. 265-266.

vraisemblablement pas dans les faits : comment un domaine de l’activité
humaine, séparé et distinct des autres selon les exigences sans cesse
réaffirmées de la conception chrétienne, aurait-il pu échapper à l’attention de
ses contemporains au point de rester inaperçu ? À l’inverse, si le « religieux »,
au lieu de représenter un domaine distinct, y était omniprésent et diffus, à
quel(s) titre(s) était-il encore spécifiquement « religieux » ? Dira-t-on, oserait-on
encore dire aujourd’hui que le « religieux » n’est pleinement « religieux » que
dans le seul cas du christianisme ? Dans un ordre d’idées voisin, on notera par
exemple que l’existence d’un substrat « religieux », commun au paganisme et
au christianisme naissant, n’a d’ailleurs pas frappé l’esprit des témoins vigilants,
contemporains de cet événement capital.
Cette acception très particulière accordée par les chrétiens de langue latine au
mot religio
4
aurait pu rester une singularité lexicale comme il en existe tant dans
chaque civilisation : Un hapax culturel (comme dharma en sanskrit ou tao en
chinois) que les érudits et les philologues se plaisent à disséquer. Seulement
celui-ci connut un destin incomparable dont il n’existe guère beaucoup
d’équivalents aussi remarquables dans toute l’histoire de l’humanité. D’abord,
parce qu’il accompagna l’exceptionnel essor et le rayonnement du
christianisme, lequel, pendant des siècles et des siècles, s’exprima en latin. Sa
fortune suivit la sienne, qui fut considérable, et se confondit même avec elle.
Ensuite, parce que l’évangélisation de la quasi-totalité de l’Europe au cours du
premier millénaire puis celle des mondes nouvellement découverts furent
contemporaines des conquêtes militaires et économiques de ceux qui
professaient la foi correspondante. La religion chrétienne devint finalement, à
partir du XVIe siècle, l’apanage de nations qui furent alors les plus
entreprenantes et les plus conquérantes. À l’aube du XXe siècle, dominant la
plus grande partie du monde, elles pouvaient imaginer qu’elles finiraient par
imposer partout leur foi. Et, enfin, parce que cette foi s’estimant être la seule qui
fût vraie
5
, elle ne put propager cette vocation universaliste, catholique depuis la
4
On se souvient que saint Augustin (La cité de Dieu, X, 1) reprochait encore à ce mot son acception
« civique », puisqu’il désignait dans la bouche des Romains cultivés de son temps quelque chose comme
la piété ou le respect filial.
5
« Nulle religion que la nôtre n'a enseigné que l'homme naît en péché, nulle secte de philosophes ne l'a
dit : nulle n'a donc dit vrai. Nulle secte ni religion n'a toujours été sur la terre, que la religion chrétienne »,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%