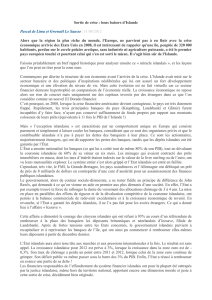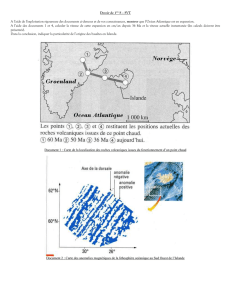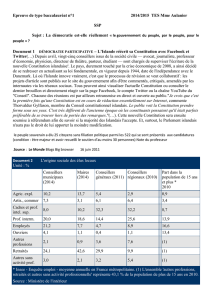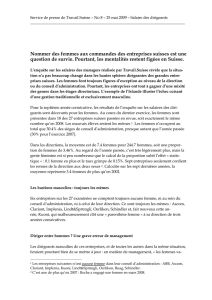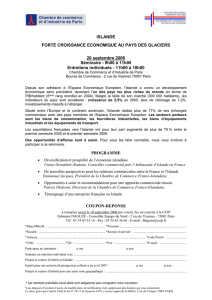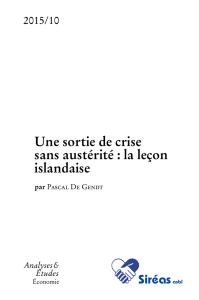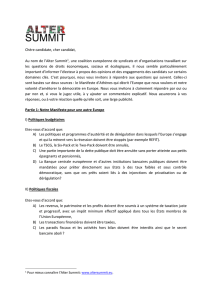Un laboratoire libéral dévasté par la crise

Page 1 sur 7
Un laboratoire libéral dévasté par la crise
Quand le peuple islandais vote contre les banquiers
Aux Etats-Unis, les républicains bataillent pour amputer le budget fédéral ; au Portugal, les autorités
négocient souveraineté contre plan de sauvetage ; en Grèce, la perspective d’une restructuration de
la dette renforce l’austérité. Sous la pression des spéculateurs, les gouvernements ont fait le choix de
l’impuissance. Consultés par référendum, les Islandais suggèrent une autre voie : adresser la facture
de la crise à ceux qui l’ont provoquée.
par Silla Sigurgeirsdóttir et Robert Wade, Le Monde Diplomatique, mai 2011
Petite île, grandes questions. Les citoyens doivent-ils payer pour la folie des banquiers ? Existe-t-il
encore une institution liée à la souveraineté populaire capable d’opposer sa légitimité à la suprématie
de la finance ? Tels étaient les enjeux du référendum organisé le 10 avril 2011 en Islande. Ce jour-là,
pour la seconde fois, le gouvernement sondait la population : acceptez-vous de rembourser les dépôts
de particuliers britanniques et néerlandais à la banque privée Icesave ? Et, pour la seconde fois, les
habitants de l’île ravagée par la crise ouverte en 2008 répondaient « non » — à 60 % des votants,
contre 93 % lors de la première consultation, en mars 2010.
L’issue du scrutin prend une coloration particulière au moment où, sous la pression des spéculateurs,
de la Commission européenne et du Fonds monétaire international (FMI), les gouvernements du
Vieux Continent imposent des politiques d’austérité pour lesquelles ils n’ont pas été élus. La mise en
coupe réglée du monde occidental par les institutions financières libérées de toute contrainte inquiète
jusqu’aux thuriféraires de la dérégulation. Au lendemain du référendum islandais, l’éditorialiste du très
libéral Financial Times s’est félicité de ce qu’il soit « possible de placer les citoyens avant les
banques » (13 avril 2011). Une idée qui trouve encore peu d’écho parmi les dirigeants politiques
européens.
Si l’Islande fait figure de cas d’école, c’est que ce pays offre un exemple chimiquement pur des
dynamiques qui, au cours des années 1990 et 2000, ont permis à des intérêts privés d’édicter des
réglementations publiques conduisant au gonflement de la sphère financière, à son désencastrement
du reste de l’économie et, finalement, à son implosion.
Juste avant la crise, en 2007, tout va encore pour le mieux : le revenu moyen islandais s’établit au
cinquième rang mondial et devance de 60% celui des Etats-Unis. A l’époque, les restaurants chics de
Reykjavík font passer ceux de Londres pour des gargotes. Les articles de luxe inondent les boutiques
et d’énormes 4 x 4 encombrent les rues. Un an plus tôt, une étude internationale classait la population
de l’île comme la plus heureuse de la planète (1). Une grande partie de sa prospérité repose sur la
croissance accélérée de trois banques islandaises. Petites sociétés du secteur public jusqu’en 1998,
elles se hissent rapidement parmi les trois cents plus importantes banques du monde, leurs actifs
passant de 100% du produit intérieur brut (PIB) en 2000 à presque 800% en 2007 — un niveau que
seule la Suisse dépasse.
La crise économique éclate à la fin du mois de septembre 2008 : après la faillite de la banque
d’investissement Lehman Brothers, les marchés monétaires se grippent (2). Dans l’incapacité de
rembourser leurs créanciers, les trois grandes banques islandaises sont nationalisées. Elles accèdent

Page 2 sur 7
alors à un palmarès moins glorieux : celui, publié par l’agence de notation Moody’s, des onze
catastrophes financières les plus spectaculaires de l’histoire.
Au début du XXe siècle, après plus de six cents ans de tutelle étrangère, les structures sociales de
l’Islande demeurent les plus féodales des pays nordiques. La pêche domine l’économie et génère le
gros des entrées de devises étrangères, permettant au commerce de se développer grâce aux
importations. Ce qui, en retour, stimule de nouvelles activités : bâtiment, services et industrie légère.
Après la seconde guerre mondiale, l’économie entre dans une période de croissance plus soutenue, à
la faveur d’une combinaison de facteurs : aide liée au plan Marshall, associée à l’installation d’une
base militaire destinée à accueillir l’armée américaine et l’Organisation du traité de l’Atlantique nord
(OTAN) ; abondance d’un bien d’exportation peu sensible aux fluctuations de revenu des
consommateurs, le poisson d’eau froide ; population peu nombreuse, très éduquée et dotée d’un fort
sentiment d’appartenance nationale.
A mesure que l’Islande s’enrichit, elle jette les bases d’un Etat-providence inspiré du modèle
scandinave, financé par l’impôt. Dans les années 1980, le niveau et la répartition du revenu disponible
atteignent la moyenne des pays nordiques. Cependant, le poids de l’Etat demeure plus prononcé en
Islande que chez ses voisins européens. Tout comme le clientélisme : l’oligarchie locale borne le
paysage tant politique qu’économique.
La société capitaliste moderne de la seconde moitié du XXe siècle s’inscrit dans un lien de filiation
directe avec les structures presque féodales du XIXe siècle. Dans les décennies qui suivent la fin de
la seconde guerre mondiale, quatorze familles — un groupe connu sous le nom de « Pieuvre » —
fournissent l’élite économique et politique du pays. A l’image des chefs de tribu de jadis, elles
dominent les importations, les transports, la banque, les assurances, la pêche et l’approvisionnement
de la base de l’OTAN.
Cette oligarchie règne également sur le Parti de l’indépendance (PI, droite), qui contrôle les médias.
Elle avalise les nominations de hauts fonctionnaires, dans l’administration, la police et l’armée. A
l’époque, les partis dominants (PI et Parti du centre [PC], qui recrute en zone rurale) (3) gèrent
directement les banques locales publiques : impossible d’obtenir un prêt sans passer par l’apparatchik
local. Intimidation, flagornerie et méfiance tissent un réseau de pouvoir imprégné de culture machiste,
prompte à ériger la pilosité en vertu universelle.
L’influence d’un journal étudiant
Mais, à la fin des années 1970, une faction néolibérale vient subvertir de l’intérieur l’ordre traditionnel.
Elle est emmenée par la « Locomotive », du nom d’un journal dont s’emparent des étudiants en droit
et en commerce. Leur objectif : promouvoir les préceptes du libre-échange et se créer des possibilités
de carrière sans attendre la bénédiction de la Pieuvre. Avec la fin de la guerre froide, l’opposition de
gauche ne fait plus recette ; la Locomotive prospère. Elle fournira au pays un premier ministre : M.
David Oddsson (PI).
Né en 1948 au sein de la classe moyenne, M. Oddsson devient conseiller municipal de Reykjavík pour
le PI en 1974, puis maire en 1982. Il mène alors des campagnes de privatisation — dont la vente de la
flotte de pêche municipale — au profit de membres de la Locomotive. En 1991, il conduit le PI à la
victoire aux élections nationales. Devenu premier ministre, il règne sur le pays pendant près de
quatorze ans, et préside à la croissance extraordinaire du secteur financier avant de s’installer aux
commandes de la Banque centrale, en 2004. Ne s’éloignant jamais du marigot politique islandais, il se
tient à l’écart du reste de la société — pour laquelle il ne conçoit pas la moindre curiosité. Son poulain

Page 3 sur 7
au sein de la Locomotive, M. Geir Haarde, ministre des finances de 1998 à 2005, succède en 2006 à
la tête du gouvernement à M. Halldór Asgrímsson, auquel M. Oddsson avait cédé le pouvoir en 2004.
La libéralisation de l’économie islandaise débute en 1994. L’accession à l’Espace économique
européen — la zone de libre-échange des pays de l’Union européenne auxquels se joignent l’Islande,
le Liechtenstein et la Norvège — impose la libre circulation des capitaux, des biens, des services et
des personnes. Le gouvernement Oddsson se lance dans un programme de vente des actifs de l’Etat
et de dérégulation du marché du travail. La privatisation du secteur financier commence en 1998, sous
la houlette de M. Oddsson et du leader du PC, partenaire de la coalition alors au pouvoir, M.
Asgrímsson : la banque Landsbanki est affectée à des dignitaires du PI, cependant que sa
concurrente Kaupthing tombe dans l’escarcelle du PC. Plus tard, une banque privée issue de la fusion
de plusieurs petits établissements, Glitnir, s’installe à la troisième place.
L’Islande passe le cap du millénaire emportée par le souffle d’une finance internationale dopée aux
crédits bon marché. Sur le plan national, trois éléments s’avèrent déterminants : un engagement
politique fort en faveur du secteur ; la fusion des banques d’investissement et des banques
commerciales, permettant aux premières de bénéficier des garanties que le gouvernement offrait aux
secondes ; et une dette souveraine réduite, qualifiant les établissements pour l’indispensable bonne
note de la part des agences de notation internationales. Forts de quoi, les actionnaires majoritaires de
Landsbanki, Kaupthing, Glitnir et de leurs diverses filiales renversent la vieille domination de la
politique sur la finance.
L’administration Oddsson relâche bientôt la réglementation des prêts hypothécaires garantis par l’Etat,
autorisant des emprunts qui atteignent 90% de la valeur d’un bien. Les banques, tout juste privatisées,
se ruent pour proposer des conditions encore plus « généreuses ». L’impôt sur le revenu et la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) baissent, conformément à la stratégie visant à faire de l’Islande un centre
financier international béni par la modération fiscale. La dynamique de bulle s’enclenche.
Les nouvelles élites bancaires islandaises, désireuses d’étendre leur emprise sur l’économie du pays,
s’en donnent à cœur joie. Se servant de leurs actions comme de garanties, elles s’autorisent à
souscrire de lourds emprunts auprès de leurs propres établissements pour procéder au rachat
d’actions... de ces mêmes établissements. Résultat : les cours grimpent. La même opération s’étend
parfois à d’autres banques. Ainsi, les actionnaires de la banque B empruntent auprès de la banque A
pour racheter des actions de leur propre société, avant de rendre l’amabilité à leurs amis de la banque
A, qui procèdent de la même façon. Dès lors, les cours en Bourse des deux banques s’envolent, sans
rapport avec leur activité réelle.
A ce rythme, la petite île s’ouvre bientôt les portes du club des géants de la finance. La surabondance
de crédit permet à la population de célébrer dans l’exubérance la fin des décennies de rationnement
du crédit par le tamis des réseaux politiques : enfin, les Islandais se sentent vraiment
« indépendants ». Ce qui explique peut-être leur sentiment — à l’époque — d’être la population « la
plus heureuse du monde ». Les propriétaires et les dirigeants des banques se rémunèrent de plus en
plus généreusement (un véritable rapt interne au sein des établissements). Et plus ils sont riches, plus
ils bénéficient du soutien des partis politiques — qu’ils financent. Les jets privés déchirant le ciel de
Reykjavík apparaissent alors comme la preuve sonore du succès pour une population qui, depuis le
plancher des vaches, hésite entre l’envie et l’admiration. Les inégalités de revenus et de patrimoine se
creusent, aggravées par des politiques gouvernementales qui renforcent la charge fiscale de la moitié
la plus pauvre de la société. Bref, « les initiatives libérales d’Oddsson sont la plus formidable réussite

Page 4 sur 7
du monde (4) », déclare dans les colonnes du Wall Street Journal l’un des plus ardents défenseurs
islandais de l’économie de marché.
Au début de l’année 2006, pourtant, l’inquiétude pointe. La presse financière s’interroge sur la stabilité
de grandes banques qui commencent à connaître des difficultés pour lever des fonds sur les marchés
monétaires. Le déficit courant de l’Islande bondit de 5 % du PIB en 2003 à 20 % en 2006 — l’un des
niveaux les plus élevés du monde. La capitalisation boursière atteint, en 2007, cinq fois son niveau de
2001. Landsbanki, Kaupthing et Glitnir opèrent déjà bien au-delà de la capacité de la Banque centrale
islandaise à les soutenir en tant que prêteuse de dernier recours. Et ce d’autant plus que leurs dettes
sont réelles, et leurs actifs douteux. En février 2006, l’agence Fitch rétrograde la note islandaise de
« stable » à « négatif » : c’est la « minicrise ». La couronne chute brusquement, à rebours de la valeur
des dettes des banques, qui augmente ; la pérennité des créances libellées en devises étrangères
devient bientôt un problème « public » ; le marché des actions s’effondre et les faillites se multiplient.
La Danske Bank de Copenhague décrit alors l’Islande comme une « économie geyser » sur le point
d’exploser (5).
Les banquiers et les responsables politiques islandais balaient les critiques d’un revers de la main. La
Banque centrale souscrit un emprunt afin de doubler ses réserves de devises étrangères, tandis que
la chambre de commerce — pilotée par les représentants de Landsbanki, Kaupthing, Glitnir et de
leurs diverses filiales — répond par une campagne de communication dans la presse. L’économiste
américain Frederic Mishkin perçoit 135 000 dollars pour apposer son nom sur un rapport écrit presque
entièrement par un économiste islandais, attestant la stabilité des banques de l’île (6). Richard Portes,
issu, lui, de la London Business School, se contente de 58’000 livres pour le même type d’expertise.
Fin 2007, Arthur Laffer, théoricien de l’économie de l’offre, rassure : « L’Islande devrait être un modèle
pour le monde entier (7). » La valeur des actifs des banques atteint alors environ huit fois le PIB.
Aux élections de mai 2007, l’Alliance sociale-démocrate (ASD) (8) forme un gouvernement de
coalition avec le PI, encore dominant. A la consternation de nombre de leurs partisans, les dirigeants
de l’ASD oublient leurs promesses préélectorales et manifestent un soutien sans condition à
l’expansion du secteur financier.
Bien qu’elles aient survécu à la mini-crise de 2006, Landsbanki, Kaupthing et Glitnir peinent toujours à
trouver de l’argent frais pour financer de nouvelles acquisitions et rembourser leurs dettes. Les
banques mettent alors au point deux méthodes pour surmonter leurs difficultés. La première : Icesave,
une invention de Landsbanki. Il s’agit d’un service sur Internet destiné à attirer des dépôts en offrant
des taux d’intérêt plus attractifs que ceux des banques traditionnelles. Fondé au Royaume-Uni en
octobre 2006 et aux Pays-Bas dix-huit mois plus tard, Icesave bénéficie très vite des
recommandations d’autres sites spécialisés dans la finance en ligne et se trouve bientôt submergé par
les dépôts. Des dizaines de millions de livres sterling affluent. Parmi les premiers clients, l’université
de Cambridge, la police de Londres ou encore la Commission d’audit du Royaume-Uni, qui gère les
finances des gouvernements locaux. Sans compter des centaines de milliers de particuliers (trois cent
mille détenteurs d’un compte Icesave rien qu’au Royaume-Uni).
Le fait que les entités Icesave soient établies comme des « agences » — et non comme des
« filiales » — signifie qu’elles se placent sous le contrôle des autorités islandaises, plutôt que des pays
hôtes. Nul ne s’inquiète cependant du fait que l’agence de régulation islandaise ne compte que
quarante-cinq personnes — réceptionniste inclus —, dont la plupart effectuent un stage en vue d’un
recrutement au sein de l’une des banques du pays. Nul ne se soucie davantage de ce que le dispositif

Page 5 sur 7
d’assurance des dépôts de l’Espace économique européen stipule qu’il incomberait à la population
islandaise (trois cent vingt mille personnes) de dédommager les déposants étrangers en cas de faillite.
Seconde solution imaginée par les banques pour avoir accès à de nouvelles liquidités sans avoir à
justifier d’actifs réels : les « lettres d’amour ». Les « trois grandes » vendent des créances à des
banques régionales plus petites qui, à leur tour, les présentent à la Banque centrale pour garantir de
nouveaux emprunts... et prêter aux « trois grandes ». Les créances de départ sont vite surnommées
« lettres d’amour », puisqu’elles se résument à de simples promesses. Le dispositif s’internationalise :
les « trois grandes » créent des filiales au Luxembourg et déposent leurs courriers du cœur à la
Banque centrale européenne (BCE) en échange de liquidités qu’elles renvoient en Islande.
La chute des établissements bancaires islandais survient deux semaines après celle de Lehman
Brothers. Le 29 septembre 2008, Glitnir sollicite l’aide du gouverneur de la Banque centrale, M.
Oddsson. Se voulant rassurant, celui-ci ordonne à son institution de racheter 75% des actions de
Glitnir, ce qui a comme unique effet d’aggraver l’inquiétude. La note du pays dégringole, cependant
que Landsbank et Kaupthing se voient retirer leurs lignes de crédit. Les retraits massifs débutent dans
les filiales d’Icesave à l’étranger. Le 7 octobre, M. Oddsson décide d’indexer la couronne à un panier
de devises. Mais la monnaie plonge déjà, et les réserves de devises étrangères sont vite épuisées.
Sans contrôle des capitaux, l’indexation ne dure que quelques heures. Cela laisse toutefois assez de
temps aux proches du pouvoir pour changer leurs couronnes à un taux favorable. Des milliards
quittent le pays, avant qu’on ne laisse la couronne flotter — ou, pour mieux dire, couler. Le 8 octobre,
le premier ministre britannique, M. Gordon Brown, gèle les actifs de Landsbanki au Royaume-Uni, en
s’appuyant sur des lois antiterroristes passées par le New Labour. La Bourse, les obligations
bancaires, l’immobilier connaissent le même sort que le revenu moyen des Islandais : ils chutent.
Le gouvernement explose
Le FMI arrive alors à Reykjavík. C’est la première fois depuis son intervention au Royaume-Uni, en
1976, qu’il est appelé au secours d’une économie développée. Il propose un prêt sous conditions de
2,1 milliards de dollars pour stabiliser la couronne. Le FMI soutient par ailleurs les exigences des
gouvernements britannique et néerlandais : soumise au dispositif européen de garantie des dépôts,
l’Islande doit dédommager Londres et La Haye (qui ont décidé de renflouer eux-mêmes les clients
d’Icesave sur leur territoire).
Le peuple, habituellement placide, laisse éclater sa fureur. Les mouvements de protestation visent
principalement MM. Haarde et Oddsson, les caciques du PI, ainsi que la ministre des affaires
étrangères, Mme Ingibjörg Gísladóttir (ASD). A plusieurs reprises entre octobre 2008 et janvier 2009,
le samedi après-midi, dans le froid, des milliers de personnes de tous âges se regroupent sur la place
principale de Reykjavík. Les manifestants se donnent le bras pour former une chaîne humaine autour
du Parlement, et tapissent le bâtiment de fruits et de yaourts. Ils exigent la démission du
gouvernement.
En janvier 2009, la coalition entre l’ASD et le PI se brise. Seul exemple de « virage à gauche » dans
un pays touché par la crise financière internationale, un gouvernement d’intérim réunissant sociaux-
démocrates et le nouveau et populaire Mouvement gauche-verts (MGV) se constitue alors. Aux
élections d’avril 2009, le PI n’occupe plus que seize sièges, malgré un système électoral qui le
favorise. C’est son pire résultat depuis sa création en 1929.
La nouvelle coalition se trouve immédiatement sommée de rembourser l’énorme dette d’Icesave aux
Britanniques et aux Néerlandais : c’est la condition préalable à l’aide du FMI. Le gouvernement
 6
6
 7
7
1
/
7
100%