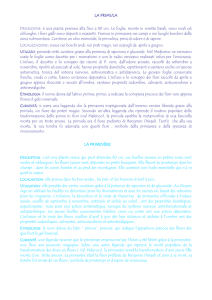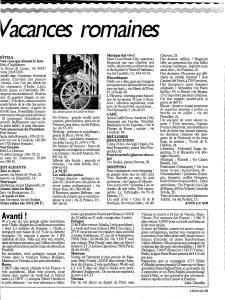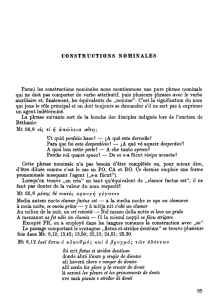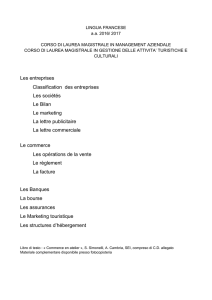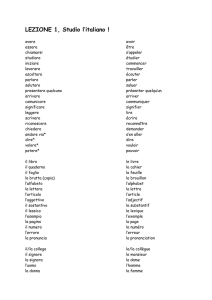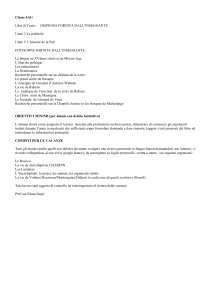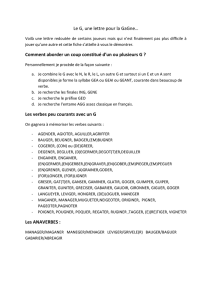LA LITTÉRATURE PAR LE THÉÅTRE Notes pour le cours

1
LA LITTÉRATURE PAR LE THÉÅTRE
Notes pour le cours
(septembre-décembre)

2
LA LITTÉRATURE PAR LE THÉÅTRE
Il corso propone un viaggio attraverso la letteratura francese dal Seicento al Novecento di cui verrà
studiato in particolare il genere teatrale, seguendone l’evoluzione per movimenti, autori e opere.
Elenco dei testi:
Corneille L’illusion comique
Molière Tartuffe
Marivaux Le prince travesti
Diderot Le Fils naturel
Alfred de Musset Lorenzaccio
Romains Knock ou le triomphe de la médecine
Crommelinck Le cocu magnifique
Ionesco Rhinocéros
Beckett En attendant Godot
Una bibliografia critica di riferimento verrà fornita agli studenti tramite fotocopie durante il corso.
Corso incentrato sulla presentazione e per quanto possibile sulla lettura commentata dei testi, nella
convinzione che niente sia più importante della conoscenza diretta del testo in quanto tale nel quale
entrare, da smontare, sviscerare.
Per questo il corso s’intitola “La littérature par le théâtre”: perché noi non facciamo un corso di
teatro né di storia del teatro, o meglio solo tangenzialmente ci occuperemo di aspetti relativi al
teatro in quanto tale, bensì si tratta di un corso di letteratura. MA di letteratura PAR le théâtre,
ovvero attraverso il teatro. Studieremo i testi che gli autori hanno scritto. La storia delle messe in
scena, degli spettacoli cui i testi in questione hanno dato luogo sarebbe l’altro punto di vista, quello
che si affronterebbe in un corso di storia del teatro, laddove il testo sarebbe solo una delle
componenti. Come ben sapete, per poco che siate amanti e spettatori di pièces teatrali infatti,
quando andate a vedere uno spettacolo siete consapevoli che il testo è solo una delle componenti:
poi ci sono, altrettanto importanti, le scelte registiche, le interpretazioni degli attori, le luci, le scene,

3
gli spazi, i tempi, i costumi ecc ecc ecc Tutto quello che rientra sotto il termine onnicomprensivo di
Drammaturgia.

4
PIERRE CORNEILLE
Lettura e commento de L’Illusion comique
I Atto: (prologo)
Esposizione
Luogo
Situazione
Dal punto di vista della struttura: enunciazione del secondo livello di rappresentazione (teatro nel
teatro).
Personaggio del mago: immagine dello scrittore, che opera concretamente attraverso le parole.
Sulla questione delle regole.
La problematica è in quegli anni centrale. Jean Chapelain membro eminente dell’Académie
française per volere di Richelieu, cui egli affidò il piano del Dictionnaire de l’Académie, così come
di redigere le critiche al Cid, a sua volta poeta – rispettosissimo delle regole – autore di un poema
epico dedicato alla Pucelle d’Orléans in 24 canti, Jean Chapelain dunque era in stretto contatto con
i teorici italiani dell’epoca, che elaboravano la dottrina classica scrivendo dei commenti alla Poetica
di Aristotele, e introduceva in Francia le loro teorie.
Corneille era ben al corrente del dibattito in atto, e aveva scritto una commedia intitolata La
Suivante nel 1632-1633 rispettosa delle regole. Ma lo aveva fatto soprattutto per dimostrare che se
voleva sapeva benissimo scrivere nelle regole. Non per questo il suo gusto andava in quella
direzione.
Quando nel 1637 cura la prima edizione della Suivante (anno dunque in cui scrive il Cid),
nell’épître scrive:
“J’aime à suivre les règles, mais loin de me rendre leur esclave, je les élargis et resserre selon le
besoin qu’en a mon sujet et je romps même sans scrupule celle qui regarde la durée de l’action,
quand sa sévérité me semble absolument incompatible avec les beautés des événements que je
décris. Savoir les règles et entendre le secret de les apprivoiser adroitement avec notre théâtre, ce
sont deux sciences bien différentes; et peut-être que pour faire maintenant réussir une pièce, ce n’est
pas assez d’avoir étudié dans les livres d’Aristote et d’Horace”.

5
Nell’ Illusion comique, Corneille dà prova di tutta la sua libertà, sarà poi la querelle scatenata dal
Cid a indurlo a essere più prudente.
Grande disinvoltura rispetto all’unità d’azione.
Unità di luogo per niente rispettata: si passa dalla campagna della Touraine alla grotta di Alcandre,
spostamento che comunque determina un cambiamento di scena, e poi a una piazza di Bordeaux,
poi a una prigione e poi a un palazzo.
Unità di tempo interamente sacrificata: l’azione di cui è protagonsita Clindor è un flash back
rispetto al presente in cui agiscono e dialogano Pridamant e Alcandre, e anche all’interno
dell’azione di Clindor passano vari giorni tra un episodio e l’altro (il duello tra lui e Adraste,
spasimante di Isabelle, ad esempio e l’evasione di Adraste dalla prigione, e passano addirittura vari
mesi tra questa evasione e lo spettacolo di cui Clindor e Isabelle sono gli interpreti).
L’Illusion accumula come una sorta di sfida le irregolarità: ma è evidente che per praticare una
trasgressione così metodica e provocatoria, Corneille doveva conoscere benissimo le regole in
questione.
La sua idea è che la dottrina va conosciuta, ma che a partire da quella bisogna evolvere.
Gli argomenti corrispondono a quelli trattati, nel corso del secolo, dalla Querelle des Anciens et
des Modernes.
Condizioni della prima rappresentazione.
Pare certo che L’Illusion comique andò in scena al Théâtre du Marais, uno dei due principali di
Parigi, l’altro essendo l’Hotel de Bourgogne. Anche le sue pièces precedenti le ha fatte
rappresentare lì, e i successi facevano ombra all’altro teatro che era stato creato, e aveva avuto i
privilèges del Re, prima. Quindi il capo comico dell’Hotel de Bourgogne che si chiamava Bellerose
aveva chiesto una ridistribuzione degli attori e aveva ottenuto che fosse il re in persona, Louis XIII,
a operare in tal senso. Questo per farvi capire che politica d’intervento diretto del sovrano vigesse
rispetto alla vita del teatro. La volontà era quella di dominare direttamente. E siccome in base alla
ridistribuzione degli attori al Théâtre du Marais era toccato un attore molto bravo di nome
Bellemore che recitava da virtuoso la parte del capitano vanaglorioso, il Matamoro per l’appunto,
ecco che Corneille scrive l’Illusion comique pensando a lui.
Quanto alle scene – il décor – della prima rappresentazione, gli studiosi Lancaster americano e
Robert Garapon francese sono riusciti a ricostruirlo.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
1
/
114
100%