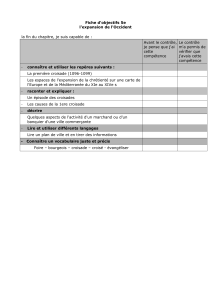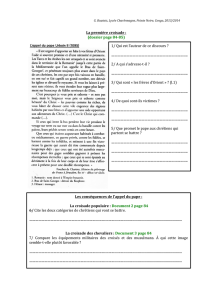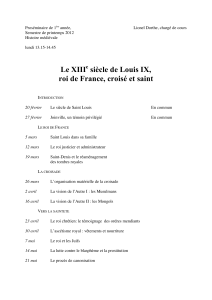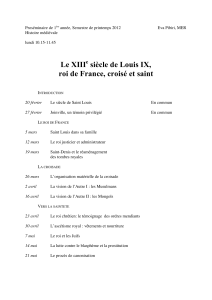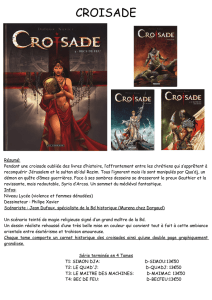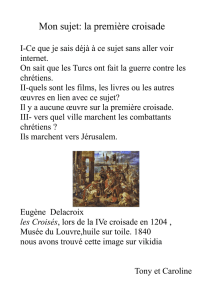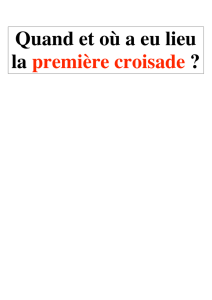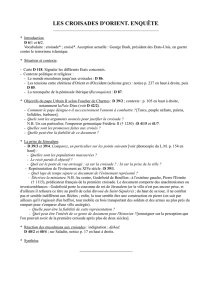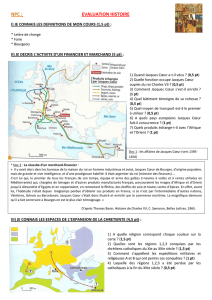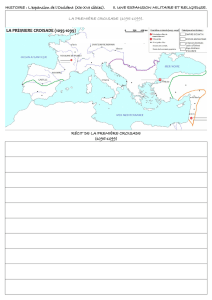1. J`ai préféré ignorer l`expédition de Frédéric II (1228

1. J'ai préféré ignorer l'expédition de Frédéric II (1228-1229)
dirigée par un empereur excommunié et explicitement interdite par
le pape. Bien qu'elle ne puisse pas compter comme une croisade
officielle, elle a néanmoins inspiré la composition de quelques
chansons de croisade allemandes. Ce fait souligne encore une fois
l'impact qu'a eu la guerre contre l'Islam sur la littérature. Les
historiens n'arrivent d'ailleurs pas à se mettre d'accord sur le
nombre de croisades. Généralement, le nombre d'expéditions con-
sidérées comme croisades varie de six à huit.
2. Dans un effort de caractériser brièvement la croisade, R.
Foreville distingue trois traits essentiels, à savoir (et je
5
1. Le cadre théologico-juridique de la croisade
Depuis les premières invasions musulmanes en son territoire, l'Europe
chrétienne a été hantée non seulement par le désir de défendre la foi, mais
aussi par l'espoir de récupérer les territoires perdus et de neutraliser
l'ennemi. Au début, ces activités sont avant tout l'affaire de quelques
seigneurs locaux motivés peut-être en premier lieu par le besoin de dé-
fendre leurs frontières ou d'étendre leur domaine. Au XIe siècle pourtant,
l'Eglise, aspirant à une restauration de l'Ecclesia Universalis, tente de
canaliser tous ces efforts individuels et de contrôler ainsi une force
militaire indisciplinée, source intarissable de troubles. Elle s'efforce
d'envoyer les combattants vers des champs de bataille éloignés, comme
l'Espagne et, plus tard, la Terre sainte, dont la résonance religieuse
suscite de si fortes émotions que bientôt elle semble faire oublier les
autres fronts. C'est en 1095 qu'Urbain II prononce le discours célèbre qui
marque le début des grandes expéditions en Orient qu'on connaît aujourd'hui
sous le nom de croisades. L'idée de la croisade a hanté les pensées des
chrétiens jusque bien avant dans le XVIe siècle. Dans ce qui suit, cepen-
dant, je me limite grosso modo à la période 1095-1271, puisque c'est aux
événements qui ont lieu dans cette période que se rattachent les poèmes que
j'étudie ici. Avant de dresser la liste des croisades il faut préciser que
ce terme s'applique également à des conflits hors de la Terre sainte, par
exemple aux expéditions contre les Albigeois et les Lithuaniens. Bien que
ces guerres partagent en partie la structure et l'organisation de la
croisade en Terre sainte, il dépasserait le cadre de cette étude d'en faire
l'histoire, notre objectif étant d'analyser les textes lyriques qui
chantent les croisades en Orient. A l'exception des chansons composées lors
de la campagne de Thibaut de Champagne en 1239 et d'une chanson anonyme
datant du XIVe siècle, les textes sont tous liés aux grandes expéditions.
Je n'insiste donc pas sur les multiples initiatives privées. On distingue
sept croisades,1 à savoir:
la première 1096-1099
la deuxième 1147-1149
la troisième 1189-1192
la quatrième 1202-1204
la cinquième 1218-1221
la sixième 1248-1254
la septième 1270-1271
Si l'on regarde de près ces grandes entreprises guerrières, qui
s'éche-lonnent sur presque deux siècles (1096-1271), on voit que, malgré
les différences qui les séparent parfois, il y a tout de même des constan-
tes qui subsistent d'une croisade à l'autre.2

cite):
— L'indulgence de croisade. Celle-ci est la plus large possible:
c'est une rémission générale, c'est-à-dire qu'elle est offerte à
tous sans distinction de qualité, d'âge, de sexe; c'est aussi une
rémission plénière, c'est-à-dire qu'elle couvre tous les péchés
dont le pénitent éprouve la contrition de coeur et aura fait
confession de bouche.
— Le statut de croisé, en vertu duquel la protection apostolique
s'étend sur le croisé lui-même, sur les membres de sa famille et
sur tous ses biens: de la sorte, ils relèvent du for ecclésiasti-
que aussi longtemps que le croisé demeure dans son état.
— Des dispositions annexes en vue du recrutement des combattants
et du financement de l'expédition: elles introduisent des modes
plus ou moins étendus de participation aux privilèges spirituels
et temporels du croisé. (Foreville 1969:193)
C'est là une caractérisation très générale qui, quelque utile
qu'elle soit, aura besoin de spécifications supplémentaires.
3. Pour une définition de la notion de guerre sainte, voir Villey
1942:21-2. Selon lui, la guerre sainte serait une guerre menée
pour ou par un pouvoir spirituel, ou pour des intérêts religieux.
On peut penser aux multiples expéditions de Charlemagne contre,
par exemple, les Saxons et les musulmans. La plus fameuse est sans
doute celle qui a inspiré la Chanson de Roland (Fossier 1982:I:377
sqq.). Plus tard s'y ajoutent la Reconquista en Espagne, qui com-
mence déjà au XIe siècle, ainsi que les combats contre les Nor-
mands en Italie, également au XIe siècle. Lors de ce dernier
conflit, le pape Leon IX offre déjà des indulgences aux combat-
tants (Fossier 1982:II:127 sqq.).
4. Précisons que ce terme n'apparaît qu'à la fin du XIIe siècle.
6
Aux temps d'Urbain II, les traits qui distingueront les croisades des
guerres saintes précédentes3 sont déjà présents en germe; ils n'ont pour-
tant pas encore trouvé leur forme définitive. La motivation juridique de
l'expédition qui s'organise après l'appel du pape est encore floue et in-
complète; dans les temps qui suivent, elle sera constamment reprise, retra-
vaillée, adaptée.
A partir du XIIe siècle, les contours théologiques de la croisade et
le statut des participants se dessinent plus clairement. Les canonistes
définissent avec des efforts plus ou moins heureux le cadre de l'expédition
et délimitent soigneusement la condition juridique des crucesignati,4 leurs
privilèges et leurs devoirs. Ce qui à l'origine n'était que coutume finit
par être codifié, dans un long processus qui durera plus d'un siècle et
dont les échos se retrouvent dans la littérature. En témoignent des genres
aussi divers que l'historiographie, l'épopée et la lyrique.
Il me paraît utile d'esquisser dans ses grandes lignes cette évoluti-
on qui en fait commence déjà avant l'époque des croisades proprement dite,
et qui trouvera des échos non seulement dans les nombreuses expéditions
dirigées contre l'Islam, mais aussi, entre autres, dans celles contre les
Cathares et même contre Frédéric II.

5. Ici on pense à l'abbesse Egérie qui, vers 400, fait le voyage
de la Terre sainte. Cf. H. Pétré 1964.
6. Brundage 1969:7.
7. Voir par exemple Van Herwaarden 1974 et 1978.
8. Van Herwaarden 1978:15, Jansen 1978:176, Fossier 1982:II:93, De
Boer 1989:319-20.
9. Villey 1942:85-6.
7
Les origines. Le succès du discours d'Urbain II ne semble pas être dû
à l'originalité de ses idées (qui n'étaient point nouvelles), mais plutôt à
sa façon de présenter et de combiner plusieurs éléments déjà anciens. La
croisade semble le fruit d'une union entre deux occupations qui, bien avant
le XIe siècle, attiraient déjà des milliers de chrétiens, à savoir le pèle-
rinage et la guerre sainte. Ces entreprises ont préparé la voie aux grandes
croisades en Orient qui, mélangeant les aspirations individuelles (attein-
dre le salut) et collectives (défendre l'Eglise et la foi), sont canalisées
dans un cadre fixé par les autorités ecclésiastiques. Afin de tirer au
clair les bases mêmes de ces grands mouvements, il convient de tracer
d'abord les principaux développements de la tradition dans laquelle ils
s'insèrent.
L'histoire des pèlerinages nous est mal connue. On pourrait pourtant
s'imaginer que, dès les premiers temps de l'ère chrétienne, les hommes ont
éprouvé le besoin de visiter le pays où avait vécu le Christ. Les uns s'y
rendent seulement pour 'voir' la Terre sainte,5 les autres partent avec
l'intention de s'y installer définitivement dans l'espoir que le seul fait
de s'établir près de (ou dans) la Jérusalem terrestre, lieu privilégié
entre tous, les rapprochera de la Jérusalem céleste. Sans doute ce voyage
est-il à l'origine un acte volontaire, inspiré par un profond sentiment de
piété.Cela change au VIIe siècle quand les fonctionnaires ecclésiastiques
prennent l'habitude d'imposer le pèlerinage aux pécheurs repentis qui peu-
vent ainsi se racheter.6 Le courant de pèlerins volontaires se trouve
désormais doublé d'un courant où se trouvent des gens qui, pour expier
leurs péchés, ont été envoyés en pèlerinage, en Terre sainte ou ailleurs.
Ces voyages pénitentiels obligatoires, qui ne m'occuperont pas ici, sem-
blent traduire l'idée que Jérusalem est un lieu non seulement de salut,
mais aussi de pardon, idée qui revient dans toutes les croisades.7
A partir du XIe siècle, les pèlerins, qui participent à une oeuvre de
caractère salutaire, sont en général les bénéficiaires de la Pax Dei, in-
staurée par l'Eglise qui tente d'offrir une certaine protection aux hommes
qui, pour quelque raison que ce soit, s'engagent dans une aventure con-
sidérée comme fort périlleuse.8
Vers la fin du XIe siècle, au moment donc où Urbain II prêche la
première croisade, le pèlerinage est plus populaire que jamais. On n'a qu'à
penser à ce grand voyage collectif auquel auraient participé quelque 12.000
fidèles qui, en 1065, quittèrent l'Allemagne dans l'intention d'aller à
Jérusalem.9
A côté de ces mouvements relativement paisibles, l'Europe chrétienne
connaît également une longue tradition d'expéditions armées contre tous

10. Depuis les temps de la première croisade, ce concept idéalisé
connaîtra une popularité immense. Cf. LMA II:1915-6.
11. Jaffé 1956:I:no 2642 (1971).
12. Ici on pense à des textes comme le Poema de Mio Cid et la
Chanson de Roland.
8
ceux qui menacent la Christianitas:10 tous ces ennemis, on les désigne sans
faire distinction aucune par le même nom de 'païens'. Les expéditions qui,
grâce aux encouragements pontificaux dont bénéficient les combattants,
prennent l'allure d'une lutte entre deux religions plutôt qu'entre deux
peuples, sont généralement considérées comme des guerres saintes, guerres
menées pour ou par un pouvoir spirituel, pour des intérêts religieux.
Il faut dire qu'à l'origine la guerre sainte n'est pas encore vue
comme une oeuvre méritoire, digne d'un salut personnel. La dimension
spéciale qu'elle finit par acquérir est le résultat d'une lente évolution.
Un pas décisif est fait par Léon IV qui, en 853, lorsqu'il convoque les
chrétiens au combat contre l'Islam, promet une récompense céleste à tous
ceux qui y perdront leur vie:
Quisquis ...in hoc belli certamine fideliter mortuus fuerit, regna
illi caelestia minima negabuntur. Novit enim omnipotens ... quod pro
veritate fidei et salvatione patriae ac defensione christianorum
mortuus erit.11
S'établit ici donc un lien explicite entre le combat contre l'In-
fidèle et le salut de l'âme. C'est cette idée-là qui fera fortune tout au
long du moyen âge et qui stimulera les hommes à se lancer dans la recon-
quête des territoires perdus.
Pourtant, malgré ses implications religieuses, la guerre sainte
reste, du moins à ses premiers débuts, l'affaire du pouvoir temporel. C'est
ainsi que Charlemagne, qui verra la légitimité de son règne confirmée par
le sacre qu'il reçoit du pape, se constitue presque officiellement défen-
seur de l'Eglise: il accepte, entre autres, la tâche de combattre les
ennemis de la Christianitas. Cette image d'un empereur puissant défenseur
des intérêts de la communauté chrétienne continuera à hanter les esprits.
Les empereurs germaniques tenteront de temps à autre de récupérer la valeur
propagandiste liée à la notion d'advocatus Ecclesiae et se lanceront, eux
aussi, dans la reconquête des territoires perdus à l'Islam. En vérité, ils
ne réaliseront pas grand-chose: leur pouvoir est trop faible. Jusqu'à la
fin du XIe siècle on assiste à toute une série de tentatives destinées à
reprendre aux musulmans ce que ceux-ci avaient (injustement) pris aux
chrétiens. Des reflets de cette interminable série de conflits, parfois
bien locaux, se rencontrent dans l'épopée.12 L'épopée en langue vulgaire
tente volontiers d'accentuer le rôle des seigneurs temporels et de réduire
celui de la papauté. En témoigne le Couronnement de Louis (± 1130-40?). La
littérature embellit ainsi le rôle du prince temporel — et cela bien
souvent pour des raisons purement panégyriques — mais elle ne masque pas le
grand problème de l'Europe chrétienne face à l'Islam: l'Europe n'a pas de
pouvoir central pouvant mobiliser des armées suffisamment importantes pour

13. Ceci ne signifie pas que l'Islam était toujours un bloc
homogène sous commandement central (il s'en fallait de beaucoup),
mais par rapport aux structures militaires de l'Islam, la
chrétienté souffrait d'un éparpillement de forces plus considéra-
ble.
14. C'est à Foucher de Chartres, Robert le Moine, Baudri, évêque
de Dol, et Guibert de Nogent qu'on doit des témoignages qui
semblent avoir été écrits peu de temps après la première croisade,
à savoir entre 1101 et 1109, et qui laissent supposer que leurs
9
affronter, avec succès, l'ennemi 'infidèle'.13
Cette évolution — pour résumer rapidement — permet au pape d'exercer
une influence plus active sur la guerre sainte, influence qui gagne en
importance aux temps de Grégoire VII (1073-85), quand l'empereur allemand,
excommunié, est devenu lui-même un ennemi de l'Eglise. Grégoire déclare
sans ambages que ce n'est pas à quelque chef temporel d'assumer la directi-
on d'une guerre sainte, mais que c'est au pape, seul souverain religieux,
qu'incombe cette tâche. C'est ainsi que pour tout ce qui concerne la guerre
contre l'Infidèle, les chefs laïcs sont tenus d'obéir au souverain pontife
qui, bien qu'il se tienne à l'écart des opérations militaires, s'arroge le
droit de les diriger. Le seul responsable de la guerre sainte, c'est lui.
Vers la fin du XIe siècle il s'est donc établi une tradition de
guerres contre l'Islam (mais aussi contre d'autres 'Infidèles' comme les
Slaves et les Saxons) dans lesquelles, en raison d'un manque de pouvoir
séculier centralisé, le rôle de la papauté devient toujours plus important.
La première croisade. A plusieurs égards, la première croisade semble
n'être qu'une continuation de la longue tradition des guerres saintes, dont
elle reprend non seulement le but et parfois l'organisation, mais aussi
l'idéologie (qui reste d'ailleurs fort implicite) avec ses objectifs
individuels aussi bien que collectifs. C'est, toujours, une guerre faite à
l'instigation de l'Eglise, ayant pour fin la reconquête des territoires
envahis par les ennemis de la foi. Depuis le pontificat de Grégoire VII,
c'est le pape qui, étant le seul à être suffisamment puissant, prend (ou
reprend) l'initiative d'une telle entreprise.
Cependant quelques traits nouveaux distinguent la première croisade
des guerres saintes précédentes; ces traits seront formalisés par la suite
de sorte qu'on verra naître tout un cadre juridique et théologique.
Premièrement, c'est une expédition dans une terre lointaine qui ne confine
à aucun royaume chrétien: la Terre sainte est entièrement encerclée par des
forces ennemies. Il n'y a donc pas de souverain européen qui puisse faire
valoir des prétentions territoriales personnelles. Ce fait accroît l'influ-
ence pontificale.
La deuxième nouveauté, bien plus importante, concerne la nature et la
destination de l'expédition. D'abord il faut dire que nous n'avons que des
idées peu précises des intentions d'Urbain. Les actes du concile de Cler-
mont sont perdus, et il ne nous reste que des sources indirectes, moins
fiables. Seulement deux lettres d'Urbain (postérieures au concile), l'une
adressée aux Flamands, l'autre aux chrétiens de Bologne, fournissent quel-
ques renseignements au sujet de la motivation idéologique de la croisade.
Quant au reste, on doit se contenter de l'information fournie par les qua-
tre chroniqueurs qui ont relaté les événements de Clermont.14 Il ne faut
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%