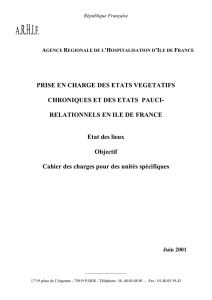États Végétatifs Chroniques et Pauci-Relationnels : Livre Blanc
Telechargé par
francois08

Regards croisés de familles et de professionnels
sur la vie au quotidien dans les unités dédiées
LIVRE BLANC
ÉTAT VÉGÉTATIF CHRONIQUE,
ÉTATS PAUCI-RELATIONNELS

2
Livre blanc

3
Livre blanc
TABLE DES MATIÈRES
PRÉFACE par Emmanuel Hirsch
AVANT-PROPOS par Philippe Petit et François Tasseau
GENÈSE DE LA CIRCULAIRE DU 3 MAI 2002 par les docteurs
Bruno Pollez et Philippe Denormandie, et Jean Barucq
PRÉSENTATION DU LIVRE BLANC par Anne Boissel
LE LIVRE BLANC
TÉMOIGNAGES DE FAMILLES
Édith, épouse
Christine, mère
Yves, ls
Fabienne, mère
Claude, frère
Jeanne, mère
TÉMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS
Sylvie, assistante sociale
Isabelle, médecin
Jérôme, psychologue
Claire, médecin
Laurie, aide-soignante
Camille, médecin
REGARDS D’EXPERTS
Élisabeth Zucman, Analogies avec les questions
posées par le polyhandicap de l’enfant
Edwige Richer, L’engagement d’une vie professionnelle
au service de l’accompagnement
INDEX DES PRINCIPAUX SIGLES
P.4
P.8
P.10
P.12
P.15
P.16
P.16
P.24
P.31
P.43
P.37
P.48
P.56
P.56
P.65
P.72
P.80
P.88
P.94
P.105
P.105
P.108
P.114

4
Livre blanc
LORSQUE LES « GRANDES FRAGILITÉS »
IMPOSENT UNE EXIGENCE POLITIQUE
Auprès de la personne en situation de vulnérabilité
Qu’on ne s’y trompe pas, ce « livre blanc » est un acte politique. Il ne se limite pas à la compilation
de témoignages, certes essentiels, et à poser des revendications étayées par une étude scientique
exigeante et pertinente. Il nous est indispensable dans sa restitution de ces territoires si difcilement
accessibles aux conns de ce que représente la condition humaine, lorsque la personne éprouve
l’extrême du handicap et des dépendances, au point de ne plus être dénie en des termes qui
afrment encore la plénitude de son humanité. C’est dire à quel point ce « livre blanc » s’avère
important et précieux dans ce contexte politique où la dignité humaine est à ce point bafouée que
le Conseil constitutionnel a estimé nécessaire de nous rappeler, dans une décision du 6 juillet 2018, la
signication du « principe de fraternité ».
Depuis quelques années, à travers des controverses bien discutables dans l’actualité judiciaire, nous
avons appris à mieux comprendre les responsabilités et les dés auxquels les personnes dites en «
état d’éveil sans conscience (ou minimale) » nous confrontent. Leur vulnérabilité en appelle de notre
part à l’expression d’obligations morales et de considérations politiques dès lors que le l de leur
existence tient aux égards et aux solidarités que nous leur témoignons. La vérité insoupçonnée d’une
vie hors de nos représentations et même de ce qui nous paraît a priori humainement concevable
et acceptable a émergé aux conns des pratiques soignantes : ces personnes nous imposent une
considération et une réexion plus exigeante et fondée que la compassion.
À propos de leur accueil parmi nous, de leur accompagnement à domicile ou en établissement
ainsi que des soins qui leur sont prodigués, Il n’est plus recevable aujourd’hui, comme l’ont fait deux
parlementaires, d’afrmer de manière péremptoire et sans la moindre précaution que « ces personnes
pourraient qualier ces situations d’obstination déraisonnable si elles pouvaient s’exprimer1 ». Ces
personnes lourdement handicapées mais également leurs proches et les soignants auprès d’elles
pour un parcours de vie et de soin dont la signication mérite mieux que des disputations distanciées
et une telle stigmatisation, et dont l’échéance ne se décrète pas selon l’application d’un texte de
loi, justient de notre part une sollicitude qui ne se circonscrit pas à l’arbitrage des conditions de mise
en œuvre de l’arrêt de leurs soins.
Aucune instance n’a autorité à « penser » comme s’il s’agissait d’une évidence, que, totalement
dépendantes et entravées dans leurs facultés relationnelles, la persistance de leur vie relève d’une
« obstination déraisonnable » qui justierait le renoncement. Sans quoi il conviendrait de renoncer
à réanimer toute personne dont on estimerait a priori qu’elle ne retrouverait pas son autonomie, et
de s’interroger sur le statut et les droits des personnes en phase évoluée de maladies neurologiques
évolutives à impact cognitif, comme la maladie d’Alzheimer... Il n’est pas acceptable de se laisser
contraindre par des dilemmes approximatifs qui, plutôt que de favoriser une approche personnalisée
et circonstanciée de réalités humaines à ce point singulières, énigmatiques et tragiques, ne nous
inciteraient qu’à l’échappatoire, au « moindre mal » dont on comprend qu’il imposerait l’abandon
1Alain Claeys et Jean Leonetti, Rapport de présentation de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des
malades et des personnes en n de vie, Assemblée nationale, 12 décembre 2014.
PRÉFACE

5
Livre blanc
systématisé. Près de 1 700 personnes vivent en état dit « pauci-relationnel » (EPR) ou « végétatif
chronique ». Sans autre forme de procès, leur existence découverte dans les dédales d’une actualité
douloureuse incite certains, dans l’effroi, à revendiquer pour eux une « mort dans la dignité »… Faute
d’avoir pris le temps de faire un détour côté vie, auprès des proches de ces personnes ou dans les
établissements qui les accueillent sans donner le sentiment de s’acharner à maintenir abusivement
en vie des mourants. Car c’est bien à des personnes en vie, à des membres de notre cité, certes
en situation de vulnérabilité comme d’autres le sont, que s’adressent ces signes de considération et
d’affection dans le quotidien et la justesse d’un soin digne des principes de respect et de solidarité
que prône notre démocratie.
Le fait même d’avoir à recourir à une désignation comme celle d’« état végétatif chronique » ou
« pauci-relationnel » en dit long, du reste, de notre difculté à se représenter ce que certains ont
décidé d’emblée – sans même avoir tenté une approche ne serait-ce que par sollicitude et an
de mieux comprendre – de considérer insupportable, voire « indigne d’être vécu ». Un médecin
réanimateur les avait même considérées comme des « intermédiaires entre l’animal et l’homme »,
provoquant le 24 février 1986, à la suite d’expérimentations pratiquées sur elles dans des conditions
éthiquement irrecevables, un avis de Comité consultatif national d’éthique, en devoir de préciser : «
Ce sont des êtres humains qui ont d’autant plus droit au respect dû à la personne humaine qu’ils se
trouvent en état de grande fragilité2. »
« La personne malade a droit au respect de sa dignité » : cette référence à la loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé doit s’appliquer de manière
inconditionnelle à toute personne, quelles que soient ses altérations cognitives et l’amplitude de ses
handicaps. Cette même loi précise : « Les professionnels mettent en œuvre tous les moyens à leur
disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. » Ainsi, deux mois après son vote,
une circulaire du ministère chargé de la Santé prescrivait le 3 mai 2002 les conditions de « création
d’unités de soins dédiées aux personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel ».
Le concept de « soins prolongés » y est évoqué en tenant compte de ses spécicités : ils s’adressent
à des personnes « atteintes de maladies chroniques invalidantes avec risque de défaillance des
fonctions vitales, nécessitant une surveillance médicale constante et des soins continus à caractère
technique ». Des professionnels compétents ont su en effet développer au sein des structures
spéciquement dédiées de médecine physique et de réadaptation une expertise indispensable. Le
contexte est certes douloureux, complexe et incertain ; il n’en sollicite que davantage une qualité
d’attention et de retenue tant à l’égard de la personne en état de conscience minimale que de ses
proches.
Affronter les enjeux du point de vue de nos valeurs
Se pose la question du pronostic, lorsqu’à la suite d’un accident vasculaire cérébral ou d’un
traumatisme crânien les séquelles sont susceptibles de compromettre la qualité de vie de la personne
et ses facultés relationnelles. Il serait intéressant d’évaluer dans les pratiques les conséquences
d’évolutions tant législatives que du point de vue de l’imagerie fonctionnelle : cette approche
médicale devrait être réalisée en tenant compte de paramètres ou de déterminants propres à ces
états de handicaps, comme leurs uctuations possibles et l’incidence des conditions mêmes de
réalisation des investigations. Tout semble indiquer cependant que les décisions s’envisageraient
désormais en amont, dans les premières heures, ne serait-ce qu’avec le souci d’éviter l’engrenage
de situations estimées insupportables. Le doute est-il alors favorable à la survie de la personne alors
qu’elle aura rarement anticipé une réalité aussi catastrophique et qu’il est humainement impossible
de se la représenter ? Les proches sont-ils à même d’exprimer un point de vue avéré, alors que
l’impact d’un tel désastre que rien ne permettait d’envisager bouleverse leurs repères et les soumet
à des dilemmes sans véritable issue satisfaisante ? Serait-il possible de dénir un seuil temporel au-
2 « Avis sur les expérimentations sur des malades en état végétatif chronique », Comité consultatif national d’éthique, avis no
7, 24 février 1986.
PRÉFACE
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
1
/
116
100%
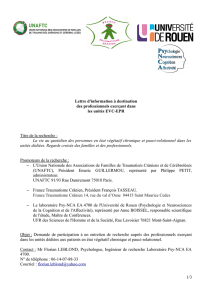
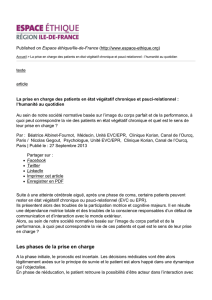

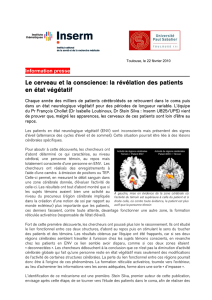
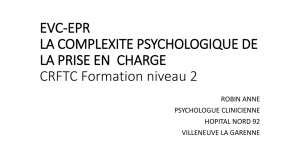

![CH Tournon [Mode de compatibilité]](http://s1.studylibfr.com/store/data/006953008_1-28559e2b85851ef669c00e2f505f207f-300x300.png)