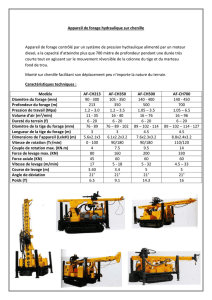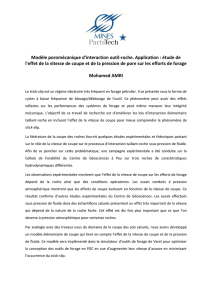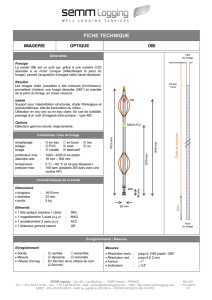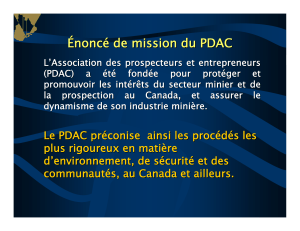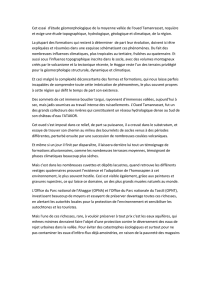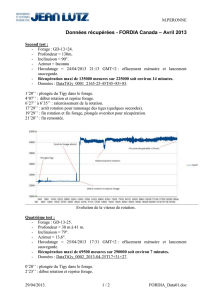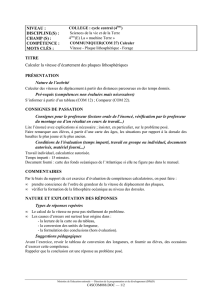UNE CONSCIENCE DE BASSIN
VOLUME 2
H
HY
YD
DR
RO
OG
GE
EO
OL
LO
OG
GI
IE
E
Octobre 2002
SYSTEME AQUIFERE DU SAHARA SEPTENTRIONAL

2
Table des matières
1. Préambule
1.1. Apport des études antérieures et définition des réservoirs adoptés
1.1.1. Les études régionales
1.1.2. Les études algériennes
1.1.3. Les études tunisiennes
1.1.4. Les études libyennes
1.2. Collecte et synthèse des informations géologiques et hydrogéolgiques dans le cadre du
projet SASS
1.3. Répartition spatiale des données
1.3.1. Les données algériennes
1.3.2. Les données tunisiennes
1.3.3. Les données libyennes
12
13
13
14
14
15
16
17
17
20
21
2. LES FORMATIONS AQUIFERES DU SAHARA SEPTENTRIONAL
2.1. Colonnes lithostratigraphiques dans les trois pays (identification des formations
aquifères)
2.1.1. Algérie
2.1.2. Tunisie
2.1.3. Libye
2.2. Carte des affleurements des principales formations aquifères
2.3. Coupes NS et EW: Structure géologique, extensions horizontale et verticale des
aquifères
2.3.1. Coupes Ouest-Est
2.3.2. Coupes Nord-Sud
2.3.3. Extensions horizontale et verticale des aquifères du Continental intercalaire
2.3.3.1. Extension horizontale vers l'oust: le Bassin du Grand Erg Occidental
2.3.3.2. Extension horizontale vers l'Est et le Sud-Est en Libye
2.4. Géométrie des aquifères principaux :
2.4.1. Carte isohypse du toit du Continental intercalaire
2.4.2. Carte isohypse du mur du Continental intercalaire
2.4.3. Carte isobathe des épaisseurs du Continental intercalaire
2.4.4. Géométrie des couches semi-perméables intercalaires
2.5. Effet de la structure géologique sur les aquifères
2.5.1. En Algérie
2.5.1.1. Bassin du Grand Erg Occidental
2.5.1.2. Flexure sud-atlasique et nappe du Complexe terminal à Biskra (nappe de
Tolga)
2.5.1.3. Failles d’Amguid
2.5.2. En Tunisie
2.5.2.1. Exutoire tunisien et dôme du Dahar
2.5.2.2. Configuration structurale
2.5.2.3. Continuité hydraulique avec la Djeffara
2.5.2.4. Effets sur la conceptualisation du modèle
2.5.3. En Libye
2.5.3.1. Liaisons du bassin saharien libyen avec la Djeffara
2.5.3.2. Continuité des aquifères vers le Sud avec le Paléozoïque
2.5.3.3. Rôle du graben de Hun
23
23
23
30
34
39
41
41
44
48
48
50
53
53
53
56
56
58
58
58
59
60
61
61
64
64
65
66
66
68
68

3
2.5.3.4. La source de Tawurgha
69
3. SCHEMATISATION DES AQUIFERES EN VUE DE LA REALISATION DU MODELE
3.1. Choix des aquifères et aquitards à représenter
3.2. Schématisation en vue de la réalisation du modèle
3.3. Limites conseillées pour le modèle
3.3.1 - Extension horizontale du Complexe terminal et limite conseillée pour la couche
représentant le Complexe terminal
3.3.2 Extension horizontale du Continental intercalaire et limite conseillée pour la couche
représentant le Continental intercalaire dans le modèle
71
71
74
75
75
75
4. HYDRODYNAMIQUE DU SYSTEME AQUIFERE
4.1. Dynamique du système
4.1.1. Carte piézométrique de référence
4.1.1.1. Définition et signification dans les trois pays
4.1.1.2. Données existantes
4.1.1.3. Description des cartes piézométriques de référence
4.1.2. L’alimentation actuelle : données et hypothèses
4.1.2.1. En Algérie
4.1.2.2. En Tunisie
4.1.2.3. En Libye
4.1.3. Les exutoires naturels
4.1.3. 1. Les sources
§ En Tunisie
§ En Libye
4.1.3.2. Les chotts et les sabkhas
Estimation des sorties par évaporation dans les exutoires naturels (chotts,
sebkhas)
4.1.3.3. Les exécutoires souterrains
§ Exécutoire du CI
§ Exécutoire libyen du CI
4.1.4. Les paramètres hydrodynamiques
4.1.4.1. Transmissivité
§ Le Complexe terminal
§ Le Continental intercalaire
4.1.4.2. Coefficient d'emmagasinement
§ Le Complexe terminal
§ Le Continental intercalaire
4.2. Les prélèvements et leurs influences
4.2.1. Les prélèvements
4.2.1.1. Problèmes liés au recueil des données sur les prélèvements
4.2.1.2. Méthodes d’estimation des prélèvements par forage et foggaras en
Algérie, en Tunisie et en Libye – Fiabilité des données
§ Méthode du suivi annuel
§ Méthode des inventaires
§ Méthode de l'estimation des usages
4.2.1.3. Prélèvements par aquifère et par pays
§ Exploitation du CT par pays
§ Exploitation du CI par pays
4.2.1.4. Prélèvements externes ayant des conséquences sur le comportement des
nappes sahariennes
79
79
79
79
80
80
82
83
83
84
86
86
86
89
89
90
90
91
92
92
92
96
97
97
101
102
102
102
102
102
103
103
104
104
106
111

4
4.2.1.5. Conclusions
4.2.2. Historique piézométrique
4.2.2.1. Problèmes liés aux mesures de niveau et de pression (forages artésiens
notamment)
4.2.2.2. Historique piézométrique du Complexe terminal
§ Algérie
§ Tunisie
§ Libye
4.2.2.3. Historique piézométrique du Continental intercalaire
§ Algérie
§ Tunisie
§ Libye
4.2.3. Situation piézométrique en 2000
4.2.3.1. Complexe terminal
4.2.3.2. Continental intercalaire
112
112
112
112
112
113
114
115
115
116
118
118
119
119
5. QUALITE CHIMIQUE DES EAUX
5.1. Informations utilisées
5.2. Qualité des analyses chimiques
5.3. Evolution des salinité
5.3.1. Nappe du complexe terminal
5.3.1.1. Nappes des sables mio-pliocènes
5.3.1.2. Nappe des calcaires
5.3.2. Nappe du Continental intercalaire
5.3.2.1. Algérie
5.3.2.2. Tunisie
5.3.2.3. Libye
5.3.2.4. Carte des iso-salinités
5.3.2.5. Variation verticale de la minéralisation
5.3.2.6. Evolution de la salinité et de la composition chimique en fonction de l’exploitation
5.3.2.7. Evolution de la composition chimique en fonction de l'éloignement des zones
d'alimentation
122
122
123
123
123
123
125
128
128
128
130
130
132
133
134
6. CARACTÉRISTIQUES ISOTOPIQUES
6.1. Nappe du Continental intercalaire
6.1.1. Zone centrale (Bassin du Grand Erg Oriental)
6.1.2. Zone du Dahar
6.1.3. Zone saharienne à nappe captive (Tunisie et Algérie)
6.1.4. Zone occidentale (Bassin du Grand Erg Occidental)
6.1.5. Bassin saharien libyen
6.2. Nappe du Complexe terminal
6.2.1. Nappe des sables mio-pliocènes
6.2.2. Nappe des calcaires
6.2.3. Nappes des Grands Ergs
6.2.4. Nappe du Turonien
6.3. Conclusion
137
137
137
138
138
140
141
143
144
145
146
146
146

5
7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
7.1. Conclusions sur le fonctionnement hydrodynamique du système et sur la
qualité des données
7.1.1. Fonctionnement hydraulique du système aquifère
7.1.2. Archivage des données et système de gestion
7.1.3. Archivage des données et système de gestion
7.1.4. Connaissance de la piézométrie
7.1.4.1. Piézométrie de référence
7.1.4.2. Suivi piézométrique
7.1.5. Qualité chimique des eaux
7.2. Recommandations sur le suivi et l’amélioration de certaines données
7.2.1. Amélioration de la connaissance de certaines données
7.2.1.1. Données piézométriques de base
7.2.1.2. Géométrie des réservoirs
7.2.1.3. Alimentation actuelle du système
7.2.1.4. Débit des exutoires naturels et pertes par évaporation
7.2.1.5. Hydrochimie
7.2.1.6. Données relatives à l'utilisation et au coût de l'eau
7.2.2. Amélioration du suivi
7.2.2.1. Suivi des prélèvements
7.2.2.2. Suivi piézométrique
7.2.2.3. Suivi de salinité et de la composition chimique
7.2.3. Acquisition de nouvelles données et mise à jour de la base de données
7.3. Recommandations pour l'établissement d'un réseau de suivi à l'échelle du
Bassin
7.3.1. Suivi de l’exploitation
7.3.2. Suivi de la piézométrie
7.3.2.1. Nappe du Continental intercalaire
7.3.2.2. Nappe du Complexe terminal
7.3.3. Suivi de la salinité et de la composition chimique de l’eau
147
148
148
148
149
149
149
150
150
150
150
150
151
151
151
152
152
152
152
153
153
153
154
154
154
155
155
155
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
1
/
284
100%