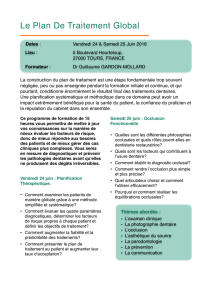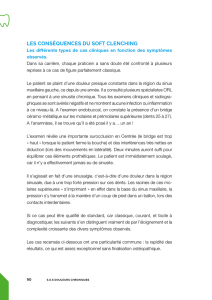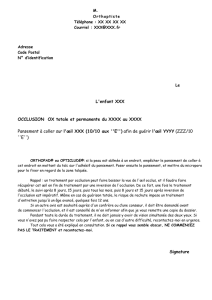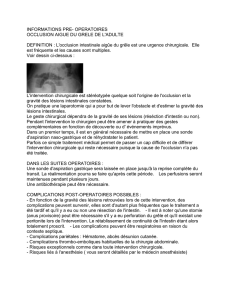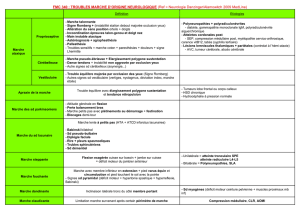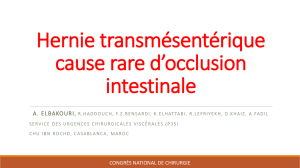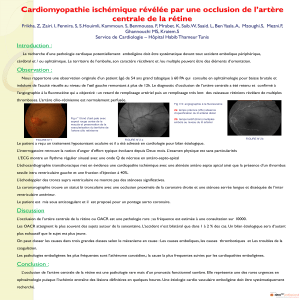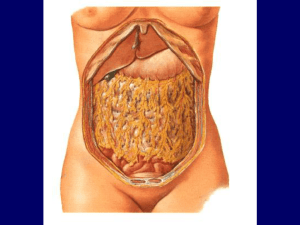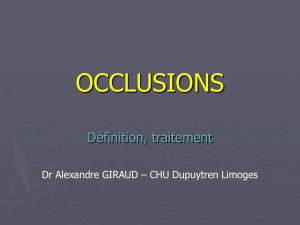See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/306083756
Articulation temporo-mandibulaire, occlusion et bruxisme
Article · August 2016
DOI: 10.1016/j.revsto.2016.07.006
CITATIONS
4
READS
1,639
4 authors:
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
bruxism care View project
Temporomandibular Disorders View project
Orthlieb J.D
Aix-Marseille Université
134 PUBLICATIONS589 CITATIONS
SEE PROFILE
J-P Ré
Aix-Marseille Université
38 PUBLICATIONS70 CITATIONS
SEE PROFILE
Jeany Marion
Aix-Marseille Université
8 PUBLICATIONS13 CITATIONS
SEE PROFILE
A. Giraudeau
Aix-Marseille Université
25 PUBLICATIONS138 CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Orthlieb J.D on 21 September 2016.
The user has requested enhancement of the downloaded file.

Articulation
temporo-mandibulaire,
occlusion
et
bruxisme
Temporomandibular
joint,
occlusion
and
bruxism
J.D.
Orthlieb
a,
*
,b
,
J.P.
Re
´
a,b
,
M.
Jeany
a,b
,
A.
Giraudeau
a,b
a
Unite
´d’occlusodontologie,
faculte
´d’odontologie
de
Marseille,
universite
´d’Aix-Marseille,
13385
Marseille
cedex
5,
France
b
Po
ˆle
odontologie,
UF
polyvalente,
CHU
Timone,
AP–HM,
13385
Marseille
cedex
5,
France
Disponible
en
ligne
sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com
Introduction
Articulations
temporo-mandibulaires
et
occlusion
dentaire
sont
marie
´es
pour
le
meilleur
et
parfois
pour
le
pire.
Imaginer
qu’il
n’y
a
aucune
relation
entre
ATM
et
occlusion
est
proba-
blement
aussi
peu
judicieux
que
de
penser
que
la
moindre
«
mal
»occlusion
provoquera
des
le
´sions
irre
´versibles
de
l’ATM
de
´clenchant
automatiquement
un
tableau
clinique
de
dys-
fonction
temporo-mandibulaire
(DTM).
Dans
un
souci
de
pragmatisme,
nous
utiliserons
ce
terme
de
DTM
(au
lieu
de
DAM
pour
dysfonctionnements
de
l’appareil
manducateur)
constatant
qu’il
s’est
clairement
impose
´au
cours
des
20
der-
nie
`res
anne
´es
dans
la
litte
´rature
internationale.
Ciblant
les
inter-relations
«
DTM,
occlusion
et
bruxisme
»
en
2014,
Manfredini
et
al.
ont
e
´tudie
´une
population
de
Summary
Temporomandibular
joint
and
dental
occlusion
are
joined
for
better
and
worse.
TMJ
has
its
own
weaknesses,
sometimes
indicated
by
bad
functional
habits
and
occlusal
disorders.
Occlusal
analysis
needs
to
be
addressed
simply
and
clearly.
The
term
‘‘malocclusion’’
is
not
reliable
to
build
epidemiological
studies,
etiologic
mechanisms
or
therapeutic
advice
on
this
‘‘diagnosis’’.
Understanding
the
impact
of
pathogenic
malocclusion
is
not
just
about
occlusal
relationships
that
are
more
or
less
defective,
it
requires
to
locate
them
within
the
skeletal
framework,
the
articular
and
behavioural
context
of
the
patient,
and
above
all
to
assess
their
impact
on
the
functions
of
the
masticatory
system.
The
TMJ-occlusion
couple
is
often
symbiotic,
developing
together
in
relation
to
its
environment,
compensating
for
its
own
shortcomings.
However,
a
third
partner
may
alter
this
relationship,
such
as
bruxism,
or
more
generally
oral
parafunctions,
trauma
or
an
interventionist
practitioner.
ß
2016
Elsevier
Masson
SAS.
All
rights
reserved.
Keywords:
Temporomandibular
joint,
Occlusion,
Bruxism,
Parafunc-
tion,
Temporomandibular
dysfunction
Re
´sume
´
Articulations
Temporo-Mandibulaires
et
occlusion
dentaire
sont
marie
´es,
pour
le
meilleur
et
pour
le
pire.
L’ATM
a
ses
faiblesses,
pointe
´es
parfois
par
des
comportements
oraux
de
´le
´te
`res
et
des
anomalies
de
l’occlusion.
L’analyse
de
l’occlusion
a
besoin
d’e
ˆtre
aborde
´e
de
manie
`re
simple
et
claire.
En
soi,
le
terme
«
malocclusion
»
est
nettement
insuffisant
pour
fonder
sur
ce
«
diagnostic
»
des
e
´tudes
e
´pide
´miologiques,
des
me
´canismes
e
´tiopathoge
´niques
ou
de
´gager
des
indications
the
´rapeutiques.
Comprendre
l’incidence
pathoge
´nique
d’une
malocclusion,
ce
n’est
pas
seulement
s’inte
´resser
aux
rapports
d’occlusion
plus
ou
moins
de
´fectueux,
cela
impose
de
les
situer
dans
leur
cadre
squelettique,
leur
contexte
articulaire,
comportemental,
et
surtout
d’e
´valuer
leurs
impacts
sur
les
fonctions
de
l’appareil
man-
ducateur.
Le
couple
ATM-occlusion
est
souvent
fusionnel,
se
de
´ve-
loppant
de
concert,
adapte
´a
`son
environnement,
compensant
ses
propres
de
´fauts.
Cependant,
un
troisie
`me
partenaire
peut
ge
´ne
´rer
des
e
´tincelles
dans
le
couple,
comme
le
bruxisme
par
exemple
ou
plus
ge
´ne
´ralement
les
parafonctions
orales,
mais
aussi
parfois
le
trauma
ou
un
praticien
interventionniste.
ß
2016
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
re
´serve
´s.
Mots
cle
´s
:
Articulation
temporo-mandibulaire,
Occlusion,
Bruxisme,
Parafonction,
Dysfonction
temporo-mandibulaire
*
Auteur
correspondant.
e-mail
:
(J.D.
Orthlieb).
Rec¸u
le
:
6
juillet
2016
Accepte
´le
:
6
juillet
2016
Disponible
en
ligne
11
aouˆt
2016
52
e
Congre
`s
de
la
SFSCMFCO
207
http://dx.doi.org/10.1016/j.revsto.2016.07.006
Rev
Stomatol
Chir
Maxillofac
Chir
Orale
2016;117:207-211
2213-6533/ß
2016
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
re
´serve
´s.

294
patients
DTM-bruxeurs
(serreurs).
Le
type
de
DTM
pouvait
e
ˆtre
influence
´,
au
moins
en
partie,
par
la
pre
´sence
de
certaines
anomalies
occlusales,
a
`savoir,
un
diffe
´rentiel
occlusion
en
relation
centre
´e-occlusion
en
intercuspidation
maximale
(ORC-OIM)
>
2
mm,
une
interfe
´rence
occlusale
en
diduction,
une
asyme
´trie
de
la
classe
d’angle
molaire
[1].
Cette
publica-
tion
arrivait
apre
`s
30
ans
de
pole
´miques
durant
lesquels
nous
sommes
passe
´s
d’une
pe
´riode
du
«
tout
occlusal
»
(les
anne
´es
1980),
a
`la
pe
´riode
du
«
rien
occlusal
»
(anne
´es
2000).
Dans
les
anne
´es
2010,
on
a
assiste
´a
`un
petit
retour
en
gra
ˆce
du
facteur
occlusal
dans
les
mode
`les
e
´tiopathoge
´niques
des
DTM.
L’arti-
cle
cite
´est
un
marqueur
de
cette
tendance.
E
´tiopathoge
´nie
tridimensionnelle
des
DTM
Le
mode
`le
Biopsychosocial
de
Dworkin
et
Lesresche
a
`deux
dimensions
(axe
I
structurel
et
axe
II
psychosocial)
a
impose
´
de
´s
1992
[2]
un
concept
e
´tiopathoge
´nique
plurifactoriel
des
DTM
de
´passant
les
aspects
me
´caniques
(ATM,
occlusion,
dysmorphoses.
.
.)
pour
l’e
´tendre
aux
facteurs
psychologiques
(anxie
´te
´,
de
´pression,
somatisation.
.
.).
Ce
concept
a
trouve
´en
2014
une
forte
consolidation,
fonde
´e
sur
le
niveau
de
preuve,
dans
une
tre
`s
importante
publication,
de
Schiffmann
et
de
33
co-
auteurs
[3].
Ces
auteurs
conservaient
deux
axes
mais
e
´voquaient
la
possibilite
´d’une
e
´volution
sur
un
troisie
`me
axe
«
bio
».
En
effet,
les
conditions
d’exte
´riorisation
des
sympto
ˆmes
de
DTM
sont
mieux
comprises
dans
un
mode
`le
e
´tiopathoge
´nique
a
`trois
dimensions
e
´voque
´en
1980
par
Hansson
[4],
propose
´
en
France
par
Gola
et
al.
en
1995
[5],
pre
´cise
´par
Orthlieb
et
al.
en
2004
[6]
:
axe
I
:
la
dimension
structurelle
:
aspect
somatique
local
comprenant
l’organisation
musculo-squelettique,
les
ATM
et
l’occlusion
;
axe
II
:
la
dimension
psychosociale
:
aspect
psychique
de
l’individu
dans
son
contexte
environnemental
et
culturel
influenc¸ant
son
interpre
´tation
des
facteurs
psycho-e
´motion-
nels
et
son
comportement
manducateur
;
axe
III
:
la
dimension
biologique
:
aspect
somatique
ge
´ne
´ral
(syste
´mique)
influenc¸ant
le
terrain
musculo-articulaire.
Les
e
´le
´ments
du
triptyque
«
bruxisme,
ATM,
occlusion
»
Ce
triptyque
concerne
l’axe
I,
structurel,
avec
ATM,
occlusion,
charge
musculaire,
mais
aussi
l’axe
II
psychosocial
avec
le
comportement
parafonctionnel
lie
´a
`des
aspects
e
´motionnels.
Bruxisme
Les
de
´finitions
suivantes
sont
a
`retenir
:
les
parafonctions
orales
regroupent
les
activite
´s
orales
non
nutritives
lie
´es
a
`des
hyperactivite
´s
musculaires
souvent
involontaires
(pressions
musculaires
pe
´ri-orales,
succions,
morsures,
ma
ˆchonnements.
.
.
et
bruxisme).
Le
pre
´fixe
«
para
»
signifie
«
a
`co
ˆte
´»,
soulignant
que
l’appareil
manducateur
est
mobilise
´pour
une
activite
´non
strictement
fonctionnelle,
ni
ve
´ritablement
pathoge
`ne,
on
utiliserait
alors
le
terme
de
dysfonction
(trouble
fonctionnel)
;
le
bruxisme
est
une
parafonction
orale
caracte
´rise
´e
par
des
affrontements
occlusaux
re
´sultant
d’activite
´s
motrices
man-
ducatrices
non
nutritives,
re
´pe
´titives,
involontaires,
le
plus
souvent
inconscientes.
On
distingue
des
formes
d’e
´veil
ou
de
sommeil,
et
des
types
de
bruxisme
avec
serrement,
balance-
ment,
grincement,
tapotements
des
dents.
Il
semble
clairement
e
´tabli
que
les
bruxismes
sont
provoque
´s
par
des
facteurs
centraux
(neuropathiques
ou
psycho-e
´mo-
tionnels)
e
´ventuellement
associe
´s
a
`des
troubles
du
sommeil
et
de
la
ventilation.
L’e
´tiologie
occlusale
du
bruxisme
est
a
`
rejeter,
l’excitation
pe
´riphe
´rique
provenant
d’un
facteur
occlusal
e
´tant
a
`conside
´rer
comme
anecdotique
[7].
Incidence
Le
bruxisme
«
se
´ve
`re
»
est
un
facteur
de
risque
pour
les
e
´le
´ments
dentaires
surtout
s’ils
sont
artificiels
(usures,
frac-
tures).
En
revanche,
le
bruxisme
est
une
soupape
utile
de
de
´charges
des
tensions
psycho-e
´motionnelles.
Ge
´ne
´ralement,
le
bruxeur
ne
se
plaint
pas
de
douleurs,
en
dehors
de
quelques
sensations
de
tensions
(musculaires,
dentaires)
parfois
e
´vo-
que
´es
le
matin
au
re
´veil.
Le
bruxisme
en
lui-me
ˆme
n’est
donc
ge
´ne
´ralement
pas
un
ve
´ritable
facteur
de
risque
pour
l’ATM.
On
se
demande
me
ˆme
si
cette
stimulation
fonctionnelle,
que
l’on
rencontre
de
´s
l’enfance,
n’aurait
pas
des
effets
be
´ne
´fi-
ques
sur
la
«
robustesse
»
des
structures
osseuses
renforc¸ant
les
structures
musculo-articulaires
pluto
ˆt
que
responsable
de
leur
affaiblissement.
On
conside
´rera
donc,
le
bruxisme
mode
´re
´,
comme
physiolo-
gique,
probablement
plus
be
´ne
´fique
que
ne
´faste.
On
s’inte
´r-
essera
au
bruxisme
se
´ve
`re
face
a
`des
structures
articulaires
ou
dentaires
fragiles.
Lien
entre
bruxisme
et
DTM
On
peut
identifier
deux
situations
a
`potentialite
´pathoge
`ne
:
myalgie
:
la
douleur
musculaire,
dont
le
me
´canisme
physiopathoge
´nique
n’est
pas
tre
`s
clair,
semble
pluto
ˆt
en
rapport
avec
des
contractions
de
faible
intensite
´mais
de
longue
dure
´e,
alors
que
les
«
bouffe
´es
»
classiques
de
bruxisme
(surtout
pour
le
grincement
de
sommeil)
sont
intenses
et
de
courte
dure
´e.
Pour
expliquer
les
myalgies
manducatrices,
il
faudrait
s’inte
´resser
aux
phases
de
serre-
ment
(pluto
ˆt
d’e
´veil)
de
faible
intensite
´et
de
longue
dure
´e.
Il
est
clairement
e
´tabli
que
cet
e
´tat
de
tensions
psycho-
e
´motionnelles
ge
´ne
`re
un
abaissement
des
seuils
de
sensibilite
´
a
`la
douleur.
La
tension
e
´motionnelle
serait
la
cause
premie
`re
ge
´ne
´rant
a
`la
fois
l’abaissement
du
seuil
de
sensibilite
´et
la
J.D.
Orthlieb
et
al.
Rev
Stomatol
Chir
Maxillofac
Chir
Orale
2016;117:207-211
208

contraction
musculaire
de
faible
intensite
´mais
de
longue
dure
´e,
le
tout
cre
´ant
la
myalgie
;
compression
de
l’ATM
:
pour
pouvoir
serrer
ou
grincer
des
dents,
il
faut
avoir
des
dents
en
opposition
procurant
une
stabilite
´a
`la
mandibule,
sinon
il
existe
pre
´fe
´rentiellement
un
re
´flexe
d’inhibition
de
la
contraction
musculaire.
Il
existe
donc
une
re
´gulation
naturelle
de
la
charge
de
l’ATM
:
moins
il
y
a
de
calage,
moins
il
y
a
de
protection
de
l’ATM
mais
moins
on
serre
les
dents.
Le
risque
peut
exister
si
le
patient
de
´passe
ce
re
´flexe
naturel
de
protection
par
une
demande
du
syste
`me
nerveux
central
consciente
ou
inconsciente.
A
`ce
moment,
le
risque
est
d’autant
plus
de
´le
´te
`re
que
la
mandibule
est
mise
en
charge
dans
une
position
excentre
´e.
ATM
L’ATM
a
des
spe
´cificite
´s
anatomo-histologiques
la
rendant
apte
a
`subir
des
charges
lie
´es
a
`l’activite
´musculaire.
Le
disque
articulaire
permet
en
particulier
l’absorption
de
ces
charges
dans
pratiquement
toutes
les
positions
mandibulaires.
Les
facteurs
de
risque
naissent
moins
de
l’intensite
´de
la
charge
que
de
ses
conditions
d’applications.
Il
semble
bien
acquis,
d’une
part,
que
le
point
faible
de
l’ATM
se
situe
sur
le
po
ˆle
late
´ral,
moins
apte
a
`absorber
les
charges
[8]
;
et
d’autre
part,
que
des
contraintes,
pluto
ˆt
transversales,
sont
susceptibles
de
favoriser
la
distension
des
attaches
discales.
Cette
distension
favorise
la
de
´sunion
condylo-discale,
le
disque
articulaire
ne
pouvant
plus
jouer
correctement
son
ro
ˆle
d’absorbeur
de
charge.
Cette
distension
peut
e
ˆtre
en
rapport
avec
des
facteurs
syste
´mique
(laxite
´),
des
facteurs
traumatiques,
des
facteurs
microtraumatiques
re
´pe
´te
´s
comme
dans
le
ma
ˆchonnement
excessif,
ou
encore,
dans
l’association
posture
de
sommeil
et
parafonctions.
Le
tout
sera
majore
´par
la
pre
´sence
de
certaines
anomalies
occlusales
(OIM
de
´centre
´e
transversalement,
le
´ge
`re
infraclusion
molaire,
interfe
´rences
occlusales).
Occlusion
Selon
l’hypothe
`se
originelle
de
Costen,
la
malocclusion
entraıˆ-
nerait
un
recul
condylien
ge
´ne
´rateur
de
troubles
articulaires.
Souvent
e
´nonce
´,
ce
concept
«
me
´caniste
»
a
conduit
a
`de
nombreux
traitement
occlusaux
invasifs
sur
des
dents
natu-
relles
saines,
sur-traitements
be
´ne
´ficiant
probablement
davantage
aux
praticiens
qu’aux
patients.
Cette
approche
invasive
a
e
´te
´rejete
´e
par
plusieurs
e
´tudes
montrant
qu’il
n’y
aurait
pas
ou
peu
d’incidence
de
la
maloc-
clusion
sur
les
DTM.
Ainsi,
de
nombreuses
situations
d’ano-
malies
occlusales
parfois
se
´ve
`res
sont
observe
´es
chez
des
patients
asymptomatiques,
et
la
fre
´quence
des
anomalies
de
l’occlusion
chez
les
patients
souffrant
de
DTM
serait
la
me
ˆme
que
chez
les
sujets
asymptomatiques.
Dans
une
ana-
lyse
exhaustive,
De
Boever
et
al.
[9]
concluaient
que
les
facteurs
occlusaux
n’avaient
qu’un
faible
impact
dans
l’e
´tio-
logie
des
DTM.
En
1997,
le
NIH
(National
Institute
of
Health,
office
of
medical
application
of
research)
concluait
qu’il
n’y
avait
pas
de
preuve
pour
justifier
des
traitements
occlusaux
re
´pe
´te
´s
et
e
´tendus
dans
la
prise
en
charge
des
DTM
et
qu’une
e
´quilibration
occlusale
globale
a
`but
prophylactique
n’e
´tait
pas
justifie
´e.
On
pourrait
alors
penser
que
«
l’atterrissage
»
mandibulaire
en
OIM
se
fait
au
hasard,
en
des
trajectoires
fortuites,
inde
´-
pendantes
des
de
´terminants
occlusaux
:
ce
n’est
pas
le
cas,
l’occlusion
dentaire
joue
un
ro
ˆle
important
dans
les
fonctions
de
l’appareil
manducateur.
Elle
influence
la
posture
mandi-
bulaire
de
repos,
la
cine
´matique
mandibulaire,
la
mastication,
la
de
´glutition,
les
charges
applique
´es
a
`l’ATM,
les
trajectoires
d’acce
`s
a
`l’OIM.
Si
l’occlusion
influence
la
fonction,
comment
penser
que
la
malocclusion
ne
provoquerait
aucune
forme
de
dysfonctionnement
?
Tallents
et
al.
montrent
par
exemple
sur
345
sujets,
un
lien
entre
perte
de
calage
poste
´rieur
et
de
´ran-
gement
interne
de
l’ATM
[10].
Les
dysfonctions
occlusales
recensent
les
anomalies
de
l’affron-
tement
occlusal
susceptibles
de
diminuer
les
capacite
´s
fonc-
tionnelles
de
l’appareil
manducateur
et/ou
d’entraıˆner
des
fonctions
manducatrices
dommageables
pour
les
structures.
Manfredini
et
al.,
dans
la
publication
cite
´e
plus
haut,
pre
´cisaient
comme
e
´le
´ments
de
pathoge
´nicite
´un
diffe
´rentiel
ORC-
OIM
>
2
mm,
une
interfe
´rence
occlusale
en
diduction,
une
asyme
´trie
de
la
classe
molaire
[1].
Mais
la
de
´finition
de
ces
anomalies
de
l’occlusion
est
souvent
confuse.
Pour
mieux
approcher
ce
proble
`me
et
celui
de
l’e
´valuation
clinique,
une
classification
des
fonctions
occlusales
a
e
´te
´propose
´e
en
1996
[11–13],
base
´e
sur
la
triade
«
calage
»,
«
centrage
»
et
«
guidage
».
Anomalies
occlusales
de
calage
Il
s’agit
d’anomalies
de
la
stabilisation
dentaire
et
mandibu-
laire
en
OIM.
On
distingue
:
la
surocclusion
:
contact
occlusal
toujours
iatroge
`ne,
concentre
´sur
un
e
´le
´ment
(souvent
prothe
´tique)
empe
ˆchant
l’OIM
comple
`te
;
les
anomalies
de
stabilite
´des
arcades
(versions,
e
´gressions)
;
les
anomalies
de
calage
occlusal
poste
´rieur
(exocclusion,
sous-occlusion
ou
e
´dentement
poste
´rieur)
;
les
anomalies
de
calage
occlusal
ante
´rieur
(sous-occlusion,
e
´dentement,
surplomb
excessif
ou
be
´ance
ante
´rieure).
Anomalies
occlusale
de
centrage
Il
s’agit
d’anomalies
de
la
position
mandibulaire
en
OIM
par
rapport
a
`la
Relation
Centre
´e,
on
distingue
:
aspect
transversal
:
de
´centrage
mandibulaire
transversal
;
aspect
sagittal
:
ante
´position
sagittale
excessive
(supe
´rieure
a
`2
mm),
re
´troposition
sagittale
excessive
;
aspect
vertical
:
exce
`s
ou
insuffisance
important(e)
de
dimension
verticale
d’occlusion.
Le
de
´centrage
mandibulaire
transversal
serait
l’anomalie
a
`
plus
grande
potentialite
´pathoge
`ne
[8]
;
ceci
est
sans
doute
a
`
rapprocher
de
la
fragilite
´de
l’ATM
au
po
ˆle
late
´ral.
Articulation
temporo-mandibulaire,
occlusion
et
bruxisme
209

Anomalies
occlusales
de
guidage
Il
s’agit
d’anomalies
des
trajectoires
mandibulaires
d’acce
`s
a
`
l’OIM.
On
distingue
(par
convention,
les
interfe
´rences
sont
diffe
´rentes
des
pre
´maturite
´s,
selon
la
direction
du
mouve-
ment
ge
´ne
´rant
ces
contacts
occlusaux
a
`caracte
`res
pathoge
`nes)
:
une
interfe
´rence
occlusale
est
de
´finie
comme
un
obstacle
dentaire
limitant
ou
de
´viant
les
mouvements
mandibulaires
de
translation
(diduction
ou
propulsion).
L’interfe
´rence
peut
e
ˆtre
poste
´rieure
ou
ante
´rieure
;
une
pre
´maturite
´occlusale,
concerne
le
mouvement
d’e
´le
´vation
mandibulaire
et
non
pas
de
la
propulsion
ou
les
diductions.
Elle
est
de
´finie
comme
un
glissement
occlusal
de
´centrant
le
chemin
de
fermeture
lors
d’un
mouvement
de
fermeture
en
relation
centre
´e.
La
mise
en
musique
du
triptyque
«
ATM,
occlusion
et
bruxisme
»
La
combinaison
de
fragilite
´du
terrain
articulaire,
d’anomalies
de
l’occlusion
et
de
parafonctions
est
susceptible
de
repre
´-
senter
un
«
cocktail
»
e
´tiopathoge
´nique
classique
des
DTM.
L’e
´quilibration
occlusale
doit
s’entendre
comme
incluant
les
diffe
´rentes
techniques
de
meulage,
de
collage,
de
restaura-
tions
ou
d’orthodontie.
Ces
traitements
irre
´versibles
pre
´sen-
tent
un
certain
nombre
de
risques
qui
doivent
e
ˆtre
parfaitement
e
´value
´s.
e
´quilibration
occlusale
dans
le
cadre
d’une
re
´habilitation
:
l’indication
majeure
de
l’e
´quilibration
occlusale
naıˆt
de
la
ne
´cessite
´de
traitement
dentaire
pour
des
raisons
purement
intrinse
`ques
a
`l’e
´tat
des
dents
(caries,
de
´labrement,
malposi-
tion,
e
´dentement).
On
visera
alors,
DTM
ou
non,
une
optimisation
globale
des
fonctions
occlusales
;
e
´quilibration
occlusale
pour
cause
de
DTM
:
dans
certains
cas
limite
´s,
une
e
´quilibration
occlusale
ponctuelle,
associe
´e
a
`
d’autres
traitements
(conseils,
gouttie
`res,
physiothe
´rapie)
peut
contribuer
a
`un
pronostic
positif
mais
elle
n’est
ge
´ne
´ralement
pas
indique
´e
en
premie
`re
intention.
L’e
´quilibration
occlusale
doit
e
ˆtre
e
´vite
´e
chez
les
patients
pre
´sentant
des
proble
`mes
psychologiques
ou
re
´agissant
ne
´gativement
aux
phases
pre
´liminaires
du
traitement.
Seule
la
malocclusion
d’e
´vidence
rele
`ve
d’une
e
´quilibration
occlu-
sale
en
premie
`re
intention.
La
malocclusion
d’e
´vidence
se
diffe
´rentie
de
la
malocclusion
e
´tablie
par
des
anomalies
occlusales
ponctuelles
(une
ou
deux
dents),
nettes,
d’appari-
tion
ou
d’aggravation
re
´cente,
corrigeable
avec
un
moyen
simple.
L’e
´valuation
clinique
de
l’occlusion
est
ne
´cessaire,
souvent
suffisante,
pour
identifier
ces
anomalies
e
´videntes
et
permettre
leur
correction.
Cette
e
´quilibration
«
d’e
´vidence
»
intervient
en
premie
`re
intention
sans
risque
the
´rapeutique.
Elle
a
pour
but
d’optimiser
imme
´diatement
les
fonctions
occlusales.
Ainsi,
par
exemple,
il
est
indique
´en
premie
`re
inten-
tion
de
corriger
par
meulage
une
dent
de
sagesse
fortement
e
´gresse
´e
perturbant
la
cine
´matique
mandibulaire,
et
ce,
claire-
ment
avant
de
mettre
en
place
une
gymnothe
´rapie,
une
phar-
macothe
´rapie,
une
gouttie
`re
occlusale
etc.
Cette
e
´quilibration
est
indique
´e
si,
et
seulement
si,
elle
est
pre
´sente
´e
au
patient
comme
un
geste
anodin
destine
´a
`faciliter
son
auto-re
´e
´ducation
et
non
comme
«
LE
»
moyen
de
traitement
des
DTM.
L’objectif
sera
le
plus
souvent
:
de
diminuer
un
de
´centrage
mandibulaire
macroscopique-
ment
appre
´ciable
(anomalie
de
centrage)
;
de
compenser
une
inocclusion
nette
(anomalie
de
calage)
;
d’e
´liminer
une
pre
´maturite
´nette
ou
une
interfe
´rence
occlusale
poste
´rieure
(anomalie
de
guidage).
Conclusion
Le
terme
«
malocclusion
»
est
en
soi
nettement
insuffisant
pour
fonder
sur
ce
«
diagnostic
»
des
e
´tudes
e
´pide
´miologi-
ques,
des
me
´canismes
e
´tiopathoge
´niques
ou
de
´gager
des
indications
the
´rapeutiques.
Comprendre
une
malocclusion
n’est
pas
seulement
s’inte
´resser
aux
rapports
d’occlusion
plus
ou
moins
de
´fectueux,
mais
impose
de
les
situer
dans
leur
cadre
squelettique,
leur
contexte
articulaire,
comportemen-
tal,
et
surtout
d’e
´valuer
leurs
impacts
sur
les
fonctions
de
l’appareil
manducateur.
Il
est
alors
possible
de
mieux
comprendre
les
inter-relations
dysfonctionnelles
pouvant
exi-
ster
entre
ATM
et
malocclusion.
Le
couple
ATM-occlusion
est
souvent
fusionnel,
de
´veloppant
de
concert
un
e
´quilibre
adapte
´a
`son
environnement,
compensant
ses
propres
de
´fauts.
Cet
e
´quilibre
peut
e
ˆtre
fragile
et
un
troisie
`me
parte-
naire
peut
provoquer
des
e
´tincelles
dans
le
couple.
Ce
«
trouble-fe
ˆte
»
peut
e
ˆtre
le
bruxisme
ou
plus
ge
´ne
´ralement
les
parafonctions
orales,
mais
aussi
parfois
un
traumatisme
ou
un
praticien
interventionniste
inde
´licat.
De
´claration
de
liens
d’inte
´re
ˆts
Les
auteurs
de
´clarent
ne
pas
avoir
de
liens
d’inte
´re
ˆts.
Re
´fe
´rences
[1]
Manfredini
D,
Stellini
E,
Marchese-Ragona
R,
Guarda-Nardini
L.
Are
occlusal
features
associated
with
different
temporoman-
dibular
disorder
diagnoses
in
bruxers?
Cranio
2014;32(4):283–8.
[2]
Dworkin
SF,
Le
Resche
L.
Research
diagnostic
criteria
for
tempo-
romandibular
disorders:
review,
criteria,
examinations
and
spe-
cifications,
critique.
J
Craniomandib
Disord
1992;6(4):
301–55.
[3]
Schiffman
E.
Diagnostic
Criteria
for
Temporomandibular
Dis-
orders
(DC/TMD)
for
clinical
and
research
applications:
recom-
mendations
of
the
International
RDC/TMD
Consortium
Network
and
Orofacial
Pain
Special
Interest
Group.
J
Oral
Facial
Pain
Headache
2014;28:6–27.
[4]
Hansson
T.
Temporomandibular
joint
changes
related
to
den-
tal
occlusion.
In:
Solberg
WK,
Clark
GT,
editors.
Temporoman-
J.D.
Orthlieb
et
al.
Rev
Stomatol
Chir
Maxillofac
Chir
Orale
2016;117:207-211
210
 6
6
1
/
6
100%