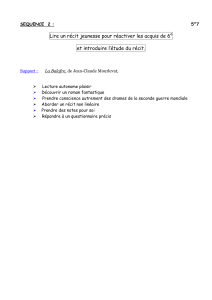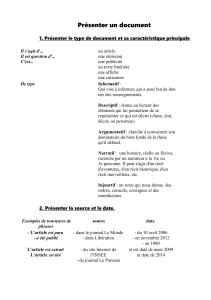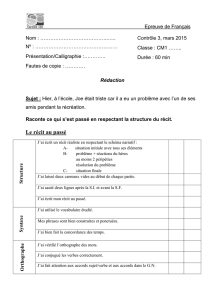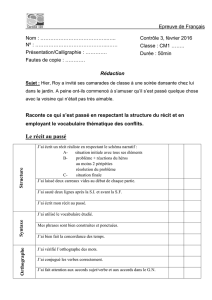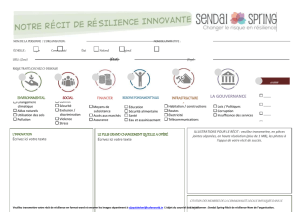du narrativisme - Tracés. Revue de Sciences humaines

Raconte-moi une histoire.
Enjeux et perspectives (critiques)
du narrativisme
JOHANN PETITJEAN
Si l’on accepte, par convention, de s’en tenir au domaine
de l’expression littéraire, on définira sans difficulté le
récit comme la représentation d’un événement ou
d’une suite d’événements, réels ou fictifs, par le moyen
du langage, et plus particulièrement du langage écrit.
Cette définition positive (et courante) a le mérite de
l’évidence et de la simplicité, son principal inconvé-
nient est peut-être, justement, de s’enfermer et de nous
enfermer dans l’évidence, de masquer à nos yeux ce qui
précisément, dans l’être même du récit, fait problème et
difficulté, en effaçant en quelque sorte les frontières de
son exercice, les conditions de son existence.
Gérard Genette, « Frontières du récit », Figures II
Les enfants adorent qu’on leur raconte des histoires. Comme le Petit Prince
de Saint-Exupéry, ils veulent qu’on leur dessine un mouton. Et il semble que
les élèves et les étudiants, quel que soit leur niveau de formation ou la matière
choisie, fonctionnent un peu de la même manière. N’enseigne-t-on pas dans
les centres de formation pédagogique français à ménager du temps pour le
récit, « support de leçon » (Jean et Jourdan, ) pour les petits, comme pour
les grands ? Mais revenons à notre mouton. L’aviateur décontenancé répond
à la requête du Petit Prince qu’il a surtout étudié la géographie, l’histoire, le
calcul et la grammaire : il ne sait pas dessiner ; mais qu’importe, insiste alors
l’enfant, tout ce qu’il veut, c’est qu’on lui dessine un mouton, pas un boa,
non, encore moins un éléphant, mais un mouton. Et l’aviateur de s’exécuter…
Le récit de Gérard Genette et le mouton de Saint-Exupéry produisent, l’un
par le dessin et l’autre par le biais du langage, des représentations possibles
de choses réelles ou fictives.
TRACÉS 13 2007/2 PAGES 185-200

JOHANN PETITJEAN
186
Il est certains historiens et certains philosophes de l’histoire pour soutenir
que la mise en récit peut suffire à l’histoire comme le mouton de l’aviateur
suffit au Petit Prince, car, selon eux, lorsque l’on entreprend d’écrire l’histoire
de quelque chose, on ne fait jamais que raconter des histoires à propos de ce
quelque chose. Ce parti pris qui confère à la mise en récit la primauté dans
l’ordre des discours définit la position générale des narrativistes à l’égard du
statut de l’écriture dans les sciences sociales.
Comment peut-on être « narrativiste » ? La question peut sembler provo-
catrice, mais elle n’en est pas moins légitime. Pour dire les choses autrement,
comment peut-on raisonnablement ne mettre l’accent que sur la « mise en
récit » sans pour autant renoncer aux acquis de la critique historique (depuis
la critique positiviste jusqu’au « tournant critique » des Annales) ? La question
n’est pas tant de rendre compte ici de l’histoire de la critique depuis Fustel
de Coulanges jusqu’à aujourd’hui, mais plutôt d’en réexaminer les enjeux
épistémologiques à l’aune de la place relative accordée à la narration. Il
s’agira de partir des présupposés et des outils narrativistes au sens large afin
de voir dans quelle mesure le retour d’une réflexion sur l’usage de la raison
critique (comprise comme faculté, relative mais validante, de juger) permet
paradoxalement de donner au narrativisme toute sa légitimité intellectuelle,
scientifique et sociétale.
Le narrativisme est-il simplement a-critique ? Tout l’enjeu de la question
consistera effectivement à réévaluer la dimension critique du narrativisme
tout en en examinant les champs d’applications possibles. Réside-t-elle, cette
dimension critique, au niveau de l’étude des sources, de la construction de la
réflexion, au niveau des discours produits, dans le jugement personnel que
l’on se fait de ces derniers, ou dans la possibilité de les vérifier ? La mise en
récit agit-elle seulement dans la transmission des connaissances, ou est-elle
déjà présente comme une modalité de leur constitution ? Et à quelles fins
est-elle alors employée : pour décrire la société ? Pour la comprendre ? La
transformer ? Poser le problème de la dimension (a)critique du narrativisme
invite donc à interroger la mise en récit à la lumière des finalités et des desti-
nataires de cette mise en récit.
Pourquoi revenir aujourd’hui sur un chantier épistémologique qui ne
devrait pas être loin de fêter ses ans s’il était possible d’en dater l’ouverture
avec exactitude ? Il nous a semblé que l’accueil sans réserve fait cette année
en France au dernier ouvrage de Natalie Z. Davies – historienne améri-
caine de la culture dont la démarche, mêlant d’une certaine manière histoire
et fiction, était pourtant loin d’aller de soi –, légitimait le fait de rouvrir
certains dossiers. Et puisque, bien souvent, les débats les plus intéressants sont

ENJEUX ET PERSPECTIVES (CRITIQUES) DU NARRATIVISME
187
justement ceux qui ne font plus débat et que l’épistémologie est fille de son
temps, il nous a semblé intéressant de questionner certaines des apories
narrativistes à la lumière d’une discipline récemment consacrée, à défaut
d’être réellement récente : le storytelling.
Du narrativisme au storytelling : histoire(s), narration, récits
Dire que les sciences sociales en général, et l’histoire en particulier, connais-
sent aujourd’hui quelques réticences à se tourner vers le littéraire relève
de l’euphémisme. Subjectivisme, linguistic turn et narrativisme sont, au
sein de la communauté scientifique française, des mots honnis que l’on ne
prononce que du bout des lèvres, en off des séminaires, des tables rondes
et des articles dits « de référence », et de manière hostile le plus souvent. Le
refus de ces approches nouvelles est une conséquence directe du rejet du
« postmodernisme », toujours convoqué par certains comme repoussoir, mais
trop rarement défini. Le tournant linguistique par exemple a été compris
comme un improbable « reflux de l’épistémologie sur le langage » (Certeau,
), et appréhendé de ce fait moins comme une révolution scientifique
que comme un coup éditorial réalisé par des historiens en quête de visibilité
et de reconnaissance, voire comme un « renoncement »¹ pur et simple.
Scientificité du récit
La possibilité de voir les sciences sociales prendre le tournant du narrati-
visme repose sur une question essentielle : raconter quelque chose suffit-il à
expliquer cette chose (Kreiswirth, ) ? En effet, est-il certain que l’on crée
réellement les conditions de la compréhension par autrui d’un événement,
d’un phénomène et/ou d’une situation par le simple fait de les mettre en
récit ?
Tout type de narration se repère, selon Hayden White, par l’usage de
ces quatre « tropes » que sont la métonymie, la métaphore, la synecdoque et
l’ironie (White, ; , p. ), ce qui invite par conséquent à ramener
l’histoire sur le plan du narratif en la reconnaissant pleinement comme un
L’expression est de Simona Cerutti (, p. ). Elle est, nous semble-t-il, symptomatique
de la réception française, voire européenne, de ce moment épistémologique singulier. Nous
nous permettons de signaler ici notre modeste synthèse des débats : Johann Petitjean, « Le
tournant linguistique en histoire : panorama d’une controverse », http://eco.ens-lsh.fr/sociales/
histoire_linguistique.pdf, .

JOHANN PETITJEAN
188
récit, voire comme un simple « artefact littéraire » (White, )². Le mérite
d’une telle réduction, qui n’est pas sans lien avec la révolution épistémo-
logique amorcée outre-atlantique par le linguistic turn, contribue donc à
considérer l’histoire comme un processus d’écriture.
Il est dès lors légitime de suivre Paul Veyne dans sa définition de l’histoire
comme « récit d’événements » (Veyne, , p. ). Et l’auteur de préciser sa
pensée en affirmant que l’écriture de l’histoire n’est pas mimétique, qu’elle
ne relève nullement de l’imitation du passé : elle est un « roman vrai ». Selon
Ricœur, qui se ressaisit des apports conceptuels de Veyne, l’histoire est une
écriture qui n’est pas déliée du réel. Il ne saurait s’agir seulement d’une pure
combinaison de signes puisque ce que l’on vise, c’est justement le réel et
la connaissance possible d’un réel, passé dans le cas de l’histoire, que l’on
peut décrire, expliquer et comprendre. Raconter, c’est déjà expliquer, nous
enseigne Ricœur : « Expliquer pourquoi quelque chose est arrivé et décrire
ce qui est arrivé coïncident. Un récit qui échoue à expliquer est moins qu’un
récit ; un récit qui explique est un récit pur et simple » (Ricœur, , p. ).
La possibilité d’expliquer ce qu’on raconte par le simple fait de le raconter
se présente ainsi comme le premier étage de la critique historique. On
peut également inférer de ce qui précède qu’« expliquer plus, c’est raconter
mieux » (Veyne, , p. ), et conclure sur ce point en montrant que le
récit et l’explication sont loin d’être antinomiques, car ils sont deux des
éléments essentiels de la définition de l’« intrigue » chez Ricœur. Cette mise
en intrigue de la description historique a en outre ceci de précieux qu’elle
facilite la transmission et la compréhension des discours, et rendrait ainsi
possible l’enseignement de la discipline, tout en préparant de la sorte son
éventuelle implication dans le champ de la critique et de la transformation
de la société.
Raconter et transmettre : de la pédagogie à l’action
Nous ne retenons que bien peu de choses ; nous ne mémorisons qu’une
partie infime de tout ce que nous pouvons voir, lire, sentir ou entendre.
La mémoire des choses ne tend pas vers l’infini, mais plutôt vers zéro ; et
c’est justement pour inverser cette tendance que l’on peut se permettre de
« Nor is it to say that literary theorists have never studied the structure of historical narratives.
But in general there has been a reluctance to consider historical narratives as what they most
manifestly are: verbal fictions, the contents of which are as much invented as found and the
forms of which have more in common with their counterparts in literature than they have with
those in the sciences » (White, , p. ).

ENJEUX ET PERSPECTIVES (CRITIQUES) DU NARRATIVISME
189
raconter des histoires. La narration serait alors le moyen le plus simple,
le plus efficace et le plus pertinent de décrire et de faire comprendre les
éléments à enseigner. Le récit serait ainsi au cœur même de la pédagogie, au
cœur d’une pédagogie qui reposerait avant toute chose sur la qualité et le
statut des exemples choisis.
Néanmoins, aucun récit historique n’invente à proprement parler les
faits passés qu’il énonce, même s’il est vrai qu’en les énonçant, il contribue
à les reconstruire à partir des traces qu’ils ont laissées et à leur donner ainsi
une logique, généralement causale, qui permet à la fois de les énoncer, de
les comprendre et enfin de les rendre comparables. Une telle démarche est
à la fois scientifique et créative, narrative et critique. Cette redescription du
passé à partir des traces qui ont été laissées peut être considérée comme un
act of meaning, comme un acte de signification provisoire, dont l’élabora-
tion constante est réalisée autant de manière individuelle que collective.
Il ne s’agit donc ni de revivre le passé, ni d’en tirer une quelconque leçon,
mais plutôt de le comprendre en en écrivant l’histoire, et cela passe néces-
sairement par l’enseignement des résultats obtenus. Nous nous trouvons
là face au second niveau de la critique, niveau que le récit certes prépare,
mais de manière plus ou moins périphérique cette fois. La compréhension
critique du passé se déploie en conséquence comme une réponse possible
des historiens aux attentes de la communauté (Rancière, ) en matière
de mémoire et d’identité collectives dont ils contribuent à apprivoiser les
significations (Hinchman, )³, et ce quel que soit le type d’identité auquel
on se réfère : l’enfance, l’université, la nation, le genre, la confession ou la
race. Les histoires que l’on raconte ont donc une certaine opérativité, et leur
compréhension peut alors devenir un utile instrument de critique sociale.
C’est le cas par exemple de l’usage du narrativisme dans le domaine
juridique par les tenants de la Critical Race eory (CRT), ces juristes iden-
titaristes américains dont les présupposés perspectivistes et subjectivistes ne
sont pas sans enseignements pour ce qui nous intéresse ici⁴. La CRT marque
une rupture radicale, pour ne pas dire un tournant, au sein des techniques
Les auteurs considèrent que « le narratif » permet d’unifier la connaissance et de contribuer
à définir la communauté sans pour autant y subsumer l’identité singulière des individus qui
la composent. Les histoires racontées contruisent à la fois du sens et du capital social, elles
fournissent à la communauté les moyens de sa cohésion, et rendent ainsi possible toute forme
d’action commune : « In the section on community, the authors included try to display both
the power of narrative to generate a sense of common identity and its potential as a critical,
emancipatory instrument » (Hinchman, , p. ).
Ce paragraphe doit beaucoup au détail et à la précision des analyses d’épistémologie des sciences
juridiques de Jean-François Gaudreault-Desbiens (, ).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%