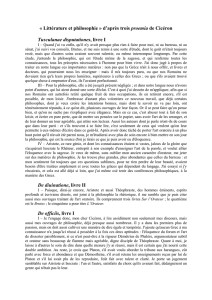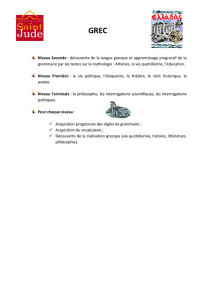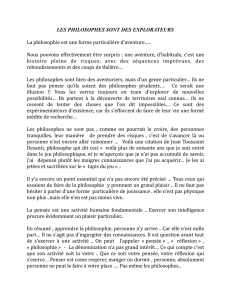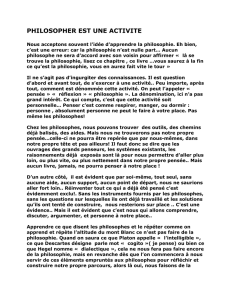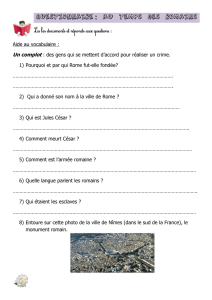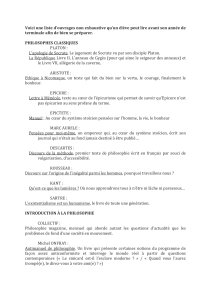études morales sur l`antiquité - L`Histoire antique des pays et des

ÉTUDES MORALES SUR L'ANTIQUITÉ
PAR CONSTANT MARTHA
Membre de l'Institut - Professeur à la Faculté des lettres de Paris
PARIS - LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie - 1883

AVANT-PROPOS.
L'ÉLOGE FUNÈBRE CHEZ LES ROMAINS.
LE PHILOSOPHE CARNÉADE À ROME.
LES CONSOLATIONS DANS L'ANTIQUTIÉ.
L'EXAMEN DE CONSCIENCE CHEZ LES ANCIENS.
UN CHRÉTIEN DEVENU PAÏEN.
UN PAÏEN DEVENU CHRÉTIEN.

AVANT-PROPOS.
Si les précieuses découvertes de l'archéologie attirent de plus en plus l'attention
sur tout le détail matériel de la vie grecque ou romaine, on est moins curieux
aujourd'hui de pénétrer dans l'âme antique. Il nous a semblé pourtant que des
études particulières sur l'état moral dans l'antiquité à diverses époques ne
seraient pas sans intérêt, et nous avons essayé de faire ce qu'on pourrait appeler
de la psychologie historique en un certain nombre de chapitres distincts, mais qui
ne sont pas sans liaison, qui se soutiennent mutuellement.
Dans ce volume, l'Éloge funèbre chez les Romains laisse voir quel sentiment
civique animait les grandes cérémonies funéraires en un temps où Rome, naïve
encore et peu lettrée, avait déjà la conscience de sa grandeur future. Le
philosophe Carnéade à Rome nous fait assister au premier éveil de la curiosité
philosophique et de la science morale chez un peuple qui jusque-là n'avait été
que politique et guerrier. Les consolations dans l'antiquité permettent de se
figurer les entreprises ou généreuses, ou ridicules de la philosophie sur la
douleur. L'examen de conscience met en lumière les désirs de perfection
intérieure qui s'étaient emparés de certaines écoles. Enfin, au moment où la
philosophie et l'ancienne religion sont aux prises avec le christianisme, on voit
par deux illustres exemples ce que pouvaient être un chrétien devenu païen et
un païen devenu chrétien.
A. de telles études ne convient pas l'appareil de l'érudition. On ne peint pas les
âmes avec des gloses. Sans doute un auteur, en ce sujet comme en tout autre,
doit observer les règles d'une sévère critique et s'appuyer sur des textes ; mais il
n'est pas tenu de verser toutes ses notes devant le lecteur. C'est à l'écrivain de
mériter du crédit par la clarté de son exposition, la vraisemblance de ses
tableaux, la sincérité manifeste de son style. Le public se plaint quelquefois, non
sans raison, que l'antiquité devienne de plus en plus un domaine réservé aux
seuls initiés, entouré de barrières épineuses, comme, pour tenir à distance les
profanes. Nous voudrions, au contraire, qu'elle fût accessible par plus d'un côté à
tous les esprits cultivés, aux jeunes gens, même aux femmes. Intéresser tout le
monde, si l'on peut, à l'histoire des idées morales, c'est faire une œuvre morale
soi-même.
Décembre 1882.

L'ÉLOGE FUNÈBRE CHEZ LES ROMAINS.
Quand Agrippine rapporta d'Orient les cendres de Germanicus, et que de Brindes
à Rome, de ville en ville, et tout le long de la route, elle eut traversé les
douloureux hommages d'une foule de toutes parts accourue et sans cesse
renaissante, Tibère, ne voulant pas voir se renouveler sous ses yeux les
témoignages d'un enthousiasme qui était une injure pour lui-même, ordonna que
les funérailles de son trop adoré neveu se feraient sans pompe. Le peuple
murmura : Où sont les institutions de nos ancêtres ? Quoi ! on refuse au héros
lés vers composés pour, perpétuer le souvenir de la vertu, on lui refuse encore
les honneurs usités de l'éloge funèbre !
1
C'était en effet un des plus antiques
usages de célébrer en des occasions et sous des formes diverses les hommes
illustres qui avaient bien servi la patrie, usage si antique que les premiers essais
de la littérature romaine s'y rattachent et en sont sortis. Avant qu'il y eût des
poètes à Rome, les jeunes garçons étaient amenés dans les festins pour chanter
aux sons de la flûte les exploits des› héros ; avant qu'il y eût des orateurs
politiques, on faisait sur le forum, dans un discours public, du haut d'une tribune,
l'éloge funèbre des nobles défunts. La poésie et l'éloquence ont donc leurs
lointaines racines dans ces vieilles et patriotiques institutions. Bien plus, comme
chaque famille patricienne conservait pieusement dans ses archives privées les
éloges de ses membres, les premiers écrivains qui tentèrent de raconter les
annales de Rome furent obligés de recourir, faute d'autres documents détaillés, à
ces documents domestiques, si bien que ces vieux usages donnèrent naissance
non seulement à la poésie et à l'éloquence, mais à l'histoire même. Pour ne
parler ici que de l'éloge funèbre, cette coutume qui remonte peut-être au temps
des rois, qui parait au grand jour dès l'établissement de la république, qui durait
encore sous l'empire, en excitant tant de regrets quand par hasard on y
dérogeait, une coutume si enracinée tenait au sentiment le plus profond du
peuple romain, au culte pour ses grands hommes, qui se confondait avec le culte
de la patrie. L'oraison funèbre à Rome n'est donc pas une invention littéraire des
temps cultivés, une cérémonie oratoire pour une assemblée de délicats : elle a
été naïvement créée par le peuple ou pour le peuple ; elle est sortie des mœurs,
elle a servi à les fortifier et à les maintenir, enfin elle a été comme une des
pièces les plus durables de l'éducation civique.
I
Rome, qui en littérature a presque tout emprunté aux Grecs, ne leur est pas
redevable de l'oraison funèbre. Ce sont les Romains qui ont imaginé ce genre
d'éloquence, et sur ce point ils ont devancé les Athéniens eux-mêmes. Cela est
affirmé par Denys d'Halicarnasse
2
et par Plutarque
3
, et le témoignage de ces
deux écrivains grecs mérite d'autant plus de crédit qu'il est plus désintéressé.
Denys assure que la première harangue funèbre fut prononcée à Rome seize ans
avant que les Athéniens se fussent avisés de célébrer ainsi les morts de
Marathon. Cette première harangue romaine fut celle que fit Valerius Publicola en
l'honneur de son collègue Brutus, qui avait chassé les Tarquins. Pour être né sur
1
Tacite, Annales, l. III, 5.
2
Antiq. romaines, l. V, 17.
3
Publicola, ch. 9.

le sol national, l'éloge funèbre à Rome eut des caractères particuliers qu'il n'eut
pas en Grèce. Chez les Romains, il était consacré à un homme ; chez les Grecs, il
était collectif, accordé seulement aux guerriers tombés ensemble dans une
bataille ou dans une même campagne. Ainsi furent honorés par Périclès les
soldats morts dans la guerre du Péloponnèse et par Démosthène ceux de
Chéronée. De là selon Denys, un autre caractère distinctif : en Grèce, on ne
célébrait que le courage, puisqu'il ne s'agissait que de héros militaires ; à Rome,
on vantait encore les vertus civiles. On voit ici comment la diversité des
institutions s'impose même à l'éloquence. La démocratique Athènes, la
république jalouse qui avait inventé l'ostracisme, se garde bien de glorifier ses
grands citoyens, de peur d'exalter l'orgueil des familles et de susciter un
nouveau Pisistrate ; l'aristocratique Rome, au contraire, se fait .un devoir d'offrir
à l'admiration du peuple les hommes distingués des maisons patriciennes et ne
craint pas de les couvrir de gloire : cette gloire rejaillit sur tout le patriciat.
L'histoire de l'éloge funèbre est courte, parce que les écrivains latins des siècles
lettrés ne fournissent que bien peu de renseignements. Leur dédain ou leur
silence tient à plusieurs causes. D'abord ils n'étaient pas en général curieux de
connaître les anciens monuments littéraires de Rome, dont ils méprisaient la
langue vieillie et rude. Au temps d'Auguste, la délicatesse des esprits négligeait
l'antiquité romaine, comme au temps de Louis XIV elle ignorait le moyen âge.
L'ancienne éloquence funèbre de Rome passa donc inaperçue, comme du reste
l'éloquence politique du même temps, sur laquelle nous saurions peu de chose,
s'il ne s'était rencontré dans les siècles de décadence des grammairiens, raffinés
aussi, mais à rebours, blasés sur l'art régulier des œuvres classiques et qui, dans
leur admiration rétrospective pour la demi-barbarie des vieux âges, nous ont
conservé des fragments et des phrases des plus anciens orateurs. Pour des
raisons particulières, l'éloquence funèbre dut même être négligée plus que tout
autre. Ces sortes de harangues étaient trop fréquentes, puisqu'on en prononçait
à toutes les funérailles patriciennes, et que peu à peu ces honneurs furent
prodigués, même dans les municipes, aux plus minces personnages, hommes ou
femmes, ainsi qu'en témoignent les inscriptions des tombeaux. L'accoutumance
ôtait donc de leur intérêt à ces discours. A cette banalité s'ajoutait celle de la
composition, qui ne pouvait guère varier, l'usage voulant que l'on fit toujours
avec l'éloge du mort celui de tous ses ancêtres. Combien de fois a-t-on dû faire,
dans la suite des temps, celui des Cornelius, des Fabius ou des héros de quelque
illustre et nombreuse famille ! L'uniformité de ces discours était inévitable. Chose
plus fâcheuse, comme la coutume exigeait que le discours fût prononcé par le
plus proche parent du défunt, l'orateur, se trouvant désigné par d'autres raisons
que son éloquence, pouvait n'être pas éloquent, et c'est bien d'aventure quand il
l'était. Enfin l'éloquence funèbre, eût-elle le plus grand éclat, ne pouvait laisser
de vifs et durables souvenirs, parce que, calme de sa nature, elle n'offrait pas le
dramatique intérêt des grandes luttes politiques et judiciaires qui chaque jour
agitaient les esprits ; elle était bien vite oubliée au milieu de ce bruit sans cesse
renaissant et noyée dans les tempêtes civiles. Si ce sont des étrangers, des
Grecs séjournant à Rome, Polybe surtout, qui nous ont laissé sur ces coutumes
les plus intéressants détails, c'est que la nouveauté du spectacle leur offrait
encore des surprises et parlait à leurs yeux et à leur âme. Nous ne voulons pas
peindre en ce moment ce spectacle des funérailles illustres avec leur long
cortège de musiciens, de pleureuses chantant les louanges du mort, de chars
portant les images de ses ancêtres, immense cérémonie où le peuple était
officiellement convoqué, où il accourait comme à la célébration d'un lugubre
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
1
/
123
100%