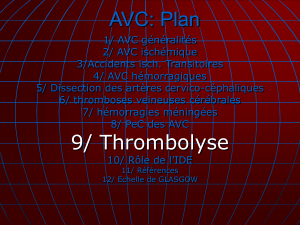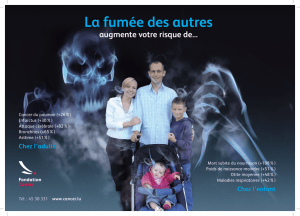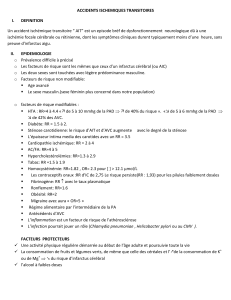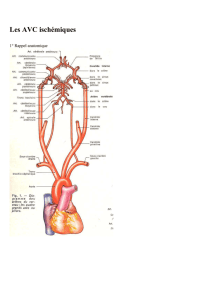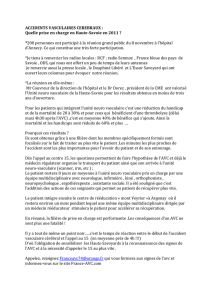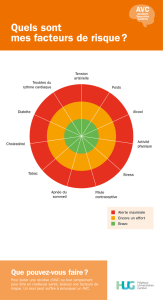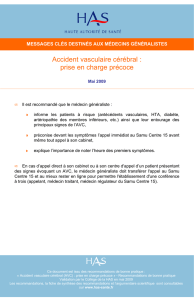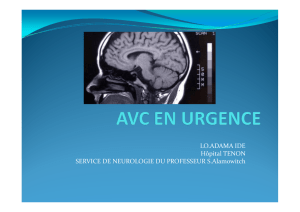Lire l'article complet

■Coordinateur : P. Amarenco
revue de presse spécialisée
résumé et analyse d’articles sélectionnés
Au cours de ces der-
nières années, plu-
sieurs publications ont
laissé entrevoir le
bénéfice potentiel des
statines pour la prévention de la morbimor-
talité vasculaire, y compris celle des acci-
dents vasculaires cérébraux, et ce principale-
ment chez les patients aux antécédents
coronariens. La Heart Protection Study,
récemment publiée, semble confirmer ces
données sur une population de patients à
risque coronaire. Cette étude a évalué le
bénéfice sur 5 ans d’un traitement par simva-
statine 40 mg versus placebo dans une
population de patients âgés de 40 à 80 ans
dont la cholestérolémie initiale était supé-
rieure ou égale à 3,5 mmol/l. Les patients
étaient inclus en raison d’un risque coronaire
a priori élevé, du fait soit de l’existence d’an-
técédents coronariens (infarctus du myo-
carde, angor stable ou instable, revasculari-
sation coronaire), soit de l’existence d’une
pathologie artérielle occlusive non coronaire
(AVC non hémorragique, endartérectomie
carotide, artériopathie oblitérante des
membres inférieurs) ou de la présence
d’autres facteurs de risque vasculaire tels
qu’un diabète ou une hypertension arté-
rielle, et ce uniquement pour les hommes de
plus de 65 ans pour cette dernière condition.
Sur une population de plus de
63 600 patients initialement évalués, dont
32 145 ayant participé à la phase de run-in,
20 536 patients ont finalement été randomi-
sés, dont 3 280 ayant déjà présenté un
infarctus cérébral ou un AIT. La compliance
au traitement était de 85 % dans le groupe
simvastatine, et près de 17 % des patients
sous placebo recevaient une autre statine au
cours de l’étude. Dans l’analyse en “inten-
tion de traiter”, la diffé-
rence moyenne du LDL-
cholestérol n’était ainsi
que de 1 mmol/l. La
mortalité à 5 ans était
significativement diminuée (12,9 % versus
14,7 % ; p = 0,0003), principalement en rai-
son d’une réduction de 18 % de la mortalité
coronarienne. Il était par ailleurs mis en évi-
dence une réduction d’environ 25 % de la
survenue des événements vasculaires sui-
vants : infarctus du myocarde non fatal ou
mort coronarienne (8,7 versus 11,8 % ;
p<0,0001), AVC fatal et non fatal (4,3 versus
5,7 % ; p <0,0001) et gestes de revasculari-
sation coronaire ou non coronaire (9,1 versus
11,7 % ; p <0,0001). Par ailleurs, la réduc-
tion de ces événements demeurait similaire
quels que soient la pathologie vasculaire
sous-jacente, le sexe, l’âge ou encore le
niveau du cholestérol initial. Enfin, le traite-
ment était bien toléré.
Commentaires : Cette étude semble confir-
mer le bénéfice d’une statine en prévention
de la morbimortalité vasculaire chez des
patients à haut risque coronarien. Il semble
d’ailleurs qu’une bonne partie du bénéfice
de ce traitement résulte de la réduction des
événements coronaires fatals ou non.
Malheureusement, peu d’explications sont
fournies sur le fait que moins de 35 % des
patients initialement évalués ont finalement
été inclus. On regrette aussi de n’avoir pas
plus de détails sur les 3 280 patients qui
avaient un antécédent d’infarctus cérébral
ou d’AIT. Il reste difficile, au regard de ces
résultats, de proposer systématiquement un
traitement par statine au décours des AVC
ischémiques. Gageons que l’étude SPARCL
(Stroke Prevention by Agressive Reduction of
Cholesterol Level ; Atorvastatine 80 mg) per-
mettra d’apporter des
éléments de réponse
précis à cette question
essentielle.
D. Deplanque (Lille)
❐Heart Protection Study
Collaborative Group. MRC/BHF
Heart Protection Study of
cholesterol lowering with
simvastatin in 20 536 high-risk
individuals : a randomized
placebo-controlled trial.
Lancet 2002 ; 360 : 7-22.
U
NE STATINE POUR TOUS
?
L’article
coup de cœur
106
Correspondances en neurologie vasculaire - n° 3 - Vol. II - juillet-août-septembre 2002
Expérimental
Hématome intracérébral :
le “trou noir”
Hémorragie cérébrale induite
par rt-PA dans un modèle animal
d’angiopathie amyloïde
Hémorragies
cérébrales
Risque de récidive
après hémorragie cérébrale
Épidémiologie
et causes
Marqueurs
de l’inflammation
et de l’hémostase et événements
vasculaires après infarctus cérébral
Ultrasons
Doppler transcrânien (DTC),
outil indispensable
Thrombolyse par le DTC
Apnées du sommeil :
marqueur
de risque d’athérosclérose ?
Imagerie
Comparaison des mesures quantitatives
de temps de transit moyen par IRM
au 133Xe SPECT avant et après un test
à l’acétazolamide en pathologie
occlusive cérébro-vasculaire
Prédiction du risque hémorragique
par une mesure de l’ADC
Phase aiguë
Infarctus sylvien malin :
hémicrâniectomie contre hypothermie
Thrombolyse combinée i.v./i.a. pour
l’occlusion de la carotide interne
Prêt pour le Réopro®?
Rééducation, séquelles
physiques et cognitives
“Une fatigue mortelle”
Docteur, quel est votre pronostic ?
Heart Protection Study
20 536 patients âgés de 40 à 80 ans, à haut risque coronaire,
sous simvastatine 40 mg ou placebo pendant 5 ans.
STATINE PLACEBO Risque ratio
(10 269) (10 267) Simvastatine Placebo
meilleure meilleur
Mortalité
Toutes causes 1 328 (12,9 %) 1 507 (14,7 %) Réduction 13 % ; p = 0,0003
Causes vasculaires 781 (7,6 %) 937 (9,1 %) Réduction 18 % ; p < 0,0001
Événements vasculaires
Événement coronaire
majeur 898 (8,7 %) 1 212 (11,8 %) Réduction 27 % ; p < 0,0001
AVC 444 (4,3 %) 585 (5,7 %) Réduction 25 % ; p < 0,0001
Revascularisation 939 (9,1 %) 1 205 (11,7 %) Réduction 24 % ; p < 0,0001
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

107
Correspondances en neurologie vasculaire - n° 3 - Vol. II - juillet-août-septembre 2002
Expérimental
H
ÉMATOME INTRACÉRÉBRAL
:
LE
“
TROU NOIR
”
Les modifications tissulaires à dis-
tance d’une hémorragie intracéré-
brale survenant à long terme ont été
rarement étudiées. L’équipe de
Felberg et al. a le mérite de les avoir
évaluées au niveau cellulaire
100 jours après l’injection de sang
autologue dans le striatum chez des
rats. Ces auteurs ont mesuré la den-
sité cellulaire dans des régions céré-
brales controlatérales 100 jours après
l’hémorragie intracérébrale, et dans
la périphérie proche de l’hématome
un jour et une semaine après la
lésion. Les résultats montrent l’ab-
sence de modifications du nombre ou
de la densité neuronale dans les
régions hémisphériques controlaté-
rales (striatum et région périphé-
rique), et à l’inverse, une réduction de
la densité cellulaire dans la substance
noire homolatérale. Dans la région
immédiatement périphérique à l’hé-
matome, une réduction précoce de la
densité cellulaire est observée, en
l’absence de tout œdème cytotoxique.
Les cellules concernées sont “cyto-
chrome c positive” suggérant une
apoptose en cours, qui pourrait être
favorisée par la libération cellulaire
de substance toxiques ; le rôle du NO
est suggéré par l’augmentation du
nombre de cellules ayant une activité
iNOS augmentée.
Commentaires : Les résultats concernant
les modifications microstructurales surve-
nant à distance de l’hématome sont déce-
vants. Cette étude apparaît très incom-
plète, car seules cinq régions d’intérêt ont
été évaluées dans les régions homolaté-
rales à la lésion hémorragique. L’originalité
du travail est d’avoir mis en évidence une
zone en immédiate bordure de l’hématome
dégénérant précocement selon un méca-
nisme d’apoptose, la cicatrice de l’héma-
tome se situant dans une zone acellulaire
pouvant être considérée comme un “trou
noir” sans véritable transition avec le tissu
normal. L’autre intérêt de ce travail est de
confimer l’absence de tout phénomène
“ischémique” en périphérie de la lésion
hémorragique, déjà suggéré par des tra-
vaux d’imagerie précédents.
Hugues Chabriat
(Service de neurologie,
hôpital Lariboisière, Paris)
❐Cell death in experimental hemorrhage : “The black
hole” model of hemorrhagic damage. Felberg et al. Ann
Neurol 2002 ; 51 : 517-24.
H
ÉMORRAGIE CÉRÉBRALE INDUITE
PAR RT
-PA
DANS UN MODÈLE ANIMAL
D
’
ANGIOPATHIE AMYLOÏDE
Winkler et al. ont étudié l’effet d’une
dose modérée, et d’une dose élevée de
rt-PA comparativement à l’administra-
tion de sérum physiologique injecté
par voie veineuse chez des souris
APP23 qui présentent les aspects
caractéristiques de l’angiopathie amy-
loïde humaine. Des microhémorragies
sont observées chez toutes les souris,
mais le nombre de ces lésions est aug-
menté chez les souris traitées par rt-
PA. Il existe en particulier, une corréla-
tion entre le nombre de
microhémorragies et le degré des
lésions pariétales avec une augmenta-
tion d’autant plus grande après admi-
nistration de rt-PA. Une hémorragie
plus importante n’est observée que
dans 1 cas sur 9 avec le rt-PA à faible
dose, dans 2 cas sur 11 avec le rt-PA à
forte dose. Les trois animaux ayant
des hématomes intracérébraux avaient
tous un grand nombre de microlésions
hémorragiques et présentaient des cel-
lules microgliales contenant de l’hé-
mosidérine au contact de la lésion
hémorragique, suggérant la présence
préalable des microsaignements
anciens à ce niveau.
Commentaires : Ces résultats confirment
que l’angiopathie amyloïde représente un
risque non négligeable de transformation
hémorragique lors du traitement par rt-PA
à la phase aiguë des infarctus cérébraux.
Ils incitent à l’utilisation systématique de
l’IRM cérébrale avec des séquences en
écho de gradient pour recherche des
microsaignements (microbleeds en
anglais) plus fréquents au cours de l’an-
giopathie amyloïde pouvant favoriser cette
complication comme l’ont déjà suggéré
des publications récentes chez l’homme.
HC
❐Winkler et al. Thrombolysis induces cerebral hemor-
rhage in a mouse model of cerebral amyloid angiopathy.
Ann Neurol 2002 ; 51 : 790-3.
Hémorragies
cérébrales
R
ISQUE DE RÉCIDIVE APRÈS HÉMORRAGIE
CÉRÉBRALE
Peu de données existent sur le risque
de récidive après une première
hémorragie cérébrale. Dans cette
étude, les auteurs ont suivi
243 patients ayant eu une première
hémorragie cérébrale pendant une
durée moyenne de 5,5 ans. Ils ont
enregistré les récidives d’hémorragie,
tout autre événement vasculaire et les
décès. Ils ont aussi évalué les fac-
teurs pouvant favoriser la récidive.
Le risque annuel de récidive hémorra-
gique était de 2,1 % (IC à 95 %, 1,4 à
3,3 %), de tout événement vasculaire
de 5,9 % (4,5 à 7,7 %) et de décès de
3,2 % (2,2 à 4,5 %). Le risque était
plus élevé pour un âge supérieur à
65 ans (3,7 %) pour les hommes. Le
risque était trois fois supérieur si le
patient était sous anticoagulant (pour
une fibrillation auriculaire, une embo-
lie pulmonaire, une prothèse valvu-
laire, une maladie artérielle occlusive)
avec un odds-ratio de 3,0 (1,3 à 7,2).
Commentaires : Le risque de récidive d’une
hémorragie cérébrale apparaît nettement
plus faible que celui d’un accident isché-
mique cérébral. Les patients les plus à
risque sont ceux traités par anticoagulant.
Il est vraisemblable que le faible nombre
de patients de cette cohorte explique que
l’hypertension artérielle n’apparaît pas

108
Correspondances en neurologie vasculaire - n° 3 - Vol. II - juillet-août-septembre 2002
revue de presse spécialisée
résumé et analyse d’articles sélectionnés
comme facteur prédicteur d’une récidive :
on sait, depuis l’étude PROGRESS, que
dans ce groupe de patients l’association
perindopril-Fludex®diminue considérable-
ment le risque de récidive.
Pierre Amarenco
(Centre d’accueil et de traitement de l’attaque
cérébrale, hôpital Bichat, Paris)
❐Vermeer SE et al. Long-term prognosis after recovery
from primary intracerebral hemorrhage. Neurology
2002 ; 59 : 205-9.
Épidémiologie
et causes
M
ARQUEURS DE L
’
INFLAMMATION
ET DE L
’
HÉMOSTASE ET ÉVÉNEMENTS
VASCULAIRES APRÈS INFARCTUS CÉRÉBRAL
Les niveaux de CRP, de fibrinogène et
de D-dimères ont été mesurés dans les
24 premières heures chez 473 patients
consécutifs ayant eu un premier infarc-
tus cérébral et hospitalisés entre 1998
et 1999. Les patients ayant une infec-
tion évolutive, un traumatisme majeur,
une intervention chirurgicale récente
ou une néoplasie active ont été exclus.
Les patients inclus ont été suivis
durant deux ans. La médiane de l’âge
des patients était de 74 ans, 341 rece-
vaient préalablement un traitement
antithrombotique, 40 % étaient coro-
nariens. À un mois, 19,2 % des patients
avaient présenté un événement vascu-
laire et, à deux ans, 38,5 %. Il existait
une élévation non significative du taux
de D-dimères à l’inclusion chez les
patients qui avaient un événement vas-
culaire, fatal ou non, au cours du suivi.
Le taux de CRP était significativement
plus élevé chez les patients avec un
événement vasculaire (médiane
25 mg/l versus 9 mg/l) de même que
celui de fibrinogène (médiane 5,24 g/l
versus 4,22 g/l). Les taux de CRP et de
fibrinogène prédisaient également le
risque de récurrence d’AVC et d’événe-
ment cardiaque. La différence appa-
raissait précocement, dans les trois
mois suivant l’infarctus. Dans un
modèle multivarié, la CRP était le plus
puissant facteur prédictif d’événement
vasculaire : hazard ratio 4,04 (2,20-
7,42) pour un taux supérieur à 33 mg/l.
Commentaires : Cette étude est la pre-
mière à identifier l’élévation de la CRP
comme un facteur prédictif de récidive
d’événement vasculaire après infarctus
cérébral, alors que le sous-type étiolo-
gique ne jouait pas de rôle (mais on ignore
la méthode de classement des sous-types
d’infarctus). Si ces résultats se confirment,
leur intérêt sera grand pour stratifier les
patients dans les essais de prévention
secondaire. Le fait qu’il s’agisse d’éléva-
tions franches de la CRP fait penser que
des infections non reconnues à l’arrivée
sont peut-être en cause. De plus, trouver
une relation entre les récidives d’infarctus
cérébral et l’élévation de la CRP montre
que cette relation ne passe sans doute pas
par un effet athérogène mais par une acti-
vation de la thrombose.
Philippe Niclot
(Centre d’accueil et de traitement de l’attaque
cérébrale, hôpital Bichat, Paris)
❐Di Napoli M, Papa F. Inflammation, hemostatic mar-
kers, and antithrombotic agents in relation to long-term
risk of new cardiovascular events in first-ever ischemic
stroke patients. Stroke 2002 ; 33 : 1763-71.
Ultrasons
D
OPPLER TRANSCRÂNIEN
(DTC),
OUTIL INDISPENSABLE
Les modifications hémodynamiques
de la perfusion cérébrale observées
après un infarctus hémisphérique ont
été appréciées par la pratique répé-
tée d’un DTC (24 premières heures,
entre la 24eet la 48eheure et entre le
4eet le 8ejour après l’ictus) sur
47 patients. Tous ont eu une ARM
(angiographie par résonance magné-
tique) du polygone et du cou dans les
72 premières heures. Le DTC, initiale-
ment normal chez 17 patients, mon-
trait une dégradation de flux chez un
patient au cours du suivi alors que
l’ARM était normale. Dans 12 cas où
le DTC initial et l’angio-IRM mon-
traient une occlusion artérielle intra-
crânienne, le suivi DTC a permis de
montrer une recanalisation dans
6cas, une sténose résiduelle dans
1cas et une détérioration du flux
dans 1 cas. Dans 5 cas où l’ARM était
normale, le DTC ultra-précoce prou-
vait qu’il s’agissait d’une recanalisa-
tion. Chez les patients présentant une
sténose proximale de l’artère céré-
brale moyenne (4 cas) ou une occlu-
sion/sténose de l’artère carotide
interne (5 cas), le DTC a permis d’ap-
précier les différents profils de colla-
téralité non discernables sur l’ARM.
Commentaires : Au même titre que l’ARM,
le DTC doit faire partie intégrante des
moyens utilisés dans la prise en charge de
l’AIC à sa phase aiguë. Les modifications
hémodynamiques de la perfusion céré-
brale observées après un infarctus sont
très variables et dépendantes du facteur
temps. Aussi le DTC y trouve-t-il toute sa
justification par sa capacité à évaluer les
paramètres hémodynamiques, de façon
répétée et rapide au lit du patient. Il est
complémentaire de l’ARM, examen mor-
phologique et statique, plus difficilement
accessible. Il devient un outil de choix à
l’heure du développement de la thrombo-
lyse.
Pierre Garnier
(Service de neurologie, hôpital Bellevue,
Saint-Étienne)
❐Akopov S et al. Hemodynamic studies in early ische-
mic stroke. Serial transcranial doppler and magnetic
resonance angiography evaluation. Stroke 2002 ; 33 :
1274-9.
T
HROMBOLYSE PAR LE
DTC
Des travaux récents font part du pos-
sible effet thrombolytique des ultra-
sons (US). Les auteurs ont étudié in
vivo chez des lapins l’effet thromboly-
tique des US lors du DTC sur une
occlusion thrombotique expérimen-
tale de l’artère fémorale. Les US
étaient appliqués au travers d’un
fragment d’os temporal humain et
avaient la particularité d’être de fré-

quence et d’intensité faibles. Dans le
groupe traité par thrombolyse i.v.
(mtPA) et US (n = 9), le taux de reca-
nalisation artérielle était de 66 %,
dans le groupe uniquement traité par
mtPA i.v. (n = 12), le taux de recanali-
sation n’était que de 16 %. Le taux de
recanalisation devenait signicatif
dans le groupe US + mtPA i.v. par rap-
port au groupe mtPA i.v. seul, dans les
20 à 30 minutes qui suivaient le début
de la thrombolyse i.v.
Commentaires : Un des intérêts de cette
étude par rapport aux précédentes est
celui d’avoir choisi des US de faibles fré-
quence et intensité, permettant ainsi une
meilleure pénétration tissulaire et d’accé-
lérer l’effet thrombolytique tout en préser-
vant l’intégrité du tissu soumis aux US. Le
DTC réunit de multiples potentialités, non
seulement diagnostiques (occlusion arté-
rielle, évaluation des collatérales, de la
reperméabilisation, etc.) mais aussi théra-
peutiques (thrombolyse), et dont la
maniabilité en fait un outil-clé à la phase
aiguë de l’AVC. Il reste à démontrer que les
résultats de cette étude sont extrapolables
à l’homme.
PG
❐Ishibashi T et al. Can transcranial ultrasonication
increase recanalization flow with tissue plasminogen
activator ? Stroke 2002 ; 33 : 1399-404.
A
PNÉES DU SOMMEIL
:
MARQUEUR
DE RISQUE D
’
ATHÉROSCLÉROSE
?
Plusieurs études épidémiologiques
ont montré qu’il existait un lien entre
syndromes d’apnées du sommeil
(SAS) et infarctus cérébral (AIC).
Plusieurs mécanismes ont été propo-
sés : modifications de l’hémodyna-
mique cérébrale, augmentation de la
viscosité plasmatique, troubles du
rythme cardiaque, etc. Mais ces hypo-
thèses physiopathologiques restent à
vérifier.
Dans cette étude, Silvestrini et al. ont
émis l’hypothèse que le SAS favorisait
le développement de l’athérosclérose.
Pour cela, ils ont comparé l’épaisseur
intima-média (EIM) de la carotide com-
mune de 23 patients présentant un
SAS sévère avec celle de 23 témoins
(sans SAS), appariés sur l’âge, l’exis-
tence et la gravité de facteurs de
risque vasculaire (tabac, HTA, diabète,
BMI, dyslipidémie). Aucun des sujets
ne présentait d’AIC. L’EIM était signifi-
cativement plus élevée dans le groupe
SAS (1,429 ± 0,34 versus 0,976 ±
0,17 mm ; p <0,0001). Pour les auteurs,
la progression de l’athérosclérose au
cours du SAS s’expliquerait par la
“multiplicité de l’agression artérielle”.
En effet, le SAS est responsable d’épi-
sodes d’hypoxies et de variations bru-
tales de la pression artérielle et de la
viscosité sanguine qui sont délétères
pour la paroi, et il survient souvent
chez les sujets avec facteurs de risque
d’athérosclérose donc ayant déjà une
paroi agressée.
Commentaires : Si le SAS favorise le déve-
loppement de l’athérosclérose, il reste
encore à démontrer qu’il augmente le
risque d’AIC lié à l’athérosclérose ou que le
traitement du SAS prévient la progression
de la maladie. Notons que l’étude n’in-
cluait que les SAS sévères.
En pratique, gardons à l’esprit que cette
association existe et soyons attentifs aux
troubles respiratoires du sommeil chez
nos patients vasculaires.
Philippa Lavallée
(Service de neurologie, hôpital Bichat, Paris)
❐Silvestrini M, Rizzato B, Placidi F et al. Carotid artery
wall thickness in patients with obstructive sleep apnea
syndrome. Stroke 2002 ; 33 : 1782-5.
Imagerie
C
OMPARAISON DES MESURES
QUANTITATIVES DE TEMPS DE TRANSIT
MOYEN PAR
IRM
AU
133
X
E
SPECT
AVANT ET APRÈS UN TEST
ÀL
’
ACÉTAZOLAMIDE EN PATHOLOGIE
OCCLUSIVE CÉRÉBRO
-
VASCULAIRE
Les auteurs ont étudié 17 patients por-
teurs de sténoses ou d’occlusions d’une
ou plusieurs artères intracrâniennes,
diagnostiquées par angiographie numé-
risée. L’hémodynamique cérébrale a
successivement été étudiée par :
– IRM de perfusion avec étude du pre-
mier passage du gadolinium et calcul
quantitatif du temps de transit moyen
(MTT) après calcul de la fonction d’en-
trée artérielle et déconvolution ;
– SPECT avant et après injection d’un
gramme d’acétazolamide permettant
de classer la réserve perfusionnelle en
sévèrement diminuée (pourcentage
d’augmentation du flux sanguin après
acétazolamide ≤ 0 %), modérément
diminuée (pourcentage d’augmenta-
tion >0, mais ≤ 15 %), ou normale
(pourcentage d’augmentation >15 %).
Les auteurs montrent que le MTT
obtenu en IRM est bien corrélé à la
chute de réserve hémodynamique
mesurée en SPECT après un test au
Diamox®. Les valeurs de MTT sont plus
élevées (0,62 ± 1,84 s) en cas de
réserve perfusionnelle sévèrement
diminuée qu’en cas de réserve perfu-
sionnelle normale (6,15 ± 1,06 s) ou
modérément diminuée (6,54 ± 0,19 s).
Commentaires : Ces données suggèrent
que la réserve hémodynamique cérébrale
puisse être appréciée simplement par des
mesures de MTT en IRM sans injection
d’acétazolamide.
C. Oppenheim (Service de neuroradiologie,
hôpital Sainte-Anne, Paris)
❐Kikuchi K, Murase K, Miki H et al. Quantitative eva-
luation of mean transit times obtained with dynamic
susceptibility contrast-enhanced MR imaging and with
(133)Xe SPECT in occlusive cerebrovascular disease.
Am J Roentgenol 2002 ; 179 : 229-35.
SAS : un nouveau marqueur d’athérosclérose ?
• Étude cas-témoin : mesure de l’EIM sur la carotide
commune chez 23 SAS sévères et 23 témoins
appariés (âge, FDR)
• L’EIM était augmentée au cours du SAS par rapport
aux témoins (1,429 ± 0,34 versus 0,976 ± 0,17 mm)
• Mécanismes : agression vasculaire par l’hypoxie,
par les brusques variations de la PA et par les
FDR souvent associés au SAS ?
SAS
Témoins
1,5
1
0,5
0
EIM
109
Correspondances en neurologie vasculaire - n° 3 - Vol. II - juillet-août-septembre 2002

110
Correspondances en neurologie vasculaire - n° 3 - Vol. II - juillet-août-septembre 2002
revue de presse spécialisée
résumé et analyse d’articles sélectionnés
P
RÉDICTION DU RISQUE HÉMORRAGIQUE
PAR UNE MESURE DE L
’ADC
Quelques travaux ont suggéré qu’il
était possible de prédire le risque de
transformation hémorragique (TH)
chez les patients ayant un infarctus
cérébral par une mesure du coefficient
de diffusion apparent (ADC). Le seuil
d’ADC de 550 10-6 mm2/s semble être
prédictif. Parmi 29 patients analysés
rétrospectivement, examinés en IRM et
traités par rt-PA dans les 3 heures de
l’accident ischémique, 17 ont déve-
loppé une TH (prouvée en IRM T2* ou
en scanner), dont 4 symptomatiques et
fatales. Les facteurs prédictifs de TH
étaient la pression artérielle systo-
lique, le score NIHSS à l’admission, le
taux de globules blancs et de pla-
quettes, la glycémie, un tabagisme
actif, le volume lésionnel sur l’IRM de
diffusion initiale et le nombre de
voxels avec une valeur d’ADC ≤ 550 10-
6mm2/s. Dans l’analyse multivariée,
seul le nombre de voxels avec une
valeur d’ADC ≤ 550 10-6 mm2/s restait
significatif (OR = 1,2 ; p = 0,04). Les 4
patients qui ont eu une hémorragie
intracérébrale symptomatique avaient
un déficit neurologique plus sévère, un
volume lésionnel plus important sur
l’IRM initiale et un nombre de voxels
avec une valeur d’ADC ≤ 550 10-6 mm2/s
plus important que ceux qui ont eu
une hémorragie asymptomatique.
Commentaires : Bien que rétrospective
(12 patients ont été exclus) et portant sur
un faible échantillon, cette étude confirme
que l’IRM est un outil très important pour la
prédiction du risque hémorragique avant
d’administrer un traitement thromboly-
tique. Ces résultats méritent toutefois
d’être confirmés par des études prospec-
tives étudiant plus particulièrement les
hémorragies symptomatiques. De plus, les
seuils volumiques d’ADC ≤ 550 10-6 mm2/s et
les topographies à risque restent à préciser.
E. Touzé (Service de neurologie,
hôpital Sainte-Anne, Paris)
❐Selim M, Fink JN, Kumar S et al. Predictors of hemor-
rhagic transformation after intravenous recombinant
tissue plasminogen activator. Prognostic value of the ini-
tial apparent diffusion coefficient and diffusion-weigh-
ted lesion volume. Stroke 2002 ; 33 : 2047-52.
Phase aiguë
I
NFARCTUS SYLVIEN MALIN
:
HÉMICRÂNIECTOMIE CONTRE HYPOTHERMIE
L’hémicrâniectomie (HC) et l’hypo-
thermie modérée à 33 °C (HM) sont
deux techniques qui peuvent être pro-
posées dans la prise en charge théra-
peutique de l’infarctus sylvien malin
(ISM). L’étude portait sur l’évolution
clinique de 36 patients avec un ISM
(touchant au moins deux tiers du terri-
toire de l’artère cérébrale moyenne)
traités soit par HC (hémisphère non
dominant atteint), soit par HM (hémi-
sphère dominant atteint). La mortalité
globale de 30,6 % (11 patients sur 36)
a été significativement plus élevée
dans le groupe HM (9 patients sur 19,
47 %) par rapport au groupe HC
(2 patients sur 17, 12 % ; p <0,02).
L’hypertension intracrânienne non
contrôlée étant la cause du décès
pour 10 patients sur 11. Des diffé-
rences ont également été observées
pour le score NIHSS (17 [16-18] versus
20 [18-22] respectivement pour l’HC et
l’HM ; p <0,002). Ces différences dis-
paraissant après correction du NIHSS
pour les troubles du langage. L’âge
(HC : 52 ± 5 ans, HM : 56 ± 6 ans ;
p=0,2), le sexe, le niveau de
conscience, le délai pour l’institution
du traitement, la durée de la ventila-
tion mécanique et de l’hospitalisation
en unités de soins intensifs n’ont pas
été différents entre les deux groupes.
Toutefois, la durée et les doses maxi-
males de catécholamines adminis-
trées ont été significativement plus
élevées dans le groupe HM (p = 0,02).
Commentaires : Sous réserve d’un effet posi-
tif sur le handicap, ces résultats favorables
sur la mortalité (plus basse que dans
d’autres séries rapportées dans la littérature)
renforcent la place de l’HC dans la prise en
charge thérapeutique des ISM. Les résultats
de l’étude DECIMAL actuellement en cours
sont donc attendus avec beaucoup d’intérêt.
M. Mazighi (Service de neuroradiologie,
hôpital Lariboisière, Paris)
❐Georgiadis et al. Hemicraniectomy and moderate
hypothermia in patients witn severe ischemic stroke.
Stroke 2002 ; 33 : 1584-8.
T
HROMBOLYSE COMBINÉE I
.
V
./
I
.
A
.
POUR
L
’
OCCLUSION DE LA CAROTIDE INTERNE
L’occlusion de la carotide interne (ACI)
se caractérise le plus souvent par une
résistance au traitement thromboly-
Prédiction du risque hémorragique
par une mesure de l’ADC
• 29 patients analysés rétrospectivement
• IRM diffusion réalisée dans les 3 heures
• Tous les patients traités par rt-PA
• IRM avec T2* ou scanner, réalisé 24-48 heures après
• 17 hémorragies dont 4 symptomatiques et fatales
TH+ TH- p
n = 17 n = 14
Volume lésion
en IRM diffusion 75,58 46,74 0,032
(cm3)
Voxels avec
un ADC 27,7 22,2 NS
≤ 550 10-6mm2/s
(%)
Nombre absolu 2 617 1 319 0,017
TH = transformation hémorragique
L’hémicrâniectomie supérieure à l’hypothermie dans l’infarctus sylvien malin
Hémicrâniectomie Hypothermie p
Patients 17 19
Âge 52 (47-57) 56 (50-63) 0,2
NIHSS, n17 (16-18) 20 (18-22) 0,002
Mortalité, n (%) 2/17 (12) 9/19 (47) 0,02
Norépinéphrine : 108 (76-126) 147 (122-176) 0,02
durée d’administration, h
Augmentation de la pression 6 (35) 10 (53) 0,3
intracrânienne > 20 mmHg, n(%)
 6
6
 7
7
1
/
7
100%