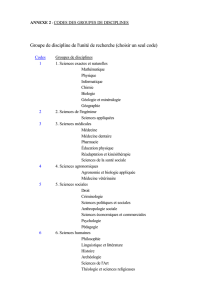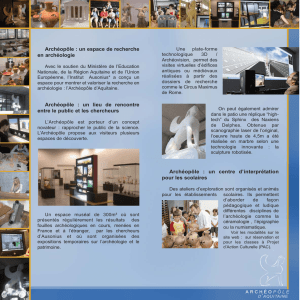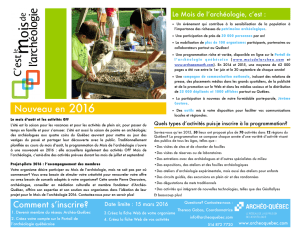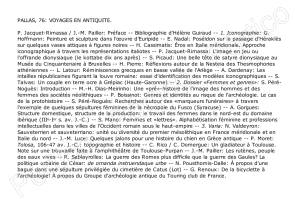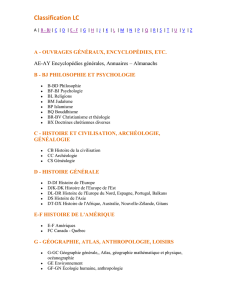Comment concevoir une collaboration entre

Bulletin de la Société préhistorique française 2006, tome 103, no 2, p. 385-395
Alain TESTART
Comment concevoir
une collaboration entre
anthropologie sociale
et archéologie ? À quel prix ?
Et pourquoi ?
Résumé
L’archéologie et l’anthropologie sociale ont des problématiques et des
intérêts théoriques très différents. Même les données recueillies par les
anthropologues sur le terrain sont dans leur majorité rarement compa-
rables à celles de l’archéologie. C’est pourquoi l’anthropologie telle
qu’elle est ne répond que très mal aux questions posées par les archéo-
logues. Cet article soutient que l’archéologie a besoin d’anthropologues
spécialisés, formés à ses problématiques ; ils chercheront, en fonction
d’elles, à recueillir sur le terrain ou dans les anciens rapports les données
ethnographiques utiles à la recherche archéologique, c’est-à-dire suscep-
tibles d’éclairer l’interprétation des données archéologiques.
Abstract
Archaeology and social anthropology have different problematic and
theoretical interests. Even ethnographical data cannot generally be
compared with archaeological data. It is why anthropologists at present
can only badly answer questions from archaeologists. It is argued here
that archaeology needs specialised anthropologists, trained in archaeolo-
gical issues and well aware of them ; only such anthropologists will be
able to identify, in the eld or in old reports, the data useful for archaeo-
logical research, i.e. which could throw some light on the interpretation
of archaeological data.
Le recours à l’ethnologie aux ns d’interpréter les
données archéologiques n’est pas un exercice nouveau.
Il a même ses lettres de noblesse. Antoine de Jussieu
s’y employait avec succès dès 1723 lorsque, dans un
texte court et incisif, il démontrait que les dites
« pierres de foudre » ne différaient ni par la morpho-
logie, ni par la fonction, des tomahawks encore
employés par les Amérindiens de l’époque. Toutefois,
le comparatisme a assez mauvaise presse de nos jours,
tout autant d’ailleurs en archéologie – où le mot
désigne la comparaison entre données archéologiques
et données ethnographiques – qu’en anthropologie – où
ce même mot désigne la comparaison des seules
données ethnographiques entre elles. Mais c’est seu-
lement le premier qui nous intéresse ici et il convient
peut-être, au préalable, d’écarter quelques malenten-
dus.
Tout d’abord sur notre questionnement. Il est :
comment le savoir anthropologique peut-il être utile à
l’archéologie ? Comment peut-il servir à interpréter les
données archéologiques ? Non pas que je tienne les
théories anthropologiques en haute estime et loin de
moi l’idée de forcer, ou d’imposer, ces théories sur les
données archéologiques. Je considère plutôt cette dis-
cipline – à laquelle j’appartiens – comme encore dans
l’enfance, la plupart de ses concepts comme encore

386 Alain TESTART
Bulletin de la Société préhistorique française 2006, tome 103, no 2, p. 385-395
balbutiants, et plus encline, par l’esprit qui l’anime,
aux grandes dissertations à teneur philosophique qu’à
l’exercice de la rigueur scientique. Mais l’anthropo-
logie ne se résume pas aux théories qui, hier, ont fait
sa célébrité. C’est aussi un vaste corpus d’observations
innombrables faites tant par les missionnaires, les
administrateurs que les anthropologues professionnels,
un corpus dont on méconnaît généralement la richesse
et qui nous renseigne sur des pratiques sociales dont
nous n’avons aucun exemple dans nos sociétés ni dans
notre histoire. Ce corpus est immense et n’a été encore
que fort peu exploré. Ou, s’il l’a été, ce fut seulement
dans l’espoir de conforter telle ou telle théorie anthro-
pologique. Mais il peut l’être aussi dans celui de
répondre à tel ou tel questionnement archéologique,
au moins pour lui fournir des hypothèses possibles.
De l’ethnoarchéologie, il ne sera pas ici question.
Comme je la comprends (mais le mot a des acceptions
assez diverses), il s’agit d’une sorte d’ethnographie
expérimentale menée par des archéologues aux ns
explicites d’interpréter des données archéologiques en
provenance du passé. Ces ns explicites assurent que
les observations collectées seront utiles, c’est-à-dire
interprétables, en termes archéologiques. Cette
méthode est très utile et a produit quelques résultats
remarquables que je ne méconnais pas, surtout dans le
domaine de la technologie ou de l’organisation spa-
tiale. Mais elle a ses limites. Car on ne va pas expéri-
menter sur le sacrifice humain. Pas plus qu’on ne
pourra observer maintes autres pratiques sociales parce
qu’elles ont depuis longtemps disparu sous les coups
conjugués des missionnaires, du colonisateur et des
marchands. D’où la nécessité de recourir à des obser-
vations anciennes (ethno-historiques) et nullement
reproductibles. C’est ce que nous fournit ce corpus
dont je parlais au paragraphe précédent.
Notre dernier point concernera A. Leroi-Gourhan et
les leçons que je pense parfois mal entendues de son
enseignement. A. Leroi-Gourhan fut pour nous un
grand maître et le reste. Il nous a appris à ne pas se
contenter d’analogies faciles, à ne pas se contenter de
la ressemblance entre certaines peintures pariétales et
les pièges à poids des Amérindiens, à ne pas nous
laisser aller aux interprétations les plus hautes en cou-
leurs et les plus séduisantes parce qu’empreintes de
romantisme. Il a toujours prêché la rigueur. Mais,
surtout, il nous a appris à regarder le document archéo-
logique. À l’étudier, sérieusement et minutieusement.
À l’étudier, lui seul, aussi modeste soit-il, et à taire
notre imagination qui nous entraînait trop prompte-
ment vers les Iroquois ou les îles Marquises. Il a écrit
quelques pages contre le comparatisme sans règle qui
a pu régner dans les premiers temps de la Préhistoire
(et de la Protohistoire). Mais on en tire à tort, je crois,
la conclusion que l’ethnologie serait inutile en archéo-
logie et tout comparatisme mauvais. Il faut étudier le
document archéologique. Oui. Et, pour tenter de vali-
der l’hypothèse interprétative que l’on fait à son pro-
pos, il convient de ne tenir compte que des particula-
rités de ce document. Oui. Dans son étude des
documents, l’archéologie doit oublier l’ethnologie ;
elle a ses méthodes propres. Dans la validation de ses
hypothèses, elle doit recourir à ses propres critères de
validation. Encore oui. Mais pour former des hypo-
thèses, pour avoir cette intuition qui conduit à la for-
mation d’hypothèses, pourquoi se priver du savoir
anthropologique ? Dans toute démarche scientique, il
existe des moments différents, des temps différents.
Celui de la validation des hypothèses doit être celui
de la rigueur : l’analogie doit en être bannie, et l’ana-
logie ethnologique tout autant. Mais le temps de la
formation des hypothèses est tout autre : l’intuition
joue à plein (même si l’on doit la récuser plus tard),
elle oriente la recherche, elle permet de former plu-
sieurs hypothèses concurrentes (pluralité sans laquelle
il ne peut exister de véritable moyen de vérication)
et toute intuition ne repose nalement que sur des
connaissances et un minimum d’érudition. Quand
A. Leroi-Gourhan propose son interprétation des pein-
tures pariétales en fonction d’un dualisme sexuel, il ne
s’appuie que sur les caractéristiques de ces peintures,
mais aurait-il pu former pareille hypothèse s’il n’avait
rien su du dualisme sexuel chez les Eskimo, ou de
l’importance du dualisme dans les sociétés primitives ?
A. Leroi-Gourhan fut ethnologue avant d’être archéo-
logue. Il put oublier l’ethnologie parce qu’il la connais-
sait. Et il la connaissait bien. C’est pourquoi il nous
paraît totalement aberrant de tirer de son exemple
l’idée que les archéologues devraient ignorer l’ethno-
logie. Car, en n’importe quel domaine, faire profession
d’ignorance n’a jamais été très fécond.
Nous revenons donc à notre question1 : comment
l’archéologie peut-elle utiliser l’ethnologie ? Et,
d’abord, comment l’a-t-elle fait pendant longtemps ?
LA VIEILLE MÉTHODE ILLUSTRATIVE :
CRITIQUE
J’appelle « illustrative », plutôt qu’analogique, une
méthode à laquelle l’archéologie a longtemps eu
recours pour mettre, pour ainsi dire, de la chair autour
de ses os, en empruntant des images aux peuples étu-
diés par les ethnologues. Ainsi, pour montrer que la
vie en Europe périglaciaire était possible au Paléoli-
thique, on évoqua les Eskimo. L’évocation se t même
si précise et si naïve que les images de la n du XIXe
siècle représentèrent couramment les hommes du Mag-
dalénien avec des vêtements copiés des Eskimo.
Gabriel de Mortillet ne fait guère autre chose lorsqu’il
publie son ouvrage Origines de la chasse, de la pêche
et de l’agriculture (1890). Cette manière de faire fut
certainement utile à une certaine phase du développe-
ment de l’archéologie : il s’agissait somme toute de
montrer que les restes, nalement assez rares (quel-
ques os, quelques morceaux de silex), retrouvés par
les préhistoriens pouvaient correspondre à une popu-
lation réelle vivant à cette époque lointaine. Montrer
l’analogie avec les Eskimo était utile : cela donnait de
la crédibilité à cette encore jeune science qu’était
l’archéologie préhistorique. Finalement, était-ce si
évident à tous que l’homme ait pu survivre avec seu-
lement le feu et quelques outils de silex au milieu des
mammouths et du froid glaciaire ? Le recours à l’illus-
tration ethnographique renforçait au moins l’idée que

Comment concevoir une collaboration entre anthropologie sociale et archéologie ? À quel prix ? Et pourquoi ? 387
Bulletin de la Société préhistorique française 2006, tome 103, no 2, p. 385-395
ces os de mammouths n’étaient pas ceux des éléphants
d’Hannibal.
La méthode illustrative par l’ethnographie n’est
point sotte. Si telle interprétation peut se prévaloir
d’un parallèle parmi les peuples actuels, cela signie
au moins qu’elle n’est pas invraisemblable. Son dan-
ger est que l’illustration, par sa force suggestive,
emporte l’adhésion ; et son défaut, qu’elle ne saurait
jamais constituer une preuve. Elle montre la vraisem-
blance de l’hypothèse retenue, mais n’en démontre
point la validité. Enn, cette « méthode » par l’illustra-
tion n’a elle-même pas de méthode dans le choix de
l’illustration ethnographique. On nous dit que tel
fossile retrouvé dans les fouilles ressemble à tel outil
utilisé par tel peuple connu ethnographiquement. Mais
est-on certain qu’il ne ressemble pas à tel autre outil,
utilisé à des ns toutes différentes, par tel autre peuple
et qui conduirait à une tout autre interprétation ? La
grande faiblesse de la méthode illustrative est qu’elle
est paresseuse : elle se contente de la première analo-
gie venue, généralement la plus connue, et elle ne s’est
pas donné la peine de chercher toutes les analogies
possibles. Parce que, si elle l’avait fait, elle ne se serait
pas contenté d’illustrer ; elle aurait su qu’il y avait
plusieurs illustrations possibles, plusieurs interpréta-
tions possibles, et se serait plutôt demandé : pourquoi
telle illustration et non pas telle autre ? Mais ç’aurait
été là une tout autre méthode, une méthode beaucoup
plus sérieuse et beaucoup plus difcile aussi. C’est
celle que nous préconisons.
PREMIÈREMENT :
DES QUESTIONS QUE POSENT LES ARCHÉOLOGUES
AUX ANTHROPOLOGUES
Tout d’abord, les bonnes questions que peuvent
poser les archéologues aux anthropologues – bonnes,
parce qu’elles appellent à une véritable collaboration
entre les deux disciplines – ne sont pas du type :
connaissez-vous une pratique sociale qui correspon-
drait à cette trouvaille archéologique ? Mais plutôt :
quelles sont les pratiques sociales qui pourraient cor-
respondre à cette trouvaille ? Ce type de questionne-
ment est meilleur parce qu’il force l’anthropologue à
explorer le champ de ses connaissances (au besoin en
l’étendant) pour chercher (éventuellement trouver) une
pluralité de réponses possibles : il l’oblige à un véri-
table travail. Il est meilleur aussi parce que cette plu-
ralité, d’autant qu’il s’agit d’une pluralité de possibles,
laissera une liberté décisive à l’archéologue : c’est lui
qui nalement choisira parmi toutes les réponses pos-
sibles proposées par l’anthropologue, et il le fera en
recourant à des critères propres à sa discipline.
Ce qu’il convient tout d’abord de comprendre, c’est
que toute question adressée par un archéologue à un
anthropologue (je suppose qu’elle l’est aux ns d’in-
terpréter des données archéologiques) le déconcerte.
Elle doit nécessairement le déconcerter et même le
déstabiliser un peu, parce que probablement il ne se
sera jamais posé cette question et se trouvera pris en
agrant délit de ne savoir pas. Tout simplement parce
que les deux disciplines sont différentes, de par les
données dont elles traitent (ce que sait tout un chacun),
mais aussi par leurs problématiques (ce que l’on oublie
trop souvent). Prenons un exemple2. Voici un corps
que l’on a retrouvé dans une tourbière, un lacet autour
du cou, la veine jugulaire trouée, et comportant plu-
sieurs traumatismes : que peuvent dire les anthropo-
logues à ce propos et quelles interprétations peuvent-
ils en proposer ? À brûle-pourpoint, ils ne pourront pas
en dire grand chose, pas plus que je n’ai été capable
de le faire la première fois où j’ai pris connaissance
des ces phénomènes. La première raison est qu’aucun
anthropologue, ni connu ni méconnu, n’a jamais fait
de théorie à propos des gens tués intentionnellement,
couverts de blessures et jetés dans un marais. Un tel
fait (on aimerait presque dire : un fait à classer parmi
les faits divers) n’évoque rien dans la conscience
anthropologique. Rien du côté de la théorie et, pour
cette raison, rien du côté des données car on ne connaît
bien en anthropologie que les faits qui sont suscep-
tibles de conrmer ou d’inrmer telle ou telle théorie,
tel fait de la parenté, telle manière de traiter l’inceste,
tel rituel sacriciel. Donc, cela n’évoque rien, ni dans
la théorie, ni dans les données, du moins dans celles
dont les anthropologues parlent et traitent ordinaire-
ment. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas quelque
part dans une ethnographie obscure des observations
qui pourraient être utiles à l’interprétation des hommes
dans les tourbières. Mais il faut aller les chercher. Il
faut faire une recherche spécique. Celui qui la fera
aura évidemment pris connaissance des différentes
interprétations courantes en archéologie, de l’hypo-
thèse du sacrice humain qui se trouve être la plus en
faveur, et se posera en conséquence des questions du
genre : où jette-t-on les cadavres des sacriés ? dans
les marais ? est-il courant de sacrier par strangula-
tion ? etc. Il devra donc faire une recherche spécique
en explorant de façon systématique des données peu
connues (et sur la question du sacrice humain, forcé-
ment relevant de l’ethnohistoire), car en dehors de
toute problématique anthropologique et orientée en
fonction d’un questionnement archéologique.
Ce que je veux dire est que toute question sérieuse
posée par l’archéologie à l’anthropologie, si elle veut
avoir une réponse sérieuse, doit forcément induire une
recherche spécique, longue, difcile, et presque entiè-
rement en dehors des traditions intellectuelles de la
discipline anthropologique. Elle doit aussi être et se
vouloir au service de l’archéologie.
Mais, demandera-t-on, à quelles ns ?
Première tâche :
ouvrir et baliser le champ des possibles
En réalité, tant que l’on se demandera si ce cadavre
retrouvé résulte ou non d’un sacrifice humain, on
raisonnera mal. Ce sera un peu comme un plébiscite.
Et de même que la démocratie fonctionne bien s’il y
a plusieurs candidats, la science fonctionne bien s’il y
a plusieurs hypothèses en lice. Je suis un peu poppé-
rien en matière d’épistémologie et j’ai tendance à
penser que l’hypothèse unique, comme le candidat

388 Alain TESTART
Bulletin de la Société préhistorique française 2006, tome 103, no 2, p. 385-395
unique, a peu de mérite à triompher et que n’est vrai-
ment convaincante que celle qui s’impose contre un
grand nombre de concurrentes (et même plus : celle
qui paraissait avoir le moins de chance à prime abord).
C’est en ce point qu’intervient ce savoir anthropolo-
gique dont je parlais plus haut. Car il devrait nous dire
d’abord que le sacrice humain est rare. Et qu’un
corps supplicié jeté dans un marais peut résulter, tout
à fait a priori et sans faire aucune hypothèse annexe,
d’une multitude de causes possibles :
- d’un sacrice humain ;
- d’un crime crapuleux, ce qui existe dans toute
société ;
- d’une pratique que l’on oublie trop souvent : la
torture des prisonniers, ce dont l’ethnographie
(d’hier, bien sûr) témoigne sufsamment, y compris
chez les Iroquois, les bons sauvages de nos philo-
sophes des Lumières, et ce dont témoigne tout autant
l’histoire, les Romains jetant les chefs barbares
vaincus aux fauves dans l’arène, pratique qui n’a
jamais été décrite ni assimilée par personne à un
sacrice ;
- d’une exécution pénale, l’ethnographie montrant que
le pénal existe dans toutes les sociétés, y compris
dans celles réputées les plus « basses », les Abori-
gènes australiens ayant par exemple des modes
d’exécution tout à fait réglés des criminels, des
incestueux par exemple, lesquelles exécutions n’ont
absolument rien de religieux ;
- d’une pratique que j’appelle « mort d’accompagne-
ment »3, abusivement assimilée à un sacrice alors
que c’en est rigoureusement le contraire de par
l’esprit, et qui consiste à occire le suivant ou le
serviteur d’un homme lors de sa mort pour qu’il
l’accompagne dans la mort.
S’apercevoir de tout cela, c’est ouvrir son imagina-
tion sociologique, c’est susciter des explications
concurrentes, et peut-être plus probables, que celle du
sacrice humain qui semble tant séduire nos contem-
porains.
Ayant maintenant plusieurs hypothèses, nous pou-
vons travailler.
Deuxième tâche :
trouver les corrélats des différents possibles
Travailler en matière de science, c’est toujours
mettre en évidence des relations entre différents ordres
de faits.
C’est par exemple, s’apercevoir que le sacrice
(humain ou non, d’ailleurs) a normalement lieu dans
un temple, devant un autel, ou sur une place consa-
crée, ce qui n’est pas le cas dans l’exemple de notre
homme des marais. Tout au moins n’avons-nous pas
le moyen de prouver que ce marais était consacré.
C’est, en poursuivant sur cet exemple, constater que
partout la victime sacrificielle a été abattue d’une
façon rituelle et fort précise, par arrachage du coeur
ou par égorgement, de bien d’autres manières encore,
variables selon les cultures, mais jamais avec un
acharnement tel qu’elle aurait reçu plusieurs coups
qui, sans raison puisque la strangulation et le perce-
ment de la veine sufsaient à assurer sa mort, lui ont
brisé les côtes ou la tête. Encore une fois, le contexte
rituel général du sacrice s’accorde peu avec les don-
nées de notre exemple.
C’est enn la constatation que le sacrice par stran-
gulation (ou par pendaison) reste excessivement rare.
Mais plus encore, que la corde et toute forme de stran-
gulation dans la tradition occidentale (depuis au moins
les Romains et jusqu’à la Révolution de 1789 qui a
honoré les manants d’avoir la tête coupée, privilège
autrefois réservé aux seuls nobles) est par excellence
la marque de l’infamie, ou du suicide féminin, ce qui
revient à peu près au même.
On pourrait évoquer d’autres ordres de données
mais, dans le cadre de cet article à visée purement
méthodologique, ceux-ci sufront.
Mon idée est que pour interpréter correctement le
cadavre que j’ai pris en exemple, c’est-à-dire l’homme
de Lindow4, il n’est pas déplacé – et il est même sou-
haitable – de prendre en considération les Aztèques,
les Polynésiens, les Africains ou les Aborigènes aus-
traliens si l’on peut induire de leur considération
quelques règles générales et simples de sociologie
comparative : que tout rituel (sacriciel ou non) se
déroule généralement selon un ordre convenu qui ne
laisse rien au hasard, qu’une exécution pénale peut au
contraire laisser une certaine latitude à une foule hai-
neuse ou encore au bourreau ; que le sacrice va mal
avec la strangulation ou la pendaison ; etc.
Il n’est pas déplacé non plus de considérer une
tradition culturelle sur le très long terme, de façon à
mettre en perspective la Protohistoire avec ce que l’on
sait de Rome ou de notre histoire d’hier encore : à
savoir qu’en Occident (il en va différemment en
Afrique, par exemple), strangulation et pendaison
furent à toute époque la marque de l’infamie.
Enn, il n’est pas déplacé non plus d’interroger les
textes antiques, dans la mesure où ils nous parlent des
barbares. Il y a là une ethnographie antique qui doit
être traitée comme l’ethnographie moderne. Toute
observation est partielle et partiale, parce que conduite
d’un certain point de vue. Il convient d’en faire la
critique, au même titre que les historiens font la cri-
tique des sources, sans sombrer ni dans l’hypercri-
ticisme ni dans la naïveté qu’il y aurait à croire tout
ce que l’on nous dit. Mais le problème est le même
pour Hérodote ou pour Malinowski. Et, concernant les
hommes des tourbières, il existe chez Tacite un pas-
sage oublié, tandis que l’on cite à profusion ceux qui
semblent témoigner d’un sacrice humain et que l’on
sollicite fort d’ailleurs. Le voici :
« On pend5 à un arbre les traîtres et les transfuges ;
les lâches, ceux qui fuient les combats ou qui dégradent
leur personne, sont plongés dans la fange d’un bour-
bier et noyés sous une claie. Cette diversité de sup-
plices tient à l’opinion qu’il faut, en punissant, montrer
le crime et cacher l’infamie» (Tacite, La Germanie,
XII).
Il dit exactement ce dont nous avons besoin pour
l’interprétation de l’homme de Lindow : que le fait

Comment concevoir une collaboration entre anthropologie sociale et archéologie ? À quel prix ? Et pourquoi ? 389
Bulletin de la Société préhistorique française 2006, tome 103, no 2, p. 385-395
d’avoir été jeté dans un marécage peut suivre une
exécution pénale et que l’infamie de la corde (ce que
nous soupçonnions à partir d’autres données) s’accli-
mate bien de ce qu’elle se dissimule aussi dans un
marécage.
Que dire maintenant des autres hypothèses que nous
avons évoquées précédemment ? L’hypothèse du crime
crapuleux pourrait être maintenue au vu du seul cas
de l’homme de Lindow ; mais il est exclu par la consi-
dération des autres hommes (et femmes) des tourbières
(on en connaît à présent des centaines). Il y a trop de
gens étranglés et je ne vois aucune raison pour laquelle
des malfrats devraient donner la mort plutôt par stran-
gulation qu’autrement et non pas par des moyens bien
divers. La torture des prisonniers me paraît également
exclue car ces mises à mort, par strangulation, ou dans
d’autres cas par simple égorgement, n’est pas assez
cruelle eu égard à ce que l’on connaît de la torture des
prisonniers – et ce, tant chez les Iroquois que chez les
anciens barbares comme les Germains. Quant à l’idée
de morts d’accompagnement, il faudrait pour que
l’hypothèse puisse raisonnablement être prise en consi-
dération que l’on retrouve plusieurs cadavres les uns
à côté des autres. Ce n’est pas tout à fait exclu dans
certain cas, mais ce n’est en aucun cas une régula-
rité.
Des cinq possibles, donc, c’est l’exécution pénale
qui paraît la plus vraisemblable, la seule pensable
parce que nous avons détaillé les attendus dans chaque
cas : et ce sont seulement ceux de l’hypothèse pénale
qui se rencontrent dans l’homme de Lindow.
Dans ce cas, les données archéologiques disponibles
(en incluant les données d’anthropologie physique)
sufsent à trancher. Mais ce n’est pas toujours le cas,
c’est à vrai dire très rarement le cas (lequel ne s’ex-
plique que par la qualité exceptionnelle du traitement
archéologique de l’homme de Lindow). Il convient
alors d’envisager une troisième tâche. Je la crois géné-
rale. Pour la mettre en évidence, je vais envisager un
second exemple.
SECOND EXEMPLE
(LE MOBILIER FUNÉRAIRE) :
QUESTION
Notre second exemple provient du champ immense
de l’archéologie funéraire, à propos duquel les archéo-
logues adressent ordinairement aux anthropologues
des questions telles que : que font les peuples actuels
lors des funérailles ? Quel est le sens des rites funé-
raires ? Comment varient-ils d’une culture à l’autre,
d’une époque à l’autre, et pourquoi ? etc. De cet
ensemble complexe, nous ne retiendrons que cette
question, typique d’une archéologie sociale, posée
depuis Gordon Childe à Binford et au-delà : la diffé-
renciation des richesses dans les tombes témoigne-
t-elle d’une différenciation sociale ? Assez souvent, la
réponse à une telle question est évidente. S’agissant
des tombes d’Ur, des pyramides ou des kourganes
scythes, la profusion de richesses de certaines tombes
témoigne sufsamment de ce que la société était domi-
née par une élite dont on a tout lieu de supposer que,
parce qu’elle accumulait les richesses dans les tombes,
elle les avait aussi accumulées pendant la vie. Mais il
n’en va pas toujours ainsi. Ainsi dans le Rubané (ou
Danubien), c’est-à-dire dans le premier Néolithique,
la différenciation du mobilier funéraire ne concerne
tout au plus que quelques haches, herminettes, bivalves
de type spondyles, ou colliers de coquillages. Faible
différenciation, diront les uns, sur la base d’un déve-
loppement presque inexistant de la richesse : selon
cette interprétation, ce seront encore des sociétés éga-
litaires, presque toutes entières dans la tradition des
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique ou du Mésoli-
thique. Différenciation, néanmoins, et signicative,
diront les autres, qui calculeront des index de richesse
et montreront l’existence d’écarts signicatifs d’une
tombe à l’autre. La question est, à l’heure actuelle,
fortement controversée6.
Que peut dire l’anthropologie sociale à ce sujet ?
Tout comme dans l’exemple précédent des bog
people, la discipline anthropologique a au premier
abord fort peu d’idée sur la question. Premièrement,
parce que la question posée est typiquement archéo-
logique : elle procède d’une problématique totalement
étrangère à l’anthropologie. L’idée ne viendrait à
aucun anthropologue d’étudier les hiérarchies sociales
à partir du mobilier funéraire. Parce qu’évidemment,
nous avons bien d’autres moyens, des moyens assez
nombreux et plus directs, de mettre en évidence des
hiérarchies. Deuxièmement, l’anthropologie n’a a
priori rien à dire sur cette question, parce que nous
manquons tout simplement de données en ce qui la
concerne. Pour chaque peuple bien étudié, nous dis-
posons de dizaines de pages, sinon de centaines de
pages, pour la description des rituels funéraires, en
tout genre, dont la plupart n’auront laissé aucune
trace. Mais, quant à savoir si l’on a mis une ou deux
épées dans la tombe, une ou deux herminettes près du
corps, pourquoi le saurions-nous ? Cela n’a pas été
observé parce que c’était en dehors des probléma-
tiques anthropologiques, concernées sur le sujet des
funérailles presque exclusivement par les croyances.
Et l’on n’observe jamais, l’on ne note jamais que ce
qui vous intéresse. Faudrait-il encore qu’on l’ait
observé. Les rites funéraires ont le plus souvent (pas
toujours, mais le plus souvent) été décrits par ouï-
dire : on a demandé aux informateurs ce qu’ils fai-
saient et ils racontent ce qu’ils sont censés faire. Et
ce qui intéresse les enquêteurs, tout comme les infor-
mateurs, ce n’est souvent que le plus anecdotique, le
plus haut en couleurs. Aussi ne faut-il pas s’étonner
que l’on ne trouve en ethnographie rien qui ressem-
blerait à une étude archéologique d’une nécropole
néolithique et qui dirait pour quelques dizaines de
tombes, ou plus, en détail combien de fois on a déposé
une ou deux herminettes, si l’on en a mis plus en
moyenne pour les hommes que pour les femmes, ou
encore si les enfants ont été traités comme les adultes.
Aux études statistiques exhaustives de l’archéologie
funéraire ne correspond donc en général du côté
ethnographique que quelques lignes, quand on les a,
qui nous disent tout au plus ce que l’on a bien voulu
dire à l’observateur.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%